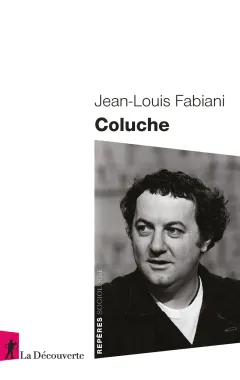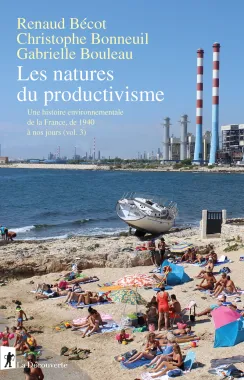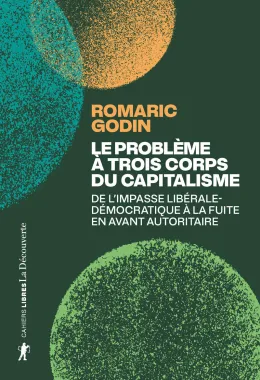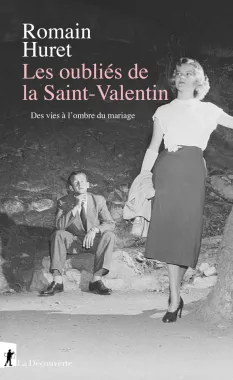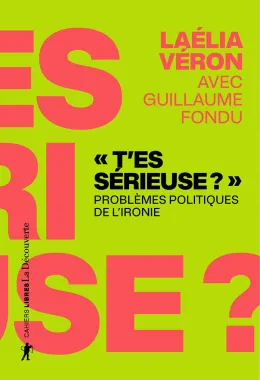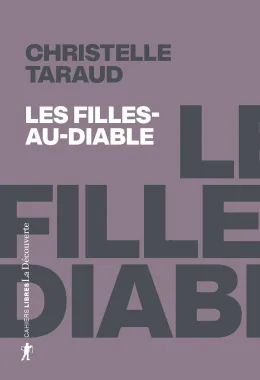La barbarie douce : Le livre de Jean-Pierre Le Goff
Depuis les années 1980, la " modernisation " est partout à l'ordre du jour. Mais au nom de la nécessaire adaptation aux " mutations du monde contemporain ", c'est bien souvent une véritable " barbarie douce " que cette modernisation aveugle installe au cœur des rapports sociaux. C'est ce que montre Jean-Pierre Le Goff dans ce livre, dans deux champs particulièrement concernés par le phénomène : l'entreprise et l'école. La barbarie douce s'y développe avec les meilleures intentions du monde, l'" autonomie " et la " transparence " sont ses thèmes de prédilection. Elle déstabilise individus et collectifs, provoque stress et angoisse, tandis que les thérapies en tout genre lui servent d'infirmerie sociale. L'auteur met à nu la stupéfiante rhétorique issue des milieux de la formation, du management et de la communication. Et explique comment elle dissout les réalités dans une " pensée chewing-gum " qui dit tout et son contraire, tandis que les individus sont sommés d'être autonomes et de se mobiliser en permanence. L'auteur montre que cette barbarie douce a partie liée avec le déploiement du libéralisme économique et avec la décomposition culturelle qui l'a rendue possible. Et il explore les pistes d'une reconstruction possible pour que la modernisation tant invoquée puisse enfin trouver un sens.
Cette édition numérique reprend, à l'identique, la 2e édition de 2003.
De (auteur) : Jean-Pierre Le Goff
Expérience de lecture
Avis des membres
Fiche technique du livre
-
- Genres
- Classiques et Littérature , Essais
-
- EAN
- 9782707189769
-
- Collection ou Série
-
- Format
- Livre numérique
-
- DRM
- Filigrame numérique
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers où les mots s'animent et où les histoires prennent vie. Que vous soyez à la recherche d'un roman poignant, d'une intrigue palpitante ou d'un voyage littéraire inoubliable, vous trouverez ici une vaste sélection de livres qui combleront toutes vos envies de lecture.
6,99 € Numérique 144 pages