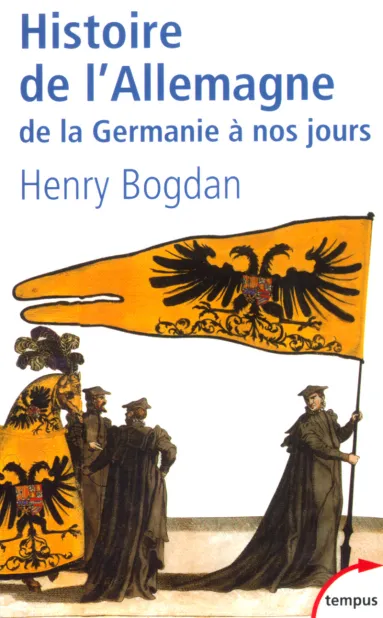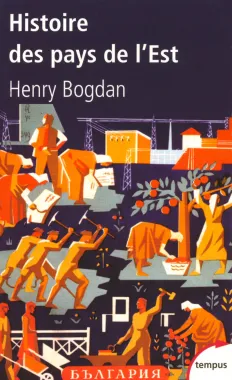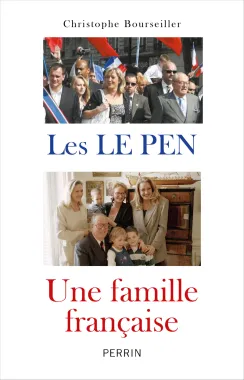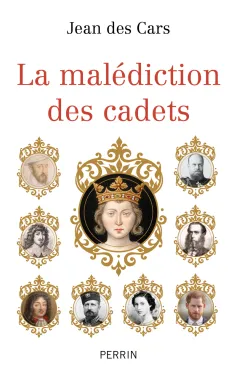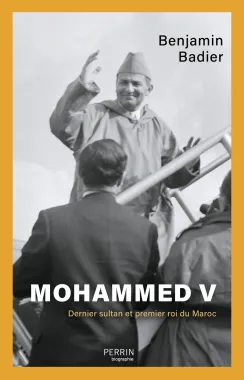Histoire de l'Allemagne de la Germanie à nos jours : Le livre de Henry Bogdan
Nombreux sont les ouvrages qui font commencer l'histoire de l'Allemagne en 1871, date de l'unité. Elargissant cette vision, Henry Bogdan propose une synthèse qui embrasse le passé allemand depuis l'entrée des Germains dans le monde occidental jusqu'à la réunification de 1990. II analyse le Moyen Age riche en événements et contradictions (notamment la fondation au Xe siècle du Saint Empire romain germanique), le règne des Habsbourg, l'apparition de la Prusse de Frédéric II, l'essor économique au XIXe siècle, l'émergence de l'allemagne bismarkienne et l'unification d'un pays longtemps éclaté. Cette histoire générale du monde germanique est indispensable pour comprendre celle des peuples européens et bien des aspects de l'Allemagne contemporaine.
Henry Bogdan, agrégé d'histoire et diplômé des Langues O, est spécialiste de l'histoire de l'Europe centrale et orientale, et plus particulièrement de la question des minorités nationales. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Histoire de la Hongrie (Que sais-je ?), et, chez Perrin, de Histoire des pays de l'Est, Histoire des peuples de l'ex-URSS, Les Chevaliers teutoniques, La Guerre de Trente Ans et Histoire des Habsbourg. Henry Bogdan assure des cours à l'EMSST et au Centre d'études européennes de l'université de Marne-la-Vallée.
De (auteur) : Henry Bogdan
Expérience de lecture
Avis Babelio
JBLM
• Il y a 2 semaines
Ouvrage très intéressant qui accomplit la prouesse de résumer plus de 20 siècles d'histoire germanique en moins de 500 pages, sans pour autant donner l'impression de couper dans les virages. Faisant la part belle à la politique, Henry Bogdan retrace une chronologie à la fois synthétique et dense, entrecoupées de quelques cartes thématiques et de passages plus descriptifs sur la vie quotidienne, la religion ou encore l'économie, nécessaires à la bonne compréhension des enjeux des choix souverains. Les règnes, puis les mandats, sont abordés les uns après les autres, avec leurs spécificités souvent liées, dans le choix des réformes, au caractère de l'empereur, du chancelier ou du président. Comme le déplore d'emblée l'auteur, nous, Français, connaissons somme toute assez peu notre principal voisin, mis à part les conflits qui nous ont opposés entre la fin du XIXème siècle et la moitié du XXème siècle. Combien de jeunes Français ont déjà entendu parler à l'école de la Guerre de Trente ans, qui fut l'un des conflits les plus sanglants de l'Histoire de l'Europe ? Bien peu… L'auteur fait le choix ambitieux de commencer ce portrait depuis l'Antiquité, où se divisent d'ores-et-déjà les peuples germaniques face à l'impérialisme romain : certains lui résistent, d'autres font partie de ses supplétifs. La division, c'est le trait qui ressort le plus de cette Histoire de l'Allemagne et intrigue le plus nos conceptions françaises extrêmement centralisatrices. C'est à la fois sa force et sa faiblesse : l'empereur, dépositaire illustre de l'héritage de l'empire romain, peut compter sur une masse énorme de sujets, donc de citoyens imposables, de soldats, de producteurs, de marchands, etc., mais il est contraint de faire des concessions en permanence pour s'assurer l'appui d'une multitude de princes jaloux de leur autonomie, princes assez perméables aux influences étrangères. Il y a autant de politiques que de principautés, parfois des langues différentes, et la question du protestantisme va rajouter encore plus de complexité à un Empire déjà ultra-morcellé, où l'on est Bavarois, Prussien ou Rhénan avant d'être Allemand. Même lorsque l'Allemagne était divisée entre RDA et RFA, il y a moins de 50 ans, la volonté de réunification n'allait pas de soi. Aujourd'hui encore, la forme fédérale de l'Allemagne est directement héritée de ce souci d'indépendance des parties par rapport au tout qui caractérise la politique allemande. L'autre aspect particulièrement frappant de cette Histoire, c'est le statut hors-normes du Saint-Empire, pendant temporel de la papauté. La religion, en Allemagne, avant même l'émergence de la Réforme, c'est le sujet incontournable qui cristallise toutes les frictions de l'Empire. L'empereur et le pape passent leur temps à empiéter l'un sur l'autre, à s'appuyer ou s'affronter sur les grandes questions qui traversent l'Eglise ou sur les factions en lutte sur la péninsule italienne, principalement lors des affrontements interminables entre Guelfes et Gibelins. Certains empereurs ont passé plus de temps, d'énergie et de ressources à tâcher de résoudre les problèmes de l'Italie qu'à gérer le territoire historique de l'Allemagne, de sorte que si on rajoute à l'équation les velléités françaises, polonaises ou danoises, on est très souvent amené à dépasser les seules frontières de l'Allemagne moderne. L'Allemagne a fini par abandonner le sud des Alpes, mais elle a gardé de ces longues controverses avec l'Eglise une appétence particulière pour les idées, qu'elles soient théologiques ou plus largement philosophiques. Le XXème siècle est évidemment un peu plus développé que les autres siècles, surtout la période nationale-socialiste, mais on ne tombe pas dans le misérabilisme permanent qui caractérise l'écriture contemporaine de cette période. On fait de l'Histoire : on retranscrit les faits, et on laisse ses jugements de valeur au placard, même sur un sujet aussi consensuel que « le nazisme, c'est mal ». Il intéresse beaucoup plus l'auteur d'expliquer en détail comment Hitler est arrivé au pouvoir, sur quel programme, et dans quelle mesure il a pu l'appliquer, plutôt que de décrire en profondeur le fonctionnement du camp de Birkenau à grands renforts de détails sordides. Voilà, c'est un choix, il se tient pour moi. Intéressant, d'ailleurs, de constater le jeu très ambigu de l'URSS durant toute cette période. Franchement, un très bon bouquin, très concret, très dynamique, qui permet véritablement de comprendre le passé, le caractère et les fondements politiques des Allemands. Evidemment, si, pour vous, lire de l'Histoire c'est « scruter les masses », c'est-à-dire s'intéresser surtout à la vie du peuple, à son pouvoir d'achat, à l'art, à l'architecture, et autres domaines annexes qui constituent le décor de l'Histoire mais pas l'Histoire elle-même, si vous vous fichez de qui est au pouvoir et de contre qui on est en guerre à quel moment et pourquoi, forcément, vous allez vous ennuyer. Par contre, si vous voulez des événements, des personnages, de la diplomatie et des idées, vous serez servis.
Etsionbouquinait
• Il y a 6 mois
"Le passé historique de l'Allemagne est très mal connu des Français. Il se limite généralement à l'époque contemporaine. S'il remonte parfois jusqu'en 1870, c'est uniquement dans la perspective des conflits au cours desquels Français et Allemands se sont confrontés". Voici les premiers mots de l'avant-propos d'Henri Bogdan dans son Histoire de l'Allemagne. Une lacune malheureusement réelle ; ainsi, coïncidant avec la commémoration cette année du trentenaire de la réunification, mais aussi les 80 ans du début de la Seconde Guerre Mondiale, je vous propose de vous plonger aujourd'hui dans l'histoire de nos voisins d'Outre Rhin ! Ce serait une gageure que de vouloir résumer ce livre dans cette courte chronique ; aussi, je souhaite vous proposer quelques réflexions et événements qui ont façonné l'histoire de l'Allemagne. Commençons par définir deux termes avant d'aller plus loin : la Germanie évoquée dans le titre est "le territoire de la rive gauche du Rhin soumis à Rome" qui deviendra, selon Tacite, le monde germanique à la fin du Ier siècle après JC. Les Germains, originaires de Scandinavie méridionale, s'y sont installés avant de partir "à l'assaut du monde romain". le Saint Empire romain germanique, quant à lui, est une notion importante à saisir : il s'agit de l'expression employée pour désigner le territoire dirigé par l'Empereur des Romains ; il s'inscrit dans la continuité de l'Empire d'occident des Carolingiens et de l'Empire romain. Il ne s'agissait pas d'un Etat-Nation, loin de là. le qualificatif de "Saint" lui fut donné par Frédéric Barberousse. On ne parle donc peu de l'Allemagne, mais du Saint Empire qui finira officiellement en 1806. Attardons-nous maintenant sur le fait religieux, notamment aux XVIème et XVIIème siècle. En 1517, Luther publie ses 95 thèses qui seront condamnées par le pape Léon X dès 1520. Ferdinand de Habsbourg, le frère de Charles Quint, qui gère les affaires allemandes, tergiverse, et la réforme se diffuse. En 1526, à la diète de Spire, il est décidé que "chaque prince a "la liberté de croire" ; mais Ferdinand revient sur cette décision en 1529 de telle sorte que le luthéranisme ne peut s'étendre à de nouvelles régions (en "protestant" contre cette décision, les réformés donnent ainsi le nom de "protestantisme" à leur mouvement). Des conflits s'installent, et en 1555, lors de la paix d'Augsbourg, la reconnaissance officielle de la religion réformée (par le pouvoir temporel, pas par le pape) et de la liberté de religion des princes conduisent finalement à ce découpage que l'on connaît encore aujourd'hui sur le territoire allemand : schématiquement, un nord protestant et un sud catholique, la réforme s'étend diffusée à partir du nord-est. Les querelles religieuses ne sont pas finies dans cette région ; à partir de la défenestration de Prague de 1618, l'immission progressive des puissances étrangères conduit à la Guerre de Trente Ans. Une guerre qui sera une véritable catastrophe démographique pour ce qu'on appelle encore le Saint Empire. Le grand morcellement du territoire, et l'impossibilité de comprendre le fédéralisme allemand avec le modèle français en tête, sont également clés. Dès le Xème siècle, on note l'importance des ducs et des duchés. Par le Concordat de Worms, l'Empereur abandonne au pape l'investiture spirituelle, en échange de sa reconnaissance par ce dernier. En raison de querelles de dynasties, l'autorité monarchique reste souvent faible. Sous le règne de Charles IV, pour stabiliser la région, la Bulle d'Or fixe les modalités d'élection du souverain. Ce faisant, elle "consacre la faiblesse de l'autorité royale face à la toute-puissance des princes territoriaux". Comme je le mentionnais précédemment, l'Empereur est un prince territorial parmi d'autres, qui n'a de véritable autorité que sur ses Etats patrimoniaux (en l'occurrence l'Autriche et la Bohême pour faire simple). Notons le grand morcellement de l'Empire lorsqu'éclate la Révolution française (2 puissantes dominantes, 300 principautés de statut et taille différentes, 51 villes libres d'Empire, 74 principautés ecclésiastiques !). Il faudra attendre le XIXème siècle pour voir la marche vers l'unité. L'Empire allemand né de la défaite de Sedan et le IIIème Reich seront les seules tentatives de centralisation, avant de revenir en 1949 sur un modèle très fédéral. La rivalité entre l'Autriche et la Prusse mérite également d'être mentionnée. Les Habsbourg se sont progressivement imposés dans la région, et l'Empereur était issu de ses rangs. Ville la plus peuplée au XVIIIème siècle, Vienne rayonne et voit son prestige renforcé après la libération de la Hongrie vers 1685. Face à elle, le royaume de Prusse émerge à partir de 1713. Petit à petit, une Allemagne bicéphale voit le jour. Chaque entité affirme son pouvoir central. A la fin du XVIIIème siècle, la Prusse de Frédéric le Grand est un bénéficiaire, comme l'Autriche, du partage de la Pologne. Cette même Prusse crée une union douanière en 1834 qui fédère 26 millions d'habitants et 25 Etats et Guillaume Ier reprend à son compte en 1861 l'idée d'une Allemagne unifiée sous la direction de la Prusse. En 1866, par la défaite de Sadowa, l'Autriche est de facto exclue de l'espace germanique. La suite est connue : l'Autriche se recentre sur sa zone d'influence et l'Autriche-Hongrie naît en 1867 tandis que le Reich Allemand (le second) est proclamé en 1871. Enfin, rappelons la montée en puissance de l'Empire allemand avant l'écroulement du XXème siècle. Avec 68 millions d'habitants en 1914 (dont 2/3 urbanisés), un réseau de communications très développé, l'Allemagne était devenue la première puissance économique européenne. La situation matérielle très difficile de l'après-guerre et la perte de 20% du territoire suite au traité de Versailles ont été durement ressenties par la population. En 1945, le pays ressort exsangue de la guerre qu'il avait provoquée : 6.000.000 victimes et 9.000.000 prisonniers (dont encore 2 millions à l'Est en 1949 / 1950 !). Au final, un ouvrage vraiment passionnant duquel on apprend beaucoup de choses. de plus, au début de chaque chapitre, quelques phrases résument ce que l'on va apprendre dans la partie concernée : une véritable aide à la compréhension. Cela me fait d'ailleurs penser que ce dernier ne s'adresse pas seulement à un public initié. La seule limite réside dans le format des cartes (c'est un poche) ; on aurait aimé en trouver un peu plus également.
Avis des membres
Fiche technique du livre
-
- Genres
- Sciences Humaines & Savoirs , Histoire
-
- EAN
- 9782262021061
-
- Collection ou Série
- Tempus
-
- Format
- Poche
-
- Nombre de pages
- 480
-
- Dimensions
- 180 x 110 mm
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers où les mots s'animent et où les histoires prennent vie. Que vous soyez à la recherche d'un roman poignant, d'une intrigue palpitante ou d'un voyage littéraire inoubliable, vous trouverez ici une vaste sélection de livres qui combleront toutes vos envies de lecture.
10,00 € Poche 480 pages