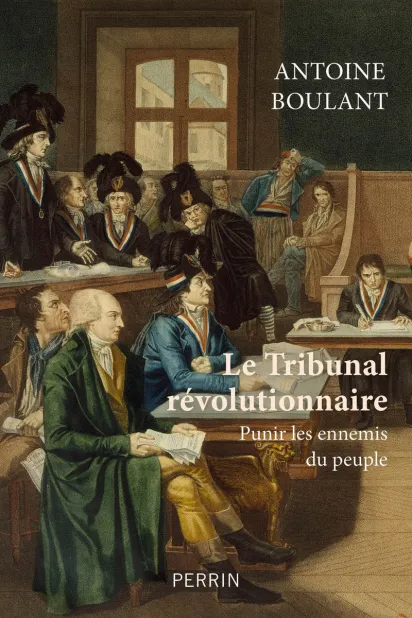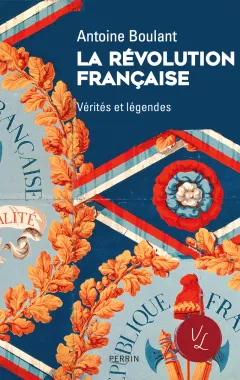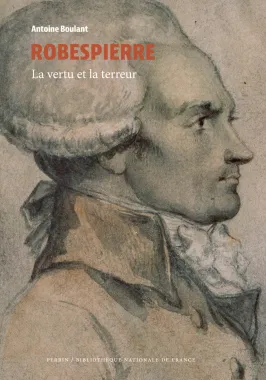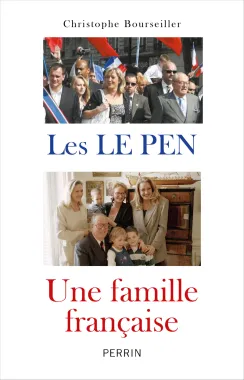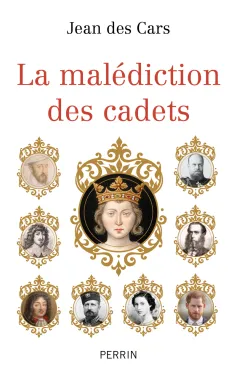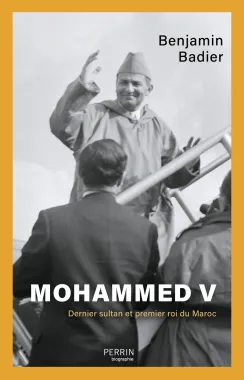Le tribunal révolutionnaire : Le livre de Antoine Boulant
Le 10 mars 1793, la Convention nationale instituait un tribunal criminel destiné à réprimer " toute entreprise contre-révolutionnaire " et " tout attentat contre la liberté, l'égalité, l'unité, l'indivisibilité de la République ". Installé dans le Palais de justice de l'île de la Cité, il allait faire comparaître plus de quatre mille personnes pendant seize mois, et en condamner près des deux tiers à la peine capitale.
Le Tribunal révolutionnaire de Paris est sans conteste la plus célèbre des juridictions d'exception qui furent mises en place sous la Terreur pour punir les ennemis – réels ou supposés – de la jeune République. Dominé par la figure de son accusateur public, Fouquier-Tinville, il est devenu le symbole de l'arbitraire judiciaire.
S'appuyant sur les travaux les plus récents, mais également sur de nombreux documents inédits, le présent ouvrage renouvelle en profondeur notre vision du Tribunal révolutionnaire. Tout en proposant un récit détaillé des grands procès politiques, en particulier ceux de Marie-Antoinette, des Girondins et de Danton, Antoine Boulant offre une analyse de la composition, du fonctionnement et de la logique d'une juridiction entièrement soumise au pouvoir politique, progressivement entraînée dans une spirale meurtrière.
De (auteur) : Antoine Boulant
Expérience de lecture
Avis des libraires
Avis des membres
Fiche technique du livre
-
- Genres
- Sciences Humaines & Savoirs , Histoire
-
- EAN
- 9782262070199
-
- Collection ou Série
-
- Format
- Grand format
-
- Nombre de pages
- 300
-
- Dimensions
- 212 x 141 mm
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers où les mots s'animent et où les histoires prennent vie. Que vous soyez à la recherche d'un roman poignant, d'une intrigue palpitante ou d'un voyage littéraire inoubliable, vous trouverez ici une vaste sélection de livres qui combleront toutes vos envies de lecture.
24,00 € Grand format 300 pages