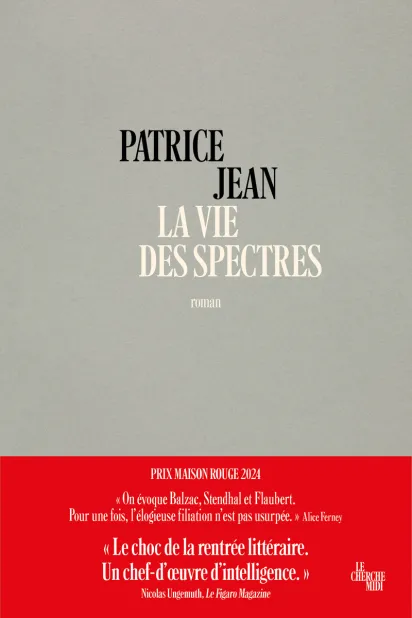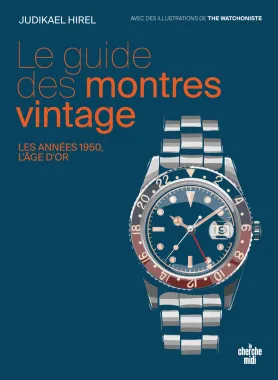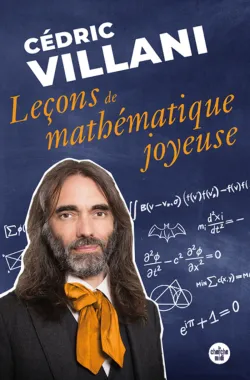La vie des spectres : Le livre de Patrice Jean
Jean est journaliste dans la presse régionale. Son métier l'amène à rencontrer différentes personnalités de la vie locale afin de faire leur portrait. Quand l'un de ses articles fait polémique, sa femme et son fils se dressent contre lui avec violence et lui reprochent d'être dépassé, infréquentable, irrécupérable.
Jean quitte alors le domicile familial pour s'installer dans un pavillon abandonné. C'est là qu'il nouera un dialogue avec les spectres...
Jamais Patrice Jean n'a été aussi grinçant, ironique et impitoyable.
Jamais l'auteur de L'Homme surnuméraire n'a été aussi inattendu, déroutant et audacieux.
La Vie des spectres se joue des idéologies, des clichés et des registres, mêle la critique acérée de notre époque à un onirisme plus nostalgique.
La Vie des spectres est tout simplement un grand roman.
Lauréat du prix Maison Rouge 2024
De (auteur) : Patrice Jean
Expérience de lecture
Avis des libraires
Avis Babelio
Ropsucal
• Il y a 1 semaine
Jean Dulac vit à Nantes, où il est critique d’art pour une revue locale, et carté au PC, bien qu’il ne milite plus depuis longtemps (il rendra d’ailleurs sa carte). Il a jadis publié un livre introuvable, et s’évertue à en finir un autre, intitulé « Les Fantoches ».Il s’entend mal avec sa femme, Doriane, dont les amies Sabrina et Nadège sont deux féministes caricaturales, dignes du MLF de jadis et des « Frustrés » d’une autre nantaise, « Claire Brétécher ». Son fils Simon est lui aussi une caricature d’ado boutonneux pour qui on est « facho » dès qu’ont n’est pas de son avis, et qui trouve nuls les textes étudiés en classe vu qu’ils sont anciens, comme « Le Misanthrope ». Sa prof, Mme Girardin, est giflée par un élève, aussitôt défendu par le proviseur, Berthault, chose hélas courante dans la vie réelle. Hélène Drach la remplacera, et résistera plus longtemps. Elle fait une thèse sur Chestov, et Jean tombera amoureux d’elle. Hélène sera blâmée pour avoir refusé de se laisser tourner, en cours, pour le compte d’un rappeur... Dulac interviewe des intellos snobs, comme Delaunay et, plus tard, Piou, imbus d’eux-mêmes et sûrs de leur gloire à venir. Un scandale touche Rachel, pionne au lycée, dont l’ex, Alex, pion aussi, a balancé une sex-tape sur le web avec la complicité de deux potes, Moussa, et Simon , qui l’a postée sur son blog (p. 79), mais plus tard Rachel dira que c’est Moussa (p. 301) qui l’a fait : erreur de l’auteur, ou de Rachel ? Moussa va être tabassé par deux gusses de l’extrême-droite, qui veulent venger Rachel : elle a commis deux articles de critique musicale sur le site facho « Breizh Info » (qui existe). En fait, Moussa a été frappé par deux dealers car il avait volé du shit à un de leurs collègues... C’est moins politiquement correct. Dulac, qui l’a appris en lisant un mail sur l’ordi de Simon, ébruite malgré lui l’affaire, et s’attire les foudres de sa femme, qui le quitte, et de son fils. Cela met à mal les manifs qui ont lieu en faveur de Moussa. Dulac quitte son foyer pour vivre dans un petit appart’. Il va rencontrer le fantôme d’un ami tué en voiture, Ronan, dont la tempe dégouline de sang, et échanger avec lui de longues discussions où le spectre témoigne d’une sagesse blasée. Une épidémie surgit : les gens se découvrent des éruptions de boutons autour des lèvres, puis un peu partout. On pense à « La Peste », évidemment, voire à « Rhinocéros », et au Covid. Cela engendre un climat fantastique qui tourne à la fable : le remède contre cette pandémie va s’avérer être... la lecture ! Et chacun de dévorer des livres et de vider les librairies. C’est surprenant, et bien vu. Simon va co-écrire une BD sur l’affaire Rachel, où il charge son père. Elle a du succès. Le fils conseille à Dulac d’envoyer son roman à son éditeur, qui le refuse avec une lettre aigre. Dulac finit seul, mais le dernier paragraphe relance l’espoir : son ami Van Beveren est guéri et l’invite « pour boire à la gloire de tout ce qui est beau » : clausule étonnante pour un récit si pessimiste. L’auteur vit apparemment mal notre époque et son wokisme, qu’il traite de manière souvent drôle, mais caricaturale. Sabrina et Nadège ne reprochent-elles pas à Jean d’avoir interviewé un évêque, ce qui est « bafouer l’enfance martyrisée par les prêtres pédophiles » (p. 74), ou de s’insurger contre « la discrimination des femmes tatouées » (p. 119) ? On croise aussi des musulmanes qui se baignent entièrement couvertes (p 368). Quant à Hélène, elle est remplacée par un jeune prof, apprécié des élèves, qui fait sa thèse sur « Game of Thrones »... L’auteur dénonce des clichés : « racisés » (p. 119), « belle personne » (p. 411), mais emploie « pathétique » (p. 274) au sens anglais du mot, qui a hélas éliminé le sens ancien. Chaque époque a ses clichés : il manque « pas de souci », « opportunité », « c’est compliqué »... Notons les références à « La Place » (sans nom d’autrice) et à « Télérama » (p. 187), clins d’œil au wokisme de gauche. P. Jean me semble se répéter : Rachel, qui a écrit sur un site facho, et l’intello en chambre Piou rappellent la militante catho et le philosophe Beauséjour, caricature de Lacan/Barthes, apparus dans « La Poursuite du bonheur ». Les gens qui connaissent bien Nantes apprécieront de l’arpenter en compagnie de Dulac : place Graslin, Quai de la Fosse, librairie Coiffard... P. Jean m’a fait découvrit Pacadis (p. 239), dont je n’avais jamais entendu parler. On le rapproche souvent de Houellebecq : moins blafard, moins aigri, quand même. Mais critiquer le féminisme (qui a eu certes des côtés caricaturaux), à une époque où tant de femmes meurent sous les coups des hommes, me semble un exercice risqué, et inutile. « La Vie des spectres », un peu long, se lit bien, même si j’ai du mal à en comprendre le but : brosser le portrait d’une époque pour en critiquer certains excès, soit. Mais il y a pires horreurs que les comportements décrits ici. Dulac est un raté, un minable : ce roman est picaresque, en somme. On ne peut pas peindre que des Rastignac, c’est vrai. Je crois que l’art n’est jamais plus fréquentable que quand il est rayonnant, bienveillant, quand il m’élève, comme Huguenin dans « La Côte sauvage » ou Van Gogh dans « La Nuit étoilée ». Cela n’empêche pas la critique, évidemment. Patrice Jean, dont la prose désenchantée cache la sensibilité, pourrait écrire sa « Côte sauvage », si j’en juge par cet extrait magnifique, et bien seul hélas, pour l'instant : « Les feuilles des bosquets s’argentaient au contact de la lumière blanche ; on aurait dit qu’elles tremblaient d’une vie secrète, pareille à celles des chouettes et des musaraignes qui ne sortent que la nuit, en ces heures où s’efface l’être humain, abandonnant son empire à plus faible que lui » (p. 324).
Sebastiend
• Il y a 2 semaines
Patrice Jean, dans La vie des Spectres, propose une fresque littéraire sombre et critique, où se dessine le portrait d’un narrateur vieillissant, fatigué, désabusé face aux conventions sociales, aux débats contemporains et à l’uniformisation culturelle. À travers son regard ironique et désillusionné, le roman interroge la place de l’individu dans une société dominée par les hypocrisies de civilité, les dogmes idéologiques, la culture de masse et les illusions de la modernité. Ce texte, à la fois confession et satire, met en évidence les contradictions d’un homme qui se dit lucide mais reste prisonnier de ce qu’il dénonce. L’analyse qui suit met en relief les six grands axes thématiques qui structurent l’œuvre : la critique de l’hypocrisie sociale, le désenchantement et la fuite du monde humain, la remise en cause du féminisme contemporain, la dénonciation de la culture de masse, la métaphore théâtrale de la vie inauthentique et enfin la lassitude existentielle qui conduit au désir de disparaître. 1. La critique de l’hypocrisie sociale et des mensonges de civilité L’un des premiers thèmes développés dans La vie des Spectres est celui des mensonges de civilité, ces petites hypocrisies nécessaires à la vie sociale. Le narrateur observe et dénonce à la fois leur omniprésence et leur fonction pragmatique. D’un côté, il reconnaît que sans ces arrangements avec la vérité, la vie en société serait impossible. Les interactions humaines seraient trop brutales, trop violentes, si elles se passaient de fables et de tromperies. « Sans le recours aux fables et aux minuscules tromperies, la vie en société deviendrait impossible, un genre de fondrière où nous ne cesserions de nous enliser. » L’hypocrisie devient donc une forme de ciment social, une « faute morale » qui paradoxalement autorise une certaine paix civile. Mais ce constat n’efface pas la critique acerbe du narrateur. Car ces mensonges répétés produisent une atmosphère d’artificialité et de prévisibilité, où tout semble déjà écrit d’avance. À 49 ans, il constate que la surprise et l’inattendu ont déserté l’existence. Chaque interaction se réduit à un scénario convenu, chaque parole à un cliché attendu. Ce qu’il appelle « l’insupportable clarté des choses » finit par tuer la vitalité de l’expérience humaine. Cette lucidité cynique ne le met pas à l’abri de reproches. Sa compagne, Doriane, le confronte directement : « Vous êtes deux beaux hypocrites, oui, et tu es le pire des deux parce que tu te glorifies d’être un faux cul ! » En mettant en lumière l’écart entre ses discours critiques et sa propre pratique de la duplicité, Patrice Jean souligne que nul n’échappe à ce système de faux-semblants. Même ceux qui en dénoncent l’existence s’en accommodent et parfois en tirent fierté. La critique de l’hypocrisie sociale dans le roman n’est donc pas seulement une dénonciation extérieure ; elle reflète aussi une contradiction interne, qui nourrit le malaise du narrateur et l’enferme dans une spirale de lassitude. 2. Le désenchantement et la fuite du monde humain Le second grand axe de l’ouvrage est celui du désenchantement existentiel. Fatigué de la répétition, lassé de l’uniformité des comportements et de la stérilité des débats, le narrateur choisit progressivement la solitude et la fuite hors du monde humain. Il se détourne des interactions sociales pour trouver refuge dans la contemplation de la nature, notamment le silence des animaux. « Le mutisme des animaux me repose du caquet, du bavardage infini des gens qui n’ont pas d’idées sur le monde. » Ce contraste entre le bruit vide des conversations humaines et la paix silencieuse des oiseaux illustre son désir de pureté et d’authenticité. Le désenchantement s’étend également aux débats intellectuels, notamment avec son ami Jacques. Les discussions, qui autrefois l’animaient, deviennent des redites stériles. Les idées circulent comme des copies sans fin, toujours semblables, répétées « jusqu’à la nausée ». Ce constat alimente une critique plus générale : la pauvreté intellectuelle de l’époque, où la parole ne sert plus à réfléchir mais à répéter. La conversation humaine elle-même, autrefois source de plaisir, lui paraît désormais piégée. « Moi qui ai tant aimé la conversation humaine, la dispute, j’en ai perdu le goût. » Les discussions ne sont plus des échanges d’idées mais des arènes de stigmatisation, où l’on enferme son interlocuteur dans des étiquettes infamantes : « sexiste, ringard, fasciste, intolérable ». Le narrateur dénonce ainsi une forme de tribunal permanent, où les mots deviennent des armes de disqualification. Cette fuite du monde humain exprime une volonté de se protéger de la médiocrité ambiante, mais elle signe aussi un isolement grandissant. Le narrateur s’éloigne de ses semblables au point de se réfugier dans une solitude qui frôle la misanthropie. 3. La critique du féminisme contemporain et de l’inégalité homme-femme Un autre pan central du roman réside dans la critique du féminisme contemporain, perçu par le narrateur comme idéologique, dogmatique et déconnecté de la réalité. Cette critique passe d’abord par la question du langage. Lorsque Doriane l’accuse de « sexisme lexical » pour avoir qualifié certaines femmes de « mégères », il conteste l’idée même que certains mots devraient être bannis. À ses yeux, si le mot existe, c’est qu’il correspond à une réalité. Effacer le mot reviendrait à nier l’existence du comportement qu’il désigne. Il dénonce ici une volonté de réécrire le langage, donc la réalité, pour la conformer à une vision idéologique. Le narrateur attaque aussi l’image idéalisée des femmes dans les médias contemporains. Selon lui, un extraterrestre qui observerait la Terre à travers les discours médiatiques croirait que les femmes et les hommes appartiennent à deux espèces différentes, l’une naturellement douce et supérieure, l’autre brutale et ignoble. Cette caricature illustre ce qu’il perçoit comme une inversion des stéréotypes : la glorification systématique de la femme au détriment de l’homme. Les tensions apparaissent aussi dans la vie de couple. Doriane, influencée selon lui par ses amies Sabrina et Nadège et par des théories universitaires féministes, se sent « oppressée » malgré le fait qu’elle décide de presque tout dans leur famille. Le narrateur y voit un paradoxe et dénonce « le poison des bonnes copines », une intoxication idéologique qui détruit les relations. Un épisode marquant est celui où Sabrina affirme que la minceur comme critère de beauté est une construction patriarcale. À ses yeux, la domination masculine aurait imposé les standards esthétiques. Le narrateur tourne en dérision ce raisonnement, soulignant qu’il n’est jamais question d’appliquer ces critiques aux préférences féminines envers les hommes. D’où son ironique proposition d’un manifeste appelant les femmes à « coucher avec des gros lards, des chevelus, des malingres, des bigleux », afin de réellement combattre les stéréotypes et, prétend-il, faire trembler le capitalisme. Par ces sarcasmes, Patrice Jean met en lumière les excès d’un discours féministe qui, selon son narrateur, produit de nouvelles injustices tout en prétendant abolir les anciennes. 4. La critique de la culture de masse et de l’effort intellectuel La réflexion se poursuit avec une critique de la culture de masse et du rejet de l’effort intellectuel dans la société contemporaine. La lecture, jadis acte noble et exigeant, est désormais perçue comme une corvée. Le narrateur constate que tout est facilité, simplifié, transformé en divertissement immédiat. La littérature, elle, demande un effort que plus personne ne veut consentir. Son propre fils, Simon, incarne cette évolution : il se désintéresse totalement de la littérature, y compris de celle de son père. Il préfère Netflix, symbole d’une culture standardisée, où chaque génération consomme un produit calibré pour elle. Cette fragmentation culturelle détruit l’unité familiale : autrefois, on partageait les mêmes récits ; aujourd’hui, chaque âge, chaque individu, est isolé dans sa consommation médiatique. Le narrateur y voit la main du capitalisme, qui segmente les publics pour mieux les contrôler et les enfermer. Lui-même n’est pas indemne de compromissions. Ancien marxiste, il a tenté d’introduire un personnage optimiste dans son roman pour séduire les lecteurs, mais a fini par le supprimer, convaincu que « l’être humain n’est pas bon ». Sa vision de la littérature se veut radicale : le romancier ne doit pas lutter contre les injustices sociales, mais décrire le réel sans illusions. Il dénonce également la trahison de ses anciens camarades communistes, désormais fascinés par la culture américaine, de Netflix à Tarantino. Leur corps est en France, dit-il, mais leur esprit est aux États-Unis. D’où son rappel marxiste : la culture capitaliste, loin de libérer, est un nouvel opium du peuple, une distraction qui neutralise la révolte. La critique de la culture de masse dans le roman dépasse la simple nostalgie : elle pose la question de savoir si une culture véritablement émancipatrice est encore possible dans un monde dominé par l’industrie culturelle. 5. Le théâtre comme métaphore d’une vie inauthentique Le théâtre occupe une place symbolique dans le texte, servant de métaphore de l’inauthenticité des relations sociales. Le narrateur exprime son dégoût du théâtre, qu’il accuse de cultiver l’artifice et la fausseté. Les « classiques revisités », les mises en scène engagées lui apparaissent comme des impostures, des caricatures prétentieuses d’authenticité. À ses yeux, la vie quotidienne, même banale, possède plus de vérité que ces représentations fabriquées. Cette hostilité au théâtre s’étend à la vie elle-même. Quand il prépare un entretien avec son directeur, il compare la scène qu’il va jouer à une pièce de théâtre. Chacun récite son rôle, répète ses arguments : « Tout dans nos vies est comédie. » Le théâtre sert donc de miroir à l’existence sociale, où chacun porte un masque, joue un rôle, se livre à des mensonges de civilité. L’artifice scénique n’est que la transposition visible de l’artifice social. Même la critique théâtrale se réduit au simulacre. Conseillé par son mentor Lombard, le narrateur adopte une paresse assumée : pourquoi travailler quand la majorité du public lit en diagonale et oublie tout le lendemain ? Le cynisme devient la règle, et les erreurs grossières passent inaperçues. Cette indifférence généralisée achève de discréditer le spectacle vivant, réduit à une industrie de l’oubli. Ainsi, le théâtre n’est pas seulement critiqué comme institution culturelle, mais utilisé comme symbole : celui d’une vie où rien n’est authentique, où tout est jeu et masque. 6. La lassitude existentielle et le désir de disparaître Enfin, le roman se conclut sur une tonalité sombre, marquée par la lassitude existentielle et le désir d’échapper à soi-même. Lors de ses insomnies, le narrateur est assailli par des pensées noires : « Pourquoi continuer ? Qu’attends-tu de la suite ? Ta jeunesse est derrière toi ! Toute vie est un échec ! » Ce discours intérieur traduit une conscience aiguë de l’échec et du vieillissement. Il rêve de disparaître, de changer d’identité, de laisser derrière lui « la peau de Jean Dulac ». C’est le fantasme d’une délivrance, d’un effacement des rôles joués et des mensonges accumulés. Sa vie amoureuse elle-même apparaît comme une capitulation. Après des années de libertinage et de refus des attaches, il finit par se mettre en couple avec Doriane, non par conviction mais par fatigue de la solitude. L’amour n’est plus une promesse de bonheur, mais un compromis résigné. Même sa foi révolutionnaire, jadis fervente, se délite avec l’âge. Ses sarcasmes politiques n’empêchent pas une désillusion profonde : « Le voile des illusions s’est déchiré : il n’y a pas de vie heureuse derrière ! » La lassitude existentielle devient alors le véritable spectre qui hante le narrateur. Tout ce qu’il critique – hypocrisie, idéologie, culture de masse, théâtre – se retourne contre lui et nourrit son sentiment d’échec. Il est lui-même un spectre, prisonnier de la comédie sociale qu’il dénonce. Conclusion La vie des Spectres de Patrice Jean est un roman de la désillusion. À travers le regard cynique de son narrateur, l’ouvrage dresse un tableau sombre de la société contemporaine : une société d’hypocrisie, de prévisibilité, de bavardage vide, d’idéologies féministes jugées excessives, de culture de masse standardisée, et de spectacles artificiels. Le narrateur, en quête d’authenticité, ne trouve refuge que dans la solitude et la contemplation. Mais cette fuite l’isole et l’enferme dans une spirale de lassitude, où la vie apparaît comme une comédie épuisante et vaine. Sa critique du monde se transforme en miroir de son propre désespoir. En ce sens, le roman ne se contente pas d’une satire sociale : il met en scène le drame intime d’un homme prisonnier de ses contradictions, incapable de croire encore en une possibilité de bonheur ou de vérité. Le spectre, c’est lui-même, hantant une société qu’il rejette sans parvenir à la quitter.
Spitfire89
• Il y a 6 mois
Sélectionner parmi la liste du Prix Renaudot 2024, la vie des spectres est une oeuvre grinçante, ironique, déroutant et audacieux. La chute de Jean, père de famille et journaliste, un homme désabusé, surnuméraire, inattendu, qui se joue des idéologies, des clichés. Une grande question de fond, une vision démontant le militantisme. De l'humours, une bonne découverte.
CindyLandes
• Il y a 6 mois
J’ai beaucoup aimé l’écriture de cet auteur que je découvre avec ce roman. Le ton est grinçant et cynique, son humour satirique m’a parfois fait rire aux éclats. Je trouvais rafraîchissant qu’avec ce roman, on se joue des idéologies et courants de pensée sur lesquels nous ne pouvons plus discuter. Il faut suivre la vague, au risque d’être persécutés. L’auteur ose porter un regard critique sur notre époque, sur notre société. Il le fait souvent de manière absurde, avec parfois des personnages caricaturaux, ce qui donne une certaine légèreté à travers les sujets parfois un peu lourds. C’est un livre un peu difficile à recommander, parce qu’il n’a pas ce côté « divertissant » que je recherche habituellement avec mes lectures. Disons que j’ai préféré les réflexions qu’il soulève à l’histoire en elle-même. C’est la raison pour laquelle mon intérêt s’est un peu essoufflé en cours de lecture, j’avais hâte de le terminer pour retrouver le confort de mes romans qui me permettent de m’évader et me divertir.
Avis des membres
Fiche technique du livre
-
- Genres
- Romans , Roman Français
-
- EAN
- 9782749179650
-
- Collection ou Série
-
- Format
- Grand format
-
- Nombre de pages
- 464
-
- Dimensions
- 212 x 143 mm
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers où les mots s'animent et où les histoires prennent vie. Que vous soyez à la recherche d'un roman poignant, d'une intrigue palpitante ou d'un voyage littéraire inoubliable, vous trouverez ici une vaste sélection de livres qui combleront toutes vos envies de lecture.
22,50 € Grand format 464 pages