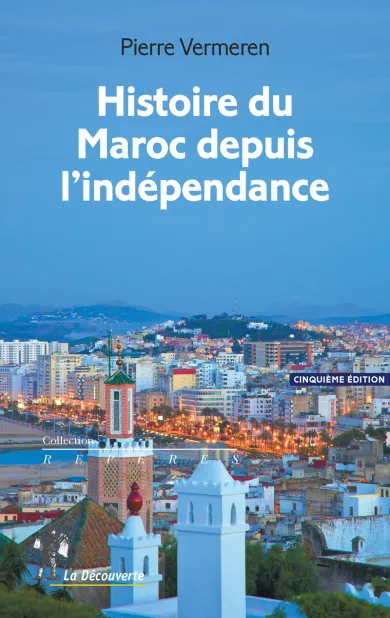Histoire du Maroc depuis l'indépendance : Le livre de Pierre Vermeren
Le 2 mars 1956, le Maroc recouvre son indépendance, après quarante-quatre années de protectorat. De 1956 à 1961, Mohammed V restaure la puissance de son trône, rendant possible le règne de son fi ls Hassan II (1961-1999), qui consolide l'intégrité territoriale du pays. En 1965, Ben Barka paye de sa vie son opposition au régime, mais l'instabilité persiste et culmine lors des coups d'État de 1971 et 1972. Hassan II reconstruit alors un pouvoir ébranlé par le consensus autour de la récupération du Sahara, mais au prix des " années de plomb ". Après 1991, le Maroc s'engage dans un processus d'ouverture à petits pas qui conduit à l'alternance de 1998.
L'avènement de Mohammed VI en 1999 précipite une transition aux exigences contradictoires : dissocier monarchie et " années de plomb ", incorporer les islamistes au champ politique, améliorer la gouvernance tout en contenant la menace terroriste... Mais tout se précipite au rythme des événements de l'histoire : les attentats de 2003, qui relancent l'hypothèque autoritaire, puis les printemps arabes de 2011, qui placent la monarchie au pied du mur : réformer à chaud pour sauver l'essentiel.
De (auteur) : Pierre Vermeren
Expérience de lecture
Avis Babelio
Enroute
• Il y a 2 mois
À la lecture de cette petite histoire, dense, du Maroc moderne, c’est la monarchie qui maintient l’ordre social après l’indépendance – et cela ne se fait pas sans heurts. Depuis que la dissidence et l’armée ont été mises sous contrôle, c’est l’économie (par le libéralisme et l’ouverture internationale) qui fait l’objet d’un traitement spécifique. Sont en cours de traitement, aujourd’hui, l’intégration de mesures sociales, la démocratisation, la fixation définitive des frontières (sud Sahara). Depuis quelques décennies, l’islamisme point comme un nouvel obstacle à surmonter. ************************ Au XIXè siècle, le sultan du Makhzen (plateau centrale et plaines atlantiques) n’a autorité que sur une quarantaine de ville, dont la capitale, la plus grande, Fès (80 000 habitants). Le reste de la population, l’essentiel des 5 millions d’habitants, sont des tribus berbères indépendantes. Les difficultés financières et l’anarchie s’installent. L’empire français intervient. Le traité de protectorat (de Fès) est signé en 1912 par le sultan alaouite Abdelhafid, qui abdique. Il faut cependant 22 ans et une armée française de 800 000 hommes pour faire reconnaître l’autorité du sultan à l’ensemble de la population. C’est la « guerre du Rif ». Elle agonise après la reddition d’Abdelkrim en 1926 et s’achève en 1934 avec l’intégration des dernières tribus, celle de l’Anti-Atlas, au sud. La guerre du rif aurait fait au moins 27 000 morts côté français, auxquels doivent s’ajouter des milliers d’Espagnols. Le sultan est désormais, pour 15 ans, le frère d’Abdelhafid, Moulay Youssef. La capitale est déplacée à Rabat. Lui succède, en 1927, son troisième fils, Sidi Mohammed : Mohammed V. Par le Dahir berbère de 1930, il est acté que le sceau du sultan convertira les décisions du protectorat en décret (dahir) qui auront force de loi. Cet événement choque et provoque les premiers remous. Le nationalisme marocain sera mené par les Jeunes Marocains, organisés sur le modèle des Jeunes Turcs, et les salafistes des mosquées. Le protectorat fait venir des investissements dans la capitale économique, Casablanca. Sous le protectorat, l’industrie progresse modérément (15% du PIB à la fin et 34% pour l’agriculture). Les terrains agricoles sont très inégalement répartis. L’immigration de France, d’Algérie, d’Espagne et de Tunisie est importante (500k+ sur moins de 10 millions d’habitants). Les Français du Maroc sont en moyenne 30% plus aisés que ceux de France, tandis que ceux d’Algérie le sont moins de 10%. Le parti de l’indépendance (Istiqlâl) est créé en 1944 par Fassi (ouléma), Balafrej (Jeune Marocain et futur politicien). L’indépendance est réclamée dès 1947. Mais Paris veut au contraire renforcer le protectorat. Une lutte s’engage. Le sultan fait la « grève du sceau ». Plus aucun décret ne passe. Il réitère ses déclarations indépendantistes en 1952 tandis que l’assassinat d’un syndicaliste justifie le démantèlement par les Français de l’Istiqlâl. Le protectorat peut compter sur l’opposition au sultan, celle du pacha Glaoui et des confréries religieuses. Par la force, ensemble, ils destituent le sultan, qui est exilé. Cela renforce l’indépendantisme des villes. 6 000 attentats font 800 morts (Marocains et Européens). L’indépendance est signée fin 1955. Le sultan Mohammed V peut revenir de Madagascar où il vivait en exil. Mais il est contesté. À son service, il crée, en 1956, les Forces armées royales (FAR) en intégrant des soldats de l’ALM (armée de libération marocaine). 80 000 soldats français se trouvent encore au Maroc et les intérêts financiers de la métropole sont défendus ardemment. Contre eux deux, l’Istiqlâl que vient de rejoindre Mehdi Ben Barka, aligne 1 million de membres. Mohammed V doit les intégrer à son gouvernement. Les règlements de compte et coups fourrés sont légion. L’ALM, au service de l’Istiqlâl, est vaincue par la France et l’Espagne au sud du Maroc, où elle avait des volontés de prendre la Mauritanie, qui, en 58, devient indépendante. L’Istiqlâl est désarmée. Mais les élections approchent. Depuis 57, Mohammed V n’est plus sultan, mais roi. Pour calmer une insurrection au sud, le « Palais » soutient, Ibrahim, un syndicaliste. La gauche de l’Istiqlâl fait sécession et, en 59, créée l’UNFP (Union nationale des Forces populaires). Cette année-là aussi est fondée l’université Mohammed V à Rabat. Le retrait des capitaux étrangers depuis l’indépendance et la sortie de la zone Franc en 58 (création du dirham), auxquels se soustraient encore l’arrêt des transferts du protectorat, l’insurrection au sud, qui reprend, l’insatisfaction des réformes agraires et le séisme d’Agadir, qui détruit la ville, forcent un plan quinquennal. Il est mis en place de 60 à 1964, juste à temps avant qu’Hassan II, à 32 ans, en 61, monte sur le trône et tandis que l’Istiqlâl gagne les élections. L’UNPF et l’Istiqlâl réclament une constitution : ce sera une loi fondamentale qui institue le roi « Commandeur des croyants », sans séparation des pouvoirs, qu’il délègue. Par référendum, elle est adopté à 84% des inscrits. Le Maroc, en 63, devient une monarchie constitutionnelle. Camouflet pour l’Istiqlâl, décrédibilisé. Un point partout : quatre mois plus tard, l’Istiqläl/UNFP remportent les élections, laissant les partis contrôlés par le Palais loin derrière. Règlements de compte, complots, le Maroc est agité, l’armée se renforce ; une insurrection étudiante est maté dans le sang en 1965 et l’État d’exception est déclaré donnant au roi des pouvoirs… exceptionnels. Ben Barka disparaît à Paris où il aurait été enlevé, torturé et tué puis exfiltré dans… un avion militaire marocain. L’affaire éventée, le Maroc est humilié. Paris s’insurge. Oufkir, leader des forces armées, est condamné à perpétuité par contumace en France. Les révoltes étudiantes se poursuivent, le prix du phosphate, dont le pays est le 1er exportateur mondial, en hausse alimente le pays… qui s’endette néanmoins en accroissant ses achats d’équipements. La corruption sévit. En 71, Hassan II échappe à un attentat au Palais royal de Skhirat, attaqué. On compte 60 morts. Les présumés responsables sont envoyés au bagne. Deuxième attentat en 72 : des avions de l’armée marocaine attaquent le boeing présidentiel… en vain. La baraka est encore du côté d’Hassan II qui atterrit sain et sauf. Oufkir, le fomenteur contre Ben Barka est retrouvé « suicidé ». Peine de prison et de condamnation à mort. 2 attentats en 2 ans. La monarchie se résout à des concessions prochaines. Dlimi qui était dans l’avion devient le fidèle du roi. Pour mater les révoltes universitaires, les étudiants sont arrêtés par vague jusqu’en 1976. Le département français de philosophie est fermé. En 73, l’histoire et les sciences humaines et, en 77, tout le cycle primaire et secondaire, sont arabisées. Un département d’étude islamique ouvre en 78. Durant ce temps, les prix du phosphate grimpent à nouveau… comme les achats : la dette représente 100% du PIB en 78. Et depuis 73, le front de libération du Sahara occidental (Polisario) se soulève contre l’occupant espagnol franquiste. Un référendum d’autodétermination doit avoir lieu. Hassan II le comprend comme un rattachement imminent du territoire au Maroc… Pour l’obtenir, l’idée est la suivante : une marche pacifique de l’autre côté de la frontière. Acheminés en camion, 350 000 marcheurs, dont le roi, font quelques kilomètres à pied dans le Sahara occidental. Après trois jours, la démonstration est faite, le roi rentre. Franco meurt les semaines suivantes, Juan Carlos admet la démonstration. Il retire les troupes espagnoles. Un accord est signé : la moitié nord au Maroc, le sud à la Mauritanie – pas d’indépendance pour le Polisario, et rien pour l’Algérie, furieuse. Le Polisario prend l’initiative et attaque Nouakchott, le Maroc intervient : plus de 6 000 morts dans la bataille. La Maurétanie abandonne sa part – reprise par le Maroc. L’Algérie conteste toujours. 15 000 soldats s’affrontent, à coup de mirage. C’est qu’il y a du phosphate dans le coin. En 82, ce n’est toujours pas fini. Sècheresse, émeutes à Casablanca, crise pétrolière, hausse du dollar : l’endettement passe à 150% et le déficit à 18%. L’analphabétisme est de 50% et le chômage à 20%. Viennent les « années de plomb ». La parole n’est plus la bienvenue. Le Maroc libéralise toutefois : baisse des taux de douanes, réforme du système financier, adhésion au GATT. En 85, Jean-Paul II est en visite à Casablanca. En 87, le Maroc dépose une candidature d’adhésion à la CEE – qui sera refusée au motif que le pays n’est pas en Europe. En 88, les relations s’améliorent avec l’Algérie et l’Union du Maghreb arabe (UMA) est fondée en 89. Suite à la révolution d’Iran, l’intégrisme islamiste continue de progresser dans le monde et au Maroc et des organisations pour la défense des droits de l’homme sont créées. Un livre « Notre ami le roi » est très critique sur ce sujet. Il blesse et provoque la pire crise diplomatique entre la France et le Maroc depuis l’affaire Ben Barka. Mais la parole s’ouvre, c’est la fin des « années de plomb ». Dix ans après sa création en 81, peut-être pour enquiquiner les communistes, la Jamaa islamiya a grossi. Elle forme désormais la matrice d’un islamisme (réformiste). À l’occasion d’une manifestation d’un million de personnes à Casablanca, les islamistes défilent en blanc. Ils révèlent au pouvoir une présence plus importante – et menaçante – que supputée. Une quatrième constitution est adoptée en 1993 qui mentionne les droits de l’homme. C’est l’année de l’achèvement de la Grande Mosquée de Casablanca, démarrée cinq ans plus tôt et largement payée par souscription. Elle a fait travailler Bouygues et 10 000 artisans ancestraux : « Les motivations de cette construction sont assez floues ». L’un des quatre commandos qui pénètrent au Maroc en 93 atteint son objectif d’attentat à Marrakech. « En quarante-huit heures, des centaines de milliers d’Algériens ou assimilés […] sont expulsés dans la plus grande confusion ». 1 million de personnes au total quittent le pays. Les frontières avec l’Algérie sont fermées. Des gouvernements « technocratiques » se succèdent. En 95, Hassan II est malade. Financièrement, c’est la crise. Il prépare sa succession. Une nouvelle réforme constitutionnelle est validée en 96 qui instaure deux chambres parlementaires et l’élection de la totalité des membres (non seulement les 2/3 comme alors) au suffrage universel direct de la première. Un dernier gouvernement est constitué en 98. Hassan II décède en 99. Mohammed VI lui succède. Le poids des années de plomb pèse toujours et met la population à distance. L’islamisme progresse encore dans les années 2000. Ils sont 40 députés du PJD au parlement. Signe de l’islamisation, l’abstentionnisme grimpe. Maintenant, les frères musulmans et le wahhabisme saoudiens « se sont peu à peu emparés du champ idéologique et culturel de l’islam marocain. » : « en 2002, les autorités découvrent avec effroi que plus de la moitié des lieux de culte marocains sont aux mains des prédicateurs wahhabites. ». Avec cela, des attentats ont lieu à Casablanca en 2003. Un nouveau parti, le PAM (Parti de l’authenticité et de la modernité), au service du roi, entend rassembler les voix. M’Daghri, ministre des habbous (de l’islam officiel), jugé complaisant avec le wahhabisme, est remplacé par l’historien Taoufik avec pour mission de reprendre la main sur les oulémas, les dizaines de milliers de mosquées : contrôle des imams, de leur formation, vérification de la conformité des prêches du vendredi, de l’instruction islamique à l’école, application du monopole des fatwas par le « Commandeur » (le roi). Sachant qu’en parallèle, le gouvernement légalise la vente d’alcool, favorise le tourisme, les divertissements, les loisirs, les médias. Économiquement, il s’agit de relancer la croissance : réformes budgétaires, attraction des investissements étrangers (français), lutte contre la corruption, restructuration du capitalisme marocain, etc. comme le tourisme, « En dix-sept ans, le PIB est presque multiplié par trois en nominal quand celui de la France augmente de 50% ». Mais les mesures sociales sont absentes (sécurité sociale, instruction, institut royal de la culture…). Et la mondialisation déstabilise, comme partout ailleurs… En 2011, à l’occasion des printemps arabes, 350 000 personnes manifestent dans le pays. Sous pression, une nouvelle constitution est rédigée et rapidement votée à 98%, sans grands changements pourtant. Le PJD islamiste de Benkirane remporte les élections et occupe ¼ des sièges de l’assemblée en 2011 et réitère en 2015. En 2016, la crise du sud Sahara revient. Le livre s’arrête ici.
Avis des membres
Fiche technique du livre
-
- Genres
- Sciences Humaines & Savoirs , Histoire
-
- EAN
- 9782707190659
-
- Collection ou Série
- Repères
-
- Format
- Poche
-
- Nombre de pages
- 128
-
- Dimensions
- 191 x 120 mm
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers où les mots s'animent et où les histoires prennent vie. Que vous soyez à la recherche d'un roman poignant, d'une intrigue palpitante ou d'un voyage littéraire inoubliable, vous trouverez ici une vaste sélection de livres qui combleront toutes vos envies de lecture.
11,00 € Poche 128 pages