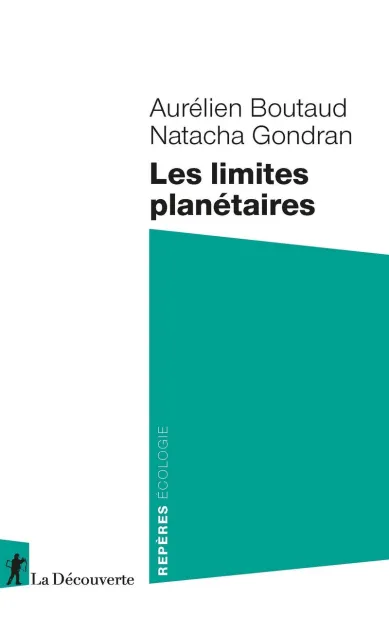Les limites planétaires : Le livre de Aurélien Boutaud, Natacha Gondran
La question des limites environnementales a traversé les XIXe et XXe siècles sans vraiment parvenir à s'imposer. La donne serait-elle en train de changer en ce début de XXIe siècle ? Face à la multiplication des atteintes portées au " système Terre ", la communauté scientifique s'est lancée depuis quelques années dans un projet aussi urgent qu'ambitieux : proposer aux décideurs et au grand public un aperçu des principales variables qui déterminent l'équilibre des écosystèmes à l'échelle planétaire. Au-delà du climat et de la biodiversité, ces travaux abordent également des questions moins connues du grand public, comme le déséquilibre des cycles biogéochimiques, le changement d'affectation des sols, l'introduction de polluants d'origine anthropique dans les écosystèmes ou encore l'acidification des océans. Autant d'enjeux pour lesquels la communauté scientifique essaie aujourd'hui de déterminer des frontières à ne pas dépasser si l'humanité veut éviter les risques d'effondrement.
De (auteur) : Aurélien Boutaud, Natacha Gondran
Expérience de lecture
Avis des libraires
Avis Babelio
loeil_de_poups
• Il y a 1 an
Dense, érudit, clair et précis, cet ouvrage de synthèse énonce et explique avec une très grande rigueur les limites planétaires telles que définies par la communauté scientifique au début du XXI siècle. Outre le changement climatique, dont les auteurs ont l'excellente idée de rappeler qu'il faisait déjà l'objet d'alertes à la fin du XIXe siècle et durant tout le XXe siècle, ces limites recouvrent la capacité de régulation du "système Terre" et sa résilience : il en va ainsi de l'acidification des océans, de la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote, du phosphore et de l'eau, de l'effondrement de la biodiversité, des polluants organiques permanents ou encore de la transformation des sols. Sans passer sous silence les débats scientifiques autour de cette notion de "limite planétaire", dont la définition et la fixation des variables de contrôle oscillent selon les études, ce remarquable précis scientifique offre matière à penser - et plus encore, à s'alarmer - face aux conséquences des activités humaines sur le vivant et les sphères qui forment notre seul cadre de vie possible. L'Anthropocène est devenu notre ère. Lueur d'espoir ? Face à l'inquiétante disparition de la couche d'ozone, les pouvoirs publics et les négociations internationales ont porté leur fruit. Mais face au changement climatique, rien n'est moins sûr. Le livre se clôt sur l'impact de l'agriculture et de la consommation alimentaire sur le système Terre, appelant à des transformations profondes de nos modes de production, de notre alimentation, mais aussi de notre manière d'envisager l'économie pour aboutir à un monde vivable. Toutefois, ce n'est pas qu'un essai écologique, puisque les auteurs rappellent à juste titre que la question sociale doit être incluse dans les actions en faveur du climat et de la biodiversité. Car c'est aussi la quête de sociétés plus équitables, où la pauvreté doit être éradiquée et les droits fondamentaux garantis, qui doit gouverner l'action publique. On ressort de cette lecture aussi convaincu de la nécessité d'agir urgemment qu'assez pessimiste quant au chemin emprunté jusqu'à présent. L'avenir qui se dessine ressemble peu à un bel équilibre entre le respect du vivant et la justice sociale ; pourtant, n'est-ce pas là un horizon à viser encore et encore ?
Arthemyce
• Il y a 3 ans
Un peu moins de 110 pages, mais une extrême densité pour ce petit livre de poche. Comme souvent, la collection « Repères » ne déçoit pas avec un contenu de qualité bien que synthétique. Il sera question dans cet ouvrage des « Limites Planétaires », c'est-à-dire, pour faire cours, des capacités de notre planète à réguler l'équilibre dynamique du « système Terre ». En ouverture, les auteurs proposent un historique rapide de la notion de limite planétaire par le prisme de l'Économie. Ils mettent en évidence que la question des ressources (et des impacts de l'activité humaine) a longtemps été négligée des principaux courant de l'Économie et des politiques induites. A l'époque du développement de ce nouveau champs d'étude, contemporain de la révolution industrielle, « la nature apparait aux observateurs comme largement inépuisable et inaltérable ». On évoque Malthus, un des premiers à s'interroger sur la durabilité du développement humain, en comparant les croissances – selon lui respectivement géométrique et algébriques – de la population et des ressources. Les solutions qu'il préconise sont cependant discutables et, encore aujourd'hui, la référence au « Malthusianisme » en porte les stigmates. Pour ses opposants, le problème n'est pas la rareté ou la finitude des ressources, mais les limites techniques et humaines visant leur exploitation. Hormis des pénuries locales et temporaires, l'Histoire donnera plutôt raison à ces derniers, la population s'étant accru en parallèle des ressources disponibles. Cette idéologie, dite « cornucopienne » – le fait de repousser indéfiniment les limites de la nature – restera la norme dans la plupart des travaux économiques jusqu'à l'aube des années 1970, période de la fin des Trente Glorieuses ayant accueilli la publication, en 1972, du célèbre « Limits To Growth » (Les Limites de la Croissance) de Denis MEADOWS et son équipe. C'est l'occasion pour des économistes peu orthodoxes comme Georgescu-Roegen (parmi d'autres) de voir leur intuition confirmée, tandis que les économistes dominants s'enferment dans le paradigme impliquant nécessairement que les limites puissent être dépassées. La première concrétisation de ces réflexions est apparue la décennie suivante, avec la mise en évidence d'un trou dans la couche d'ozone, résultant d'émissions anthropiques massives de gaz chlorés pouvant avoir des effets « catastrophiques, allant jusqu'à menacer directement la vie sur Terre ». le Protocole de Montréal aura rapidement donné des résultats, toutefois les auteurs soulignent qu'en aucun cas le parallèle puisse être fait avec le réchauffement climatique : il existait alors des alternatives aux substances incriminées et de surcroît, les secteurs concernés étaient circonscrits ; ce qui n'est absolument pas le cas concernant le CO2. Cet élan mondial aura eu le bénéfice de permettre d'établir le lien entre limites planétaires et régulation écologique, là où les ressources étaient jusqu'alors l'objet dominant. Finalement, c'est au tournant du XXIème siècle qu'apparait le concept d'anthropocène : « homo sapiens est devenu le principal facteur de modification des équilibres écologiques à l'échelle planétaire […] ». le terme a depuis fait largement débat, concernant notamment la généralisation implicite d'un mode de vie particulier, attribué abusivement à une humanité essentialisée, ainsi que la responsabilité non différenciée qui en découle. Comme pour enfoncer le clou, en 2004 est publié un article (1) qui fera date, dont on retiendra notamment la « Grande Accélération » (2), ensemble de graphes témoignant de la croissance exponentielle de l'exploitation des ressources et des pollutions connexes. [...] Résumé détaillé : https://docdro.id/RnTRwCN En guise de conclusion, les auteurs insistent sur la nécessité d'intensifier la recherche bien qu'ils constatent « un engouement scientifique indéniable » mais regrettent le manque d'actions politiques conséquentes. Si au niveau mondial et national, en France, les discours officiels intègrent de plus en plus la notion de limites planétaires, « la mise en acte tarde à être entreprise ». Les inégalités environnementales et socio-économiques sont pointées du doigt et obligent à revoir la répartition non seulement des richesses, mais aussi des « capacités limitées de la Terre à fournir des ressources et des services ». (1) Version 2015 : doi:10.1177/2053019614564785 (2) https://www.researchgate.net/figure/The-Great-Acceleration-Steffen-et-al-2015b_fig5_326295135
murielB34
• Il y a 4 ans
cet essai nous propose un état des lieux de notre planète en partant du concept de limites planétaires (en gros les limites ce que notre planète est en capacité de supporter avant de basculer dans un déséquilibre complet du climat, de la biodiversité, de l'état des sols, ...). Il le fait de façon simple mais pas simpliste, avec pédagogie, en partant de faits scientifiques qui font consensus ; en indiquant aussi les limites de l'exercice en lui-même sur certains sujets particulièrement complexes (donc difficiles à modéliser), ou pour lesquels les connaissances scientifiques sont actuellement trop faibles. un essai à mettre entre toutes les mains, car la situation est grave, très grave !
Impression-de-lecteur
• Il y a 4 ans
Un livre qui démontre le temps long de l'écologie et qui tâche de l’amarrer au temps court des décisions politiques. Aujourd'hui, en cette période qualifiée d'anthropocène, les scientifiques par leurs travaux sur les limites planétaires veulent aider les politiques dans leurs décisions. Le concept de " limites planétaires" n'aborde plus le stock de ressources en matières premières comme seul élément limitatif au développent humain mais cherche à mesurer les capacités de la nature à réguler les activités humaines. D'abord, il s'agit d'identifier les processus qui ont permit de conserver la stabilité du système terre (rétroactions positives ou négatives) durant l’holocène (10 000 ans). Ensuite, il s'agit, à partir de 1750, d identifier les phénomènes anthropiques et leurs conséquences sur la nature ainsi que sa capacité à les réguler. Enfin, les chercheurs modélisent (variable de contrôle ; variable de réponse) les 9 processus environnementaux devant faire l'objet d'une surveillance particulière. Certains sont définis comme éléments de rupture c'est à dire dont les impacts sont planétaires comme l'acidification des océans : phénomène irréversible pour des dizaines de milliers d'années, qui a des effets négatifs sur la chaîne alimentaire, qui participe au réchauffement climatique et qui compromet la protection des littoraux ; d'autres agissent sur la résilience du système terre et ont des impacts locaux comme le changement d'affectation des sols, la déforestation. Aujourd'hui, en cette période de pandémie, la déforestation a des conséquences planétaires. La vérité de la science réside en ce qu'elle peut toujours être remise en question pour autant gardons-nous de minorer ses conclusions ni d'y croire aveuglement.
Avis des membres
Fiche technique du livre
-
- Genres
- Classiques et Littérature , Essais
-
- EAN
- 9782348046230
-
- Collection ou Série
- Repères
-
- Format
- Poche
-
- Nombre de pages
- 128
-
- Dimensions
- 191 x 121 mm
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers où les mots s'animent et où les histoires prennent vie. Que vous soyez à la recherche d'un roman poignant, d'une intrigue palpitante ou d'un voyage littéraire inoubliable, vous trouverez ici une vaste sélection de livres qui combleront toutes vos envies de lecture.
11,00 € Poche 128 pages