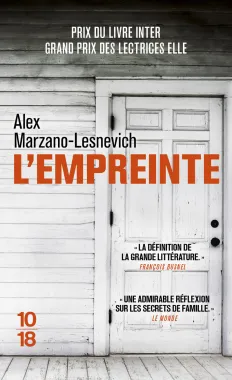Quand la lumière décline : Le livre de Eugen Ruge
Berlin, 2001. Incurable. Suite à ce diagnostic, Alexander part au Mexique, un rêve d'enfant nourri par les récits nostalgiques de sa grand-mère. Pourtant, en 1952, celle-ci a tout fait pour mettre fin à son exil et rentrer participer à la construction de l'État socialiste en Allemagne.
Le père d'Alexander aussi est revenu plein d'espoir de Sibérie, avec son épouse russe qui ne maîtrisera jamais la langue de Goethe et sa belle-mère qui ne se défera pas de ses bocaux de cornichons.
Alexander, lui, se sent vite à l'étroit en RDA. Jusqu'à la fête célébrant les 90 ans du patriarche communiste, alors que le Mur est sur le point de s'effondrer, ou tous ces destins vont se croiser, s'affronter, se rencontrer ou se séparer...
De Mexico à Berlin en passant par Moscou, les voix de quatre générations s'entremêlent pour dire l'histoire d'un monde, d'une famille, d'une vie, quand la lumière des idéaux décline.
De (auteur) : Eugen Ruge
Traduit par : Pierre Deshusses
Avis Babelio
horline
• Il y a 3 semaines
L'auteur allemand appartient à cette génération qui a assisté à l'édification du Mur de Berlin puis à son effondrement, il a connu les sursauts de répression de Budapest, de Prague et de Tian'Anmen mais Quand la lumière décline paru en 2011 n'est pas un roman rétrospectif sur la RDA qu'il a fui en 1988. Il aborde ces années sous la forme d'une grande fresque familiale est-allemande dans laquelle il y a bien sûr la mécanique inexorable du temps avec la jeunesse des uns et la vieillesse des autres. On est tenté de dire qu'à travers les portraits, Eugen Ruge dévoile une histoire dans laquelle se reflète celle du pays. Mais l'angle choisi pour la narration est surprenant. Recourant à des tableaux confidentiels, saisissant sur le vif les membres de cette famille aux apparences bourgeoises, l'auteur complexifie judicieusement le tableau traditionnellement dépeint de la RDA avec son cortège d'espérances trahies et d'attentes déçues en l'enracinant dans la géométrie des problèmes familiaux des Umnitzer. Les efforts pour dissimuler les troubles intérieurs, la difficulté à se conformer à la légende du patriarche qui n'a jamais su se défaire de son allégeance à Moscou, ou la paralysie la sidération de son entourage dont les individualités prennent de plus en plus de place... à travers des ratés significatifs qui débordent de détails, c'est par la voie intimiste qu'Eugen Ruge a choisi d'atteindre la dimension politique. Les difficultés relationnelles dominent et agissent comme un bain révélateur, laissant de plus en plus de place au sentiment d'accablante et interminable défaite pour la plupart des membres de cette famille qui ont partagé l'idéal communiste avec plus ou moins de ferveur jusqu'à ce qu'il corrode les relations entre les générations. Une lecture qui vous laisse une drôle de sensation, celle d'être recouvert d'une pellicule grise, à l'image de la couverture du livre, mais passionnante parce qu'elle met le doigt sur certaines choses qui échappent au récit historique, comme le sentiment d'incompréhension entre l'Est et l'Ouest.
SachaDesromans
• Il y a 11 mois
Dans Quand la lumière décline, sous-titré Roman d’une famille, c’est l’histoire de sa propre famille que nous raconte l’auteur. La complexité des relations intrafamiliales (rivalités, grand âge) se mêle à la grande Histoire : exil au Mexique des grands-parents, goulag et bannissement en URSS pour le père, retour de la famille en RDA, service militaire en tant que garde-frontière et fuite à l’Ouest du fils… Chacun des personnages est très incarné, ce qui en rend certains attachants, d’autres détestables mais avec les nuances que permettent les points de vue renversés. Les très nombreux dialogues contribuent aussi à les rendre plus « vivants », me semble-t-il. En tous cas, l’émotion affleure en permanence. Cette immersion dans une famille de RDA, avant même la création du pays et jusqu’à sa dissolution, est passionnante parce qu’elle y montre la vie de tous les jours, les compromissions et les ambitions à l’œuvre, les différences et incompréhensions au sein d’un couple et entre les générations, sans oublier la violence des bouleversements qu’ont entraînés la guerre, la division de l’Allemagne et sa réunification. À lire, en particulier si l’histoire de la RDA vous intéresse !
jlvlivres
• Il y a 1 an
« Quand la lumière décline » de l’écrivain allemand Eugen Ruge, traduit par Pierre Deshusses (2012, les Escales Editions, 432 p.) de l’original « In Zeiten des abnehmenden Lichts » (2011). Le roman narre la montée, puis la chute de quatre générations d’une famille d’intellectuels allemands au cours du dernier siècle, avec les bouleversements de la seconde guerre, la partition de l’Allemagne en RFA et RDA, et sa réconciliation pour adhérer à l’Europe. Les grands-parents, Wilhelm et Charlotte Umnitzer sont des fervents communistes, mais ils décident de rentrer en 1952, de leur exil mexicain dans la jeune RDA. Ils veulent participer à la construction du nouvel État socialiste. Le fils Kurt rentre, lui, de vingt années de camp en Sibérie, après avoir fui le nazisme à Moscou et frôlé la mort dans un goulag stalinien. Il a laissé dans les camps son frère Werner. Kurt ramène avec lui son épouse russe Irina. Il croit encore au rayonnement des idéaux révolutionnaires et devient historien du mouvement ouvrier. Irina s'échine à transformer leur maison en un cocon confortable alors que sa mère, Nadejda Ivanovna, également rapatriée de Sibérie en RDA, continue imperturbablement à faire pousser puis conserver ses cornichons. Conservés dans le sel t des feuilles d’aneth, ils diffèrent de par leur taille des gros cornichons salés efficaces parait-il contre la gueule de bois. Alexander, le petit-fils, a du mal à trouver sa place dans cette famille marquée par l'histoire. Il se sent au contraire à l’étroit dans la patrie d’élection de sa famille. Il choisira de passer à l’Ouest, alors que le Mur est sur le point de s’effondrer. Pour Markus, l’arrière-petit-fils, il se détache très vite du mode vie de la RDA. Pour lui ; toutes ces luttes politiques passées ne sont rien d’autre que l’objet d’ennuyeux cours d’histoire. Et le jour de l’anniversaire des 90 ans du patriarche, tous ces destins vont se croiser, s’affronter, se rencontrer ou se séparer. Tout débute donc avec la reconstruction d’après-guerre la Grande guerre patriotique comme on l'appelle en Russie. Mais, au fond, ça n’est pas le grand luxe, ni le grand soir loin de là, surtout lorsque l’on vit à l’Est. « Il faisait très clair dehors quand elle leva les yeux, tellement clair que c'en était douloureux. Les bouleaux avaient un éclat jaune, l'automne serait chaud cette année, bon pour les récoltes se dit Nadejna Ivanovna. A Slava, on faisait en ce moment les pommes de terre, les premiers feux fumaient, les fanes de pomme de terre brûlaient, et quand les fanes de pomme de terre commençaient à brûler, c'était le signe qu'il était arrivé de façon inexorable : le temps où la lumière décline ». Il est dommage, à ce stade, que l’écriture et le texte soient relativement linéaires dans le temps. Par contre, cela a l’avantage de pouvoir identifier les liens de parenté entre les protagonistes, et ainsi de suivre l’évolution de la société. Heureusement, l'austérité de la vie en RDA avant la chute du Mur, et la perte de repères qu'a occasionnée celle-ci n'exclut pas l'humour, auto-dérision et critique déguisée des absurdités de ce régime. Les grands parents, communistes, s'étaient exilés dans les années 30 au Mexique. On se souvient de Léon Trotski qui y fut assassiné en 1940 par Ramon Mercader d’un coup de piolet au crane. Puis, du départ mouvementé de Leonora Carrington, qui vient de rompre avec Max Ernst, mais qui se remarie de suite avec Renato Leduc, poète et diplomate qui lui propose de l’épouser, mariage arrangé, pour quitter l’Espagne en 1942. A Mexico, elle rencontre le photographe hongrois Imre « Chiqui » Weisz (1911-2007) ancien compagnon de route de Robert Capa. Elle l’épouse et ils ont deux enfants, Pablo et Gabriel. Elle se met à écrire « L’œuvre Ecrit » (2020, Fage, 208 p.) qui vient de ressortir et comporte 27 contes écrits entre 1938 et 1975. Ce sont donc des univers stupéfiants de magie, truffés de passages où s'engouffrent toutes les autres réalités. Le tout est quelquefois illustré par Alejandro Jodorowsky. C’est là qu’elle rédige « Le Cornet acoustique » et « La Porte de Pierre ». A la même époque, en mai 1942, Max Aub embarque à Casablanca pour Mexique. Traversée pendant laquelle il écrira les premiers volumes de « Le Labyrinthe Magique ». Puis, ce sera au tour de Roberto Bolaño qui fuit le régime de Pinochet au Chili en 1973. Il est devenu trotskiste en 1970, et fonde le mouvement de l’infraréalisme. On voit donc que le Mexique est devenu un pôle pour les écrivains et poètes avant-gardistes. Retour du Mexique aussi pour certains allemands. La construction dès février 1947 au cœur de Berlin-Est de la « Société pour l'amitié germano-soviétique » (Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, DSF) multiplie les expositions d’artistes soviétiques, cela se traduit par des campagnes organisées selon les conceptions politiques rigoureuses d'Andreï Jdanov, le ministre chargé de la culture sous Staline. Elles encadrent étroitement toutes les productions artistiques d'URSS. En RDA, la création d’une « Union des artistes plasticiens » (Verband Bildender Künstler, VBK) est un signe supplémentaire de la soviétisation de l’art. L’organisation de la 3e exposition nationale de Dresde en mars 1953, dont le jury élimine tous les peintres est-allemands renommés pour les remplacer par des artistes inconnus qui imitent le style stalinien. C’est le moment du retour des intellectuels, car le Parti avait besoin d’eux. C’est l’époque où Christa Wolff est membre du comité directeur de l'Union des écrivains de la RDA, après son mariage avec l'écrivain Gerhard Wolff. Dans « Le Ciel Divisé » traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein (2011, Stock, La Cosmopolite, 312 p.), elle narre le dilemme de Rita, qui a la foi dans l’utopie socialiste, et de Manfred, qui ne croit pas en grand-chose sinon en la grâce de cette « brune demoiselle ». « Des révolutions ? Pourquoi pas ? Mais faîtes-nous grâce de vos illusions ». Charlotte Powileit, la grand-mère apparaît tout d’abord dans son exil mexicain, bientôt elle pourra retourner en Allemagne. Le couple veut revenir en RDA. Charlotte, et son deuxième mari Wilhelm, décident donc de déménager en RDA après douze ans d’exil mexicain. En 1952, Wilhelm et Charlotte se sentent de plus en plus mal à l'aise au Mexique. Démis tous deux de leurs fonctions dans la rédaction du journal allemand en exil « Demokratische Post », ils attendaient depuis longtemps leur document de sortie pour pouvoir commencer une nouvelle vie en RDA. Mais elle a un penchant malheureux pour l'alcool. Ils ont surtout des inquiétudes au sujet de leurs fils Kurt et Werner, portés disparus en URSS et pendant longtemps, elle ne parvient pas à savoir où ils se trouvent. Avec le recul des temps on se doute qu’ils ont péri dans les camps pour rééducation des ennemis du système soviétique (ou du stalinisme). Mais c’est une interprétation venant de personnes vivant en démocratie, avec une presse plus libre. On ne se rend pas assez compte, en Europe de la qualité de nos informations, malgré les « fake news » et l’endoctrinement promulguée par certains états. Finalement, c’est un ancien ami en exil, devenu secrétaire d'État en RDA, qui leur procure les papiers qu'ils désiraient. En prime, il y ajoute des postes de direction au sein de la nouvelle « Académie des sciences politiques et juridiques de Neuendorf ». Comme quoi l’appartenance ou la proximité aux idées socialistes permet à certains d’être plus égaux que d’autres, et donc de bénéficier de plus d’avantages. Pas de chance pour Wilhelm, qui échoue comme directeur administratif, et est réduit à travailler bénévolement comme secrétaire du parti du district. Alors, si même les appuis politiques ne servent plus, est-ce le début de la décadence du socialisme. J’aime bien le raccourci « Tu es nul pour le travail, tu feras un bon secrétaire de section ». Kurt, est maintenant l'un des éminents historiens de la RDA. De retour d'un voyage d'affaires à Moscou en 1966, il est informé par un secrétaire du parti de la « trahison » d'un collègue de son groupe de recherche. Ce qui n’est pas bien du tout, mais hélas la règle. De plus, il a été critiqué de manière cinglante par les membres du Comité Central lors d'une réunion de l'institut et démis de ses fonctions. « C’est sur cette minuscule table que Kurt avait écrit toute son œuvre […] dix ou douze ouvrages que Kurt avait rédigés seul – son œuvre occupait toujours une longueur d’étagère […] : un mètre de science. Pour ce mètre de science, Kurt avait travaillé dur pendant trente ans ; il avait terrorisé sa famille pendant trente ans. C’est pour ce mètre qu’Irina avait fait la cuisine et la lessive. C’est pour ce mètre que Kurt avait reçu des médailles et des décorations mais aussi essuyé des réprimandes et même un blâme de la part du parti, qu’il avait marchandé ses tirages avec les maisons d’édition sans cesse aux abois par manque de papier, qu’il avait bataillé pour imposer des formulations et des titres, qu’il avait dû faire machine arrière ou parfois obtenu gain de cause à force de ruse et de ténacité – et maintenant tout cela était bon pour le REBUT ». À cette occasion, Kurt se souvient de son arrestation à Moscou en 1941 et de son interrogateur de l'époque, dont le « visage de cochon » ressemblait étrangement à celui du camarade du Comité central qui avait prononcé le discours d'accusation contre Rohde. Sa lettre à son frère Werner, dans laquelle il remettait en question le pacte de non-agression germano-soviétique, avait valu dix ans dans un camp pour formation d'une organisation conspiratrice. Pour les deux frères, c’était aussi la mort de Werner. Kurt se console en réalisant que ce sera un progrès si les critiques ne sont plus fusillées, mais simplement exclues. « Ici il n'y avait ni camp de travail, ni ours bruns mais des Trabi dans les forêts avec des couples en train de baiser. Si ce n'est pas un progrès ! se dit Kurt. Et n'était-ce pas aussi un progrès d'exclure les gens du parti - plutôt que de les fusiller ? ». On a les consolations que l’on peut. Alexander maintenant. Alexander le fils, est finalement le personnage principal, le double de l'auteur. Il entre en scène le premier en 2001. Il va voir son père Kurt déjà vieillard et impotent, qui doit être nonagénaire et qui ne comprend plus grand chose aux évènements. Il a été diagnostiqué comme ayant un cancer incurable. Alexander lui annonce, qu'il va partir. C’est le début et la fin du roman. Pour le jour de Noèl 1976, Alexander arrive chez ses parents avec sa nouvelle petite amie Melitta. Irina, la mère, prépare une oie du monastère français, dont elle doit organiser chaque année les ingrédients par le biais d'un troc. Toute la famille est présente, y compris Wilhelm et Charlotte, ainsi que leur grand-mère russe Nadjeshda Ivanovna, qui avait quitté l'Oural quatre semaines plus tôt. Mère jalouse, Irina ne comprend pas ce que son bien-aimé Sacha trouve à sa nouvelle compagne. Et de plus, elle découvre la grossesse de Melitta. Se greffent là-dessus des références historiques contemporaines explicites que l’on retrouve, suite à l'expatriation de l'auteur-compositeur Wolf Biermann et au roman de Christa Wolf. Cette dernière en parle longuement dans « Trames d’enfance » traduit par Ghislain Riccardi (1987, Stock, 461 p.). L’affaire Biermann (1936-) a fait grand bruit dans le monde intellectuel en RDA. Lors du 11e congrès du Comité central du Parti socialiste unifié d’Allemagne (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, ou SED), Erich Honecker, s'exprime sur la politique culturelle. Il cite Biermann comme étant hostile à l'État et au Parti. En 1976, après un concert à Cologne, Biermann est déchu de la citoyenneté est-allemande. Le chansonnier est exclu de la RDA et n'est pas autorisé à rentrer en RDA. Ce qui ne l’empêchera pas de se matrier, t de donner naissance à la future chanteuse Nina Hagen. Christa Wolf n’est évoquée qu’à demi-mots « Avec une admiration douloureuse. Et de la tristesse aussi. ». Elle y reviendra plus tard, en 1995 quand il s’agira de publier un enregistrement de leur rencontre en 1976, et encore en 2001 « le gouvernement de la RDA n’a pas encore souhaité se retirer ». Evidemment cette phrase date d’après la réunification, on le comprendra facilement. En 1979, « à la veille du trentième anniversaire de la RDA, on n’a droit de toute façon qu’aux tambours et fanfares ». En janvier 1979, Kurt rend visite à Alexander, qui s'est installé illégalement dans un appartement vide et complètement délabré à Prenzlauer Berg. Les immeubles péjorativement appelés « Mietskasernen » ou casernes locatives sont tout d’abord habités par des intellectuels, des artistes et des étudiants. Puis il devient le quartier bohème du nord-est de Berlin. Alexander a quitté Melitta et son petit-fils Markus. Il a aussi arrêté ses études d'histoire. Lors de leur promenade sur les trottoirs enneigés à la recherche vaine d'un restaurant ouvert, la conversation entre le père et le fils tourne autour de l'échec de la construction socialiste « Quels sont les quatre principaux ennemis du socialisme ? […] Printemps, Somma, Automne et Winta » Les 90 ans de Wilhelm, le 1 octobre 1989, font l’objet de 6 chapitres du roman. Cesont des vues différentes de la sénilité et démence avancée de Wilhelm. Tout y passe, sa démence, son honneur par les responsables du parti, sur l'absence d'Alexandre, son empoisonnement par Charlotte, dont personne d'autre n'a jamais eu connaissance. Cet anniversaire est en fait le pendant privé de la célébration nationale du 40e anniversaire de la RDA qui a eu lieu six jours plus tard. Anniversaire éclipsée par l’annonce de la perestroïka par Gorbatchev. L'histoire du jour de Noël 1991 reprend sous une forme différente celle du Noël 976. Irina peut alors librement acheter tous les ingrédients pour son oie du monastère au supermarché. Alexander vient avec sa nouvelle petite amie actuelle Catrin de Moers. Mais la fête se termine mal. Irina, s'enivre peu à peu dans la cuisine tout en suivant discussions politiques de plus en plus agressives entre Kurt et Alexander. On la retrouve complètement ivre, étendue sur le sol de la cuisine à côté de l'oie éclatée. Elle insulte Catrin, qui se précipite pour l’aider « Ne me touche pas, espèce de charogne ». Alexander tire alors un trait sur le lien familial « Alors, c'est tout ». Au même moment, la nouvelle de la dissolution de l’Union Soviétique est annoncée à la radio. « Viendrait un socialisme qui mériterait son nom - ce ne serait peut-être plus de son vivant, au cours de cette minuscule période de l'histoire universelle dont il était par hasard le témoin et qu'il comptait bien mettre à profit, nom d'un chien ! ou du moins ce qu'il en restait après dix années de goulag et cinq années de bannissement ». Plus tard, Markus, l’arrière-petit-fils assiste aux apparaît aux funérailles d'Irina, mais ne parle ni à son grand-père Kurt ni à son père Alexander. Il mêne désormais la vie d'un adolescent occidental, entre consommation de drogue et sorties nocturnes. Ce qui ne lui procure aucune satisfaction. Alexander réapparait en 2001, mais en fait au début du roman. iIl prend 27 000 DM dans le coffre-fort mural et annonce à son père, qui ne s'en aperçoit plus, qu'il part. On lui on a diagnostiqué une tumeur incurable. « Avec ce qui leur restait d'argent, ils s'étaient payé des dents en or, chacun une incisive, pour faire bonne figure en Allemagne ».Il part au Mexique à la recherche de ses origines de son histoire familiale. Il veut avant tout « rompre avec ce monde malade et écœurant » C’est donc l’ascension et la chute de quatre générations d’intellectuels de RDA. Eugen Ruge, mathématicien de formation, puis géophysicien au « Zentralinstitut für Physik der Erde » (ZIPE) » qui deviendra le prestigieux « GeoForschungsZentrum Potsdam » (GFZ) à TelegrafenBerg Potsdam dans la banlieue de Berlin. Je dis prestigieux, car il y a un bâtiment où Einstein a fait ses débuts. Il est le fils de Wolfgang Ruge, historien de la RDA, déporté au camp 239 en Sibérie par les dirigeants soviétiques. Eugen Ruge est arrivé à Berlin-Est avec ses parents à l'âge de deux ans. Au ZIPE, ce titre, il écrit un premier roman « Pompéi ou les cinq discours de Jovna » sur l’éruption du Vésuve (2023, dvt editions, 369 p.). C’est l'histoire d'un aveuglement fatal devant une catastrophe. Une parabole éblouissante sur la séduction, la trahison et le délire. En 1988, Eugen Ruge décide de passer à l'Ouest et, depuis la chute du Mur, il travaille essentiellement pour le théâtre. On lui doit aussi « Le Metropol » traduit de l’allemand par Jacqueline Chambon (2021, Editions Chambon, 350 p.). En 1936, les grandes purges staliniennes ont commencé. Elles n’épargnent pas les membres du Komintern, la ¬IIIe Internationale créée par Lénine en 1919. Quelques Européens, Allemands, Français et Espagnols, travaillant à Moscou pour les services secrets du Komintern sont regroupés dans un grand hôtel de la capitale, le Metropol. Ils ne sont pas privés de leur liberté, et ont des chambres spacieuses. Ils ont même le droit de sortir et d’aller au restaurant. Ils attendent d’être jugés et condamnés à mort par le sinistre juge Vassili Vassilievitch Oulrikh, qui loge aussi au Metropol. Parmi les membres du Komintern assignés à résidence se trouvent Wilhelm et Charlotte. Ils sont allemands, ils vivent en couple et travaillaient tous les deux pour le service d’espionnage du Komintern. Wilhelm et Charlotte ont existé, ce sont les grands-parents de l’auteur. « Ce qui va être raconté ici repose sur des faits vrais ». Hasard des sorties d’édition. Changements à travers une petite douzaine de livres romancés souvent. Il convient non pas d’en faire une synthèse, mais de mettre en parallèle ou en opposition leurs points de vue. On trouvera les commentaires respectifs sous chaque titre. « Le Temps des Loups. L’Allemagne et les Allemands (1945-1955) » de Harald Jähner, expose la situation de l’Allemagne à la sortie de la guerre. L’essai est traduit de « Wolfszeit und die Deutschen Deutschland 1945-1955 » par Olivier Mannoni, (2024, Actes Sud, 362 p.). Livre essentiel pour ce pays et ses voisins, vu de par les habitants. Texte très factuel qui présente un aspect technique de la situation en Allemagne, « l’heure zéro » du pays. Un texte prémonitoire de 1940. « Thèses sur le concept d’histoire, IX » (2013, Gallimard, 208 p.) d’après « Über den Begriff der Geschichte, IX », Au printemps 1940, quelques mois avant de se suicider, Walter Benjamin rédige une suite d'aphorismes denses et étincelants, d’après le tableau de Klee, « Angelus Novus ». L'Ange de l'Histoire, résume l’époque traversée par une même question : « Peut-on sauver le passé », et comment qualifier ce qui vient de se passer « Cette tempête est ce que nous appelons le progrès ». Ange que l’on retrouve dans le roman de Heinrich Böll « Le silence de l’ange » traduit par Alain Huriot (1995, Seuil, 186 p.) lorsque le soldat Hans Schnitzler débarque dans une ville sinistrée, Cologne, pour trouver un abri provisoire. Honneur, illusions, il a tout perdu à la guerre. Que reste t’il de l'avenir : Un champ de ruines. Ange auquel il est fait allusion dès l’introduction de « Le chant du Genévrier » est un roman de Regina Scheer, traduit par Juliette Aubert-Affholder (2024, Actes Sud, 400 p.). « Le restaurateur a scellé les trous de ver, maintenant l'ange ressemble à ce qu'il aurait pu être il y a deux cents ans, gros et aux joues rouges, heureux au premier regard, mais ensuite on voit les yeux écarquillés, la petite bouche ouverte comme pour crier et vous demandez "Qu'est-ce que l'ange a vu ? Que lui est-il arrivé ? ». Christa Wolf choisit Los Angeles pour s’y installer de 1992 à 1993 et écrire « Los Angeles. The overcoat of Dr Freud » traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein (2012, Seuil, 400 p.). Elle s’y installe deux ans après la réunification de l’Allemagne pour se protég
domguyane
• Il y a 2 ans
"ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous", Jean Rostand 4 générations racontées non de manière chronologique mais kaleidoscopique. Eugen Ruge (Sasha dans le livre) brosse en de courtes scènes emblématiques, la saga d'une famille est-allemande, grandeur et décadence de la RDA, une chronique du 20e siècle. Et puis, lorsque patriarches et système se déglinguent ce n'est pas seulement une passionnante chronique de cette mort annoncée qu'on lit mais aussi un livre mélancolique sur la fragilité et la vanité des choses qui relativisent toute idéologie.
Avis des membres
Fiche technique du livre
-
- Genres
-
- EAN
- 9782264058416
-
- Collection ou Série
- Littérature étrangère
-
- Format
- Poche
-
- Nombre de pages
- 456
-
- Dimensions
- 178 x 111 mm
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers où les mots s'animent et où les histoires prennent vie. Que vous soyez à la recherche d'un roman poignant, d'une intrigue palpitante ou d'un voyage littéraire inoubliable, vous trouverez ici une vaste sélection de livres qui combleront toutes vos envies de lecture.
9,50 € Poche 456 pages