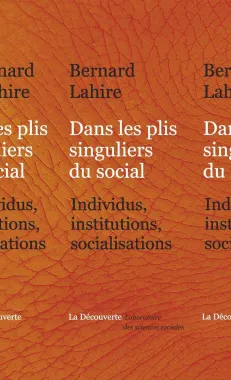Vers une science sociale du vivant - Questions et avant-propos de Laure Flandrin et Francis Sanseigne : Le livre de Bernard Lahire
La publication en 2023 des
Structures fondamentales des sociétés humaines a marqué un tournant majeur en sciences sociales. Bernard Lahire y opère un raccordement décisif entre sciences sociales et sciences de la vie en montrant que le social humain s'inscrit dans le
continuum du vivant et ne se comprend que par une série de comparaisons entre sociétés humaines, mais aussi et surtout entre espèces sociales.
Ce nouvel ouvrage a pour but d'introduire à une
vision générale qui entend reconfigurer les sciences sociales et leurs rapports à d'autres disciplines. Au fil d'un échange nourri avec deux autres sociologues, Bernard Lahire éclaire son projet et répond aux critiques qui se sont exprimées depuis la parution du livre.
On trouvera également à la fin de ce volume un texte inédit qui reprend et approfondit les résultats dégagés dans l'ouvrage précédent. En accroissant encore un peu plus leur degré de généralité, il les replace dans une réflexion sur les propriétés fondamentales du vivant et les enjeux auxquels toute forme de vie se trouve confrontée – les sociétés en général et les sociétés humaines en particulier n'étant qu'un moyen de faire, par la voie du collectif, ce que tout système vivant fait à l'échelle individuelle. Ce texte constitue un pas supplémentaire en direction d'une science sociale du vivant unifiée que le présent dialogue appelle de ses voeux.
De (auteur) : Bernard Lahire
Avant-propos de : Laure Flandrin, Francis Sanseigne
Les libraires et les médias en parlent
Avis Babelio
Marie987654321
• Il y a 2 mois
Ce petit ouvrage est un entretien avec Bernard Lahire le sociologue, auteur des "structures fondamentales des sociétés humaines" (SFSH), dont le millier de pages est dans ma PAL depuis quelques temps à l'état de projet de lecture quand j'aurais beaucoup de temps. L'entretien a pour objectif de répondre aux critiques qui ont été faites à son œuvre (d'où le ton parfois un peu polémique), d'en expliquer la genèse et d'en diffuser les conclusions simplifiées pour le lecteur qui n'attaquerait pas les milles pages . Ou encore pour donner envie de lire les milles pages. L'auteur prend à revers les tendances actuelles de la sociologie au constructivisme, à l'exploration des méandres des représentations individuelles, aux démarches "étroitement" compréhensives pour revenir à la notion de structures. L'identification des structures du monde social est le vrai travail du sociologue, selon lui. Les individus n'ont pas nécessairement conscience des cadres dans lesquels leur vie se déroulent et des déterminismes qui les enserrent. D'autre part, il déplore le manque de culture et de démarche scientifiques des sociologues. Pour lui, leur approche est souvent trop littéraire et ils ne font pas l'effort d'aller voir du côté des autres sciences et de ce qu'elles peuvent apporter. Mais aussi et surtout, Lahire défend l'idée d'une science sociologique fondée sur une démarche scientifique qui, même si elle ne peut être expérimentale (comme l'astrophysique indique-t-il) peut néanmoins, au lieu de se disperser uniquement dans l'exploration des particularités, être cumulative et s'appuyer sur les recherches antérieures, les intégrer, définir ce qui est acquis et ce qui est encore en débat pour avancer. Les études de première main sur tel ou tel sujet sont nécessaires mais elles doivent avoir pour objectif d'identifier des lois générales et il est nécessaire d'avoir une lecture de seconde main à visée globalisante. C'est ce double objectif qui préside au SFSH : établir une base des connaissances et faire le lien avec les sciences du vivant qu'il a pris le temps d'explorer. Dans SFSH, Bernard Lahire identifie les fondements du monde social humain, au-delà de leur expressions culturelles diversifiées entre société de type occidental, société de chasseurs cueilleurs, culture lignagère ... et en regardant aussi du coté des sociétés animales. D'une part, la sociologie ne devrait pas être uniquement l'analyse des sociétés de type occidental. En outre, pour lui le social n'est pas spécifiquement humain. Il est lié aux nécessités de la vie, de la reproduction et de l'évolution et existe, sous des formes très diverses chez les mammifères, les insectes et même dans les microorganisme si j'ai bien compris. Par exemple le fait que les humains comme tout mammifère se reproduisent avec la rencontre d'un homme et d'une femme a des conséquences sociales qui les différencies des insectes eusociaux chez qui une minorité de femelle interviennent pour la reproduction (la reine des abeilles). En ce sens, on parle de science sociale du vivant. Comme toute forme de vie, les sociétés humaines sont contraintes par des facteurs biologiques (viviparité, durée de la vie, partition sexuée du travail reproductif, bipédie, absence de saisonnalité de la reproduction, plasticité du cerveau permettant l'apprentissage..). Le fait anthropologique majeur pour BL est l'altricialité secondaire ; c'est à dire la durée de la période de soin à apporter aux petits et donc de dépendance de ces derniers à l'égard de leurs parents. Ainsi la viviparité, associée à la division du travail reproductif, à l'allaitement maternel et à la nécessité de prendre soin de longues années du petit homme fait peser des contraintes sur l'humanité pour sa survie : fragilité de la mère pendant la période de gestation et danger dans l'accouchement, nécessité de se répartir les tâches de soin et de nourriture. L'auteur propose que cette contrainte conduit à une importance de la relation de dépendance dans les sociétés humaines ; relations familiales, relations gouvernants - gouvernés, relation patrons - salariés, anciens - jeunes. Cette dépendance a de multiples façons de s'exprimer et a en outre évolué dans le temps mais elle serait une donnée fondamentale commune à toutes les sociétés humaines. L'altruisme serait également la conséquence de cette nécessité de prendre soin d'un autre plutôt que de soi. Il conteste à ce propos l'accusation de déterminisme de ses détracteurs qui considèrent que sa vision conduit à une vision mécaniste et scientiste passée de mode. Un des autres grands faits anthropologiques est l'historicité du fait de la grande cumulativité culturelle dont l'espèce est capable. S'il soutient, contre les excès du constructivisme, qu'il y a bien une réalité biologique concrète et matérielle, cela n'empêche pas la grande variété des expressions culturelles, dans le temps et dans l'espace, à partir de ces axes indépassables. A partir des ces bases les SFSH identifient plusieurs lignes de force des sociétés humaines : les modes de production, les rapports de parenté, les rapports hommes femmes, les modes de socialisation /transmission culturelle, la production d'artefacts, l'expressivité symbolique, les rites et les institutions, les rapports de domination, le magico-religieux et la différenciation sociale. Ces lignes de force évoluent selon des lois ( loi de différenciation tendancielle, loi d'objectivation cumulée, loi du rapport eux/nous, loi de variabilité des conduites humaines....) . Donc en gros les contraintes de notre biologie sont à l'origine de faits anthropologiques incontournables qui permettent de distinguer des lignes de force dans la structure des sociétés humaines. Ces lignes de force évoluent en fonction de lois et cet ensemble, cette combinatoire produit la diversité culturelle et non pas un déterminisme. Du point de vue de la méthode scientifique sociologique, il plaide pour la nécessité de bien connaitre ces invariants pour éviter de réinventer l'eau tiède et gagner du temps et de la clarté dans toute étude d'un cas ou d'une situation spécifique et d'en analyser les variations possibles. Le cas individuel n'a d’intérêt sociologique qu'en tant que cas du possible et non pas cas particulier enfermé sur lui-même. Enfin, il s'inscrit en faux contre la critique qui lui a été faite de naturaliser le monde social et de décourager les luttes d'émancipation (pour faire court). D'une part, il ne réduit pas la place du culturel et de l'histoire, d'autre part il vaut bien mieux bien connaitre les déterminismes qui pèsent pour savoir comment agir de manière adaptée : il ne s'agit pas non plus de dire naïvement que tout est possible avec un peu de volonté mais de voir comment on peut faire jouer les déterminismes et les lignes de force. Dans le monde physique, on a pu inventer des dispositifs qui réduisent ou éliminent certaines contraintes, on peut de la même façon inventer des dispositifs culturels qui permettent de modifier les contraintes dans le sens désiré. L'ouvrage se termine sur une synthèse fondée sur la définition de la vye (avec y, ce n'est pas une faute d'orthographe), proposée par Stuart Bartlett et Michel L. Wong. Tout phénomène vivant se définit par le fait qu’il est capable de dissipation, d’autocatalyse, d’homéostasie et d’apprentissage. Lahire y ajoute la capacité de défense et formule l’hypothèse que les sociétés humaines respectent ces cinq principes, considérés comme les invariants qui gouvernent toute forme de vie possible. Ainsi, à fins d'exemple et sans être trop réductrice, la propriété du vyvant appelé homéostasie qui implique la capacité d'établir une séparation entre le soi et le hors soi ( entre autre) a des conséquences sociales sur le rapport eux/nous, la fixation symbolique et matérielle d'un territoire, sur la nécessité pour le groupe de s'incarner dans une personne (chef..) ..etc. Il y a beaucoup d'autres choses.. Une lecture passionnante qui m'a donné envie de lire l'ouvrage. J'ai été séduite par l'illustration de la nécessité de rechercher des approches globalisantes et pluridisciplinaires, comme c'est le cas en histoire, et pour les spécialistes de sortir de leur champ trop spécialisé (mais la vastitude des possibilités fait peur) et par la présentation d'une perspective de compréhension du monde qui sort totalement de ce dont j'avais l'habitude. J'ai apprécié la perspective d'un renouvellement de la sociologie, qui en tant que lectrice intéressée mais non spécialiste m’intéressait moins du fait du sentiment de tourner un peu en rond : chacun retournait son petit bout de terrain en suivant scrupuleusement son cadre théorique, qui Bourdieu, qui Weber.. . même si certaines études très spécialisées et un peu bien écrites apportent un plaisir de lecture comparable à celui d'un bon roman. J'ai réfléchi suite à sa critique du constructivisme et de ses excès : il ramène notre réflexion vers des données sensibles de base, une réalité matérielle qui contredit l'ambiance actuelle " fake" qui préfère l'expression des représentations à la recherche de vérité, de faits, recherche qui est même décrédibilisée comme naïve. L'important c'est que les gens croient en la réalité de telle situation car cela permettra de faire advenir la réalité que je préconise. Si le réel est construit, cela est légitime puisque je peux ainsi faire advenir le réel désirable qui est le mien pourvu que je transforme les représentations de mes concitoyens et qu'ils partagent la désirabilité de ce réel. Je n'ai pas à m’embarrasser de la science ou de rien du réel. Il me semble que ce rappel à du réel, à du concret, à la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui relève des faits et ce qui relève des opinions ou des représentations, enfin la différence entre une discussion pour refaire le monde devant une bière, une rencontre de militants politiques et les conclusions d'une étude scientifique est tout à fait salutaire. Enfin, j'ai trouvé la vision de l'auteur un peu "quantique" en quelque sorte : des lois et une infinité de monde possible, mais un seul réel au final.
Lazare78
• Il y a 8 mois
Ce court livre (surtout quand on le compare au précédent) est constitué d’entretiens qui reviennent sur le parcours académique du sociologue, la réception de son livre précédent et les critiques. La deuxième partie de l’ouvrage est consacré à la présentation du concept de « vivant » (ou lyfe en anglais). Mais on touche là aux limites de la lecture en numérique : l’exposition sous forme de tableau entend la lecture très fastidieuse et la compréhension plutôt difficile. J’ai finalement été surtout intéressée par le parcours du sociologue et les liens qu’il établit avec les sciences dites dures. La lecture reste néanmoins réservée à des personnes un peu habituées aux sciences humaines. Je remercie chaleureusement les éditions de la Découverte et NetGalley pour cette lecture.
Goudal
• Il y a 8 mois
Que vous ayez lu les eSséFfeSsHache ou non, il faut lire Vers une science sociale du vivant. L'objet de ce nouveau livre encadre les SFSH. Il explique la démarche générale de l'auteur. Il approfondie certains sujets. Il répond à certaines critiques. Tout cela sans jamais se répéter. Et au-delà, il nous montre l'évolution de sa démarche depuis la parution du livre. Le livre se termine par un tableau recensant les propriétés du vyvant, nouveau concept et francisation de la Lyfe. Passionnant. Travail titanesque hyper documenté qui replace enfin la sociologie à sa place essentielle. Encore merci monsieur Lahire.
H-mb
• Il y a 9 mois
Il ne fait pas sens de lire ce livre sans avoir lu Structures Fondamentales des Sociétés Humaines mais cela n'apporte pas tellement plus à mon avis. Le livre est divisé en deux parties : une série de chapitres questions-réponses avec Laure Flandrin, sociologue, et Francis Sanseigne, politologue, puis un récapitulatif vu de très haut des principales conclusions de SFSH. (je précise que ce récap sous forme de tableau est quasi illisible dans sa forme numérique ; il l'a fallu le réécrire pour en juger, travail pédagogique s'il en est). Le livre répond à la façon dont SFSH a été reçu. Il prend acte des réactions à la lecture et des conséquences pour l'avenir des sciences sociales. Il reprend et précise les lignes forces du premier livre, répond à certaines critiques. Le 1er chapitre reprend un peu le parcours de Lahire et resitue SFSH dans son questionnement antérieur. Le 2e revient sur la nécessité de réformer les sciences sociales et réaffirme l'objectif nomologique de la science et la nécessité du réalisme, de la recherche d'invariants, de convergences, ainsi que la nécessaire connaissance des autres sciences (évolution, paléoanthropologie, éthologie, etc.). Le 3e s'interroge sur la façon de raccorder sciences du vivant et sciences sociales, vu les interactions biologie-culture, malgré les dangers que cela comporte : sociologiser la biologie plutôt que biologiser le social, en examinant les conséquences sociales du biologique. Le 4e revient sur le cœur de SFSH, les grands faits anthropologiques, les lignes de force, les lois. Le 5e s'attache à répondre aux critiques et lever certains malentendus : opposition chercheurs de bureau/de terrain, la nécessité de la théorisation et des lois, la question de la "nature" humaine. Il souligne ce que mettre à jour des déterminismes, des invariants, des dominations plurimillénaires peut avoir de déplaisant et décourageant mais réaffirme que c'est en affrontant la "brutalité" du réel qu'on se donne les meilleures chances de transformations de ce réel. Le 6e revient sur l'avenir de la science sociale - du vivant, sachant que le social n'est pas une spécificité humaine, que c'est le vivant qui s'organise socialement et que toute société répond aux grandes lois du vivant. D'où la nécessité de lire "outside the pond", de s'entre-lire entre les différentes disciplines en jeu, pour avoir une vue d'ensemble de la réalité. Son principal avantage pour moi aura été de m'envoyer courir des "terriers de lapin" comme disent les Anglo-Saxons. J'en ressors avec 6 bouquins supplémentaires : 3 sur l'évolution, 1 sur la sociologie, 1 sur les primates, 1 sur les mythes… Une lecture désastreuse pour ma PAL mais très stimulante pour l'avenir, je n'en doute pas.
Avis des membres
Fiche technique du livre
-
- Genres
- Sciences Humaines & Savoirs , Sciences Humaines & Sociales
-
- EAN
- 9782348086489
-
- Collection ou Série
- Petits cahiers libres
-
- Format
- Grand format
-
- Nombre de pages
- 256
-
- Dimensions
- 207 x 142 mm
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers où les mots s'animent et où les histoires prennent vie. Que vous soyez à la recherche d'un roman poignant, d'une intrigue palpitante ou d'un voyage littéraire inoubliable, vous trouverez ici une vaste sélection de livres qui combleront toutes vos envies de lecture.
20,50 € Grand format 256 pages