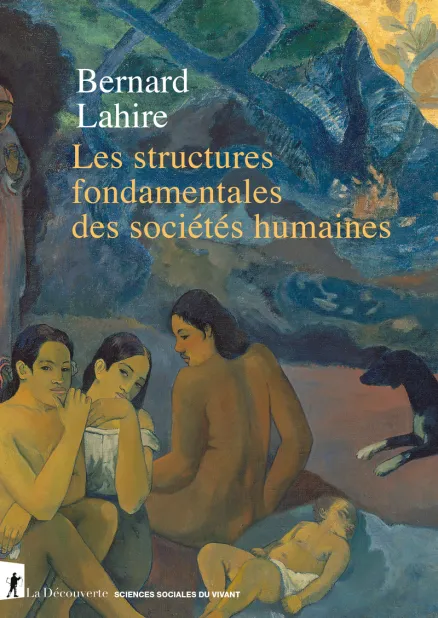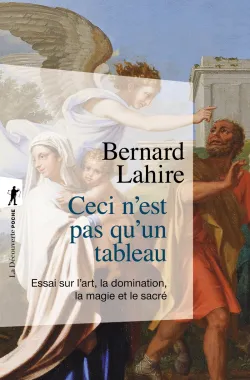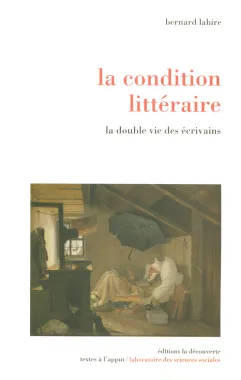Les structures fondamentales des sociétés humaines : Le livre de Bernard Lahire
Et si les sociétés humaines étaient structurées par quelques grandes propriétés de l'espèce et gouvernées par des lois générales ? Et si leurs trajectoires historiques pouvaient mieux se comprendre en les réinscrivant dans une longue histoire évolutive ?
En comparant les sociétés humaines à d'autres sociétés animales et en dégageant les propriétés centrales de l'espèce, parmi lesquelles figurent en bonne place la longue et totale dépendance de l'enfant humain à l'égard des adultes et la partition sexuée, ce sont quelques grandes énigmes anthropologiques qui se résolvent. Pourquoi les sociétés humaines, à la différence des sociétés animales non humaines, ont-elles une histoire et une capacité d'accumulation culturelle ? Pourquoi la division du travail, les faits de domination, et notamment ceux de domination masculine, ou les phénomènes magico-religieux se manifestent-ils dans toutes les sociétés humaines connues ? Pourquoi l'ethnocentrisme est-il si universel et pourquoi des conflits opposent-ils régulièrement des groupes qui s'excluent mutuellement ? C'est à ces questions cruciales que cherche à répondre Bernard Lahire en formulant, pour les sciences sociales, un paradigme unificateur fondé sur une synthèse des connaissances essentielles relatives à la vie sociale humaine et non humaine accumulées dans des domaines du savoir aussi différents que la biologie évolutive, l'éthologie et l'écologie comportementale, la paléoanthropologie, la préhistoire, l'anthropologie, l'histoire et la sociologie.
Le pari de ce livre est que seul cet effort d'intégration permet de comprendre la trajectoire des sociétés humaines par-delà leur diversité et d'augmenter la maîtrise qu'elles peuvent avoir de leur destin incertain.
De (auteur) : Bernard Lahire
Expérience de lecture
Avis des libraires
Avis Babelio
Bequelune
• Il y a 1 an
Avec ce livre monumental, Bernard Lahire pose une double ambition : 1/ Interpeller les sciences humaines sur ce que cela suppose comme exigence, méthode et résultat de se prétendre scientifique ; 2/ Etablir les grandes caractéristiques de la nature humaine, ou dit autrement des structures fondamentales des sociétés humaines. Grosso modo, cette double ambition se traduit par deux parties dans le livre – qui compte au demeurant de nombreux chapitres et près de 1000 pages. Alors scientifiques, les sciences humaines ? Cela ne va pas de soi car, comme le rappelle Lahire, la sociologie, l'histoire ou l'anthropologie sont depuis longtemps obsédées par la grande variabilité des sociétés humaines, et ont préféré se concentrer sur ce qui distingue les sociétés les unes des autres dans l'histoire, le temps ou encore un champ particulier de leur activité, plutôt que d'essayer d'établir les invariants, les points communs, ce qui rassemble tous les groupes humains à travers les époques et les continents. A vrai dire, de nombreux chercheurs ont même affirmé qu'il était illusoire, voire inintéressant, d'entreprendre une telle démarche. Pourtant, dans les sciences dites dures ou fondamentales, la recherche de lois est un des éléments qui définit le caractère de la science (ex : la gravité en physique, l'évolution en biologie). Lahire rappelle la classification traditionnelle des 3 grandes étapes de la recherche : 1. le recueil des données de terrain par l'expérience, 2. l'analyse et le traitement de ces données, et enfin 3. la recherche d'invariants par la mise en perspective de l'ensemble des données collectées et analysées. Les sciences humaines seraient comme bloquées aux étapes 1 et 2, refusant parfois même que l'étape 3 puisse exister. Pourtant, note Lahire avec malice, si les sciences humaines doivent se contenter de recueillir des données sur un sujet donné et de les décrire, qu'est-ce qui distingue au juste un bon journaliste d'un sociologue ? Sans recherche de lois, pas de sciences ; et ce qui paraissait comme évident à plusieurs précurseurs des sciences humaines a été perdu en route. Dans la 2nde partie, Lahire part donc à la recherche de ces invariants des sociétés humaines. Pour cela, il part d'une méthode comparative qui consiste à comparer les travaux d'autres sociologues, ethnologues, historiens entre eux pour en faire ressortir l'essentiel MAIS AUSSI de s'appuyer sur les travaux des éthologues et des biologistes, c'est-à-dire l'étude des sociétés animales non-humaines. C'est un des points fondamentaux et particulièrement stimulant de cet ouvrage. Lahire construit des ponts entre les sciences dites dures et les sciences humaines. Pour cela, il pose la distinction entre le social et le culturel (deux mots trop souvent utilisés sans distinction), en montrant que si de très nombreux espèces animales ont une vie sociale riche (modes de parenté, organisation collective, division du travail par sexe et par âge, etc), le fait culturel, et en particulier la capacité de culture cumulative d'une génération sur l'autre, est un trait particulier de l'humanité. En comparant des sociétés de chasseurs cueilleurs avec des sociétés modernes, des humains avec des chimpanzés ou des écrevisses, nous voilà donc lancé dans un tour d'horizon étourdissant de par le nombre de références et de disciplines qu'il mobilise. Je dois souligner aussi oh combien ce livre fait du bien : à l'heure de l'Anthropocène, on avait grand besoin d'un regard global sur les Vivants qui ne s'embarrasse pas des distinctions artificielles de l'université entre disciplines, voire entre spécialités au sein de ces disciplines. Il en ressort que la grande diversité des sociétés humaines ne peut s'épanouir qu'au sein d'un cadre restreint qui contraint son évolution. Tout n'est pas possible – contrairement à ce qu'affirmait un autre livre récent et bien moins convaincant : Au commencement était… de David Graeber et David Wengrow. Lahire postule seize lois universelles et dix lignes de force comme autant de traits humains. Je ne vais les détailler tous ici. Notons que ce sont souvent les particularités physiques et biologiques qui contraignent les possibilités sociales, puis culturelles. Par exemple, et Lahire le pose en fait central, la longue dépendance de l'enfant humain conditionne toute une structure sociale organisée autour du soin et de la solidarité pour élever les enfants, mais pose aussi les bases de toutes les dominations ultérieures que l'on retrouve dans 100% des sociétés humaines : domination des âgés sur les jeunes, domination des hommes sur les femmes. Ces déterminations par le biologique ne sont jamais définitives, et la capacité de cumuler la culture sur le temps très long a permis à l'humanité de s'extraire de certains invariants pourtant vieux de plusieurs millions d'années (ainsi la chute de la mortalité infantile et la contraception qui libèrent les femmes de la procréation obligatoire). (Coucou Véra Nikolski ou Christophe Darmangeat qui défendent des idées similaires.) De par mon parcours (master en sociologie du genre) et mes intérêts souvent portés sur les questions féministes, ce livre m'a grandement plu parce qu'il venait rappeler des faits pourtant connus de longue date, mais un peu ignorées des essais féministes contemporains (l'universalité de la domination masculine et de la division sexuelle du travail notamment). Ca fait du bien d'apporter un peu de recherche et de sérieux dans un domaine où les débats d'idées sont trop souvent hors-sols, peu ancrés sur le réel et les données (coucou Judith Butler). Pourtant, il m'aura aussi beaucoup perturbé, remettant en cause certaines de mes croyances depuis longtemps intégrées. Un livre que je reprendrai sans doute souvent tant il est matière à réflexion. J'espère qu'il fera naitre un « reboot » de la sociologie, qui manque trop souvent d'ambition scientifique, voire de rigueur (en tout cas pour les travaux sur le genre) dans sa façon de travailler.
laudou92
• Il y a 1 an
Livre passionnant, essentiel, dans lequel Bernard Lahire construit le projet de greffer la sociologie sur le tronc d’où s’épanouissent aujourd’hui les sciences humaines dignes de ce nom, c’est-à-dire qui « ne sont pas des constructions culturelles comme les autres, mais parviennent à saisir des propriétés du réel nous permettant d’agir sur lui en connaissance de cause ». On pourrait croire qu’un tel projet devrait être accueilli avec enthousiasme par tous les universitaires de la discipline : il n’en est manifestement rien. Les 970 pages des Structures fondamentales des sciences humaines le prouvent, puisqu’elles sont avant tout un effort pour convaincre d’éloigner la sociologie de la « théologie » humaniste qui y règne et qui proclame qu’il ne peut exister de « lois » universelles sous-jacentes à la constitution des sociétés humaines, comme il existe des lois en physique ou en génétique par exemple, vu que l’être humain est un être libre et purement culturel. On aurait tort de se laisser rebuter par l’épaisseur du volume et la profusion des références bibliographiques qu’on y trouve. Ces Structures en effet sont avant tout une œuvre de conviction, ce qui en facilite grandement la lecture. De plus, même si l’on trouve ici ou là un peu de jargon, c’est en un sens une science toute neuve que l’auteur nous explique, et de ce fait, beaucoup plus accessible que la sociologie classique, hérissée de protocoles incompréhensibles et abîmée dans ce qui pour des non spécialistes semble une accumulation de détails sans intérêt majeur. Grâce à la hauteur de vue où il se place et nous place, Bernard Lahire permet d’embrasser tous les courants de la sociologie, et ce d’autant plus que pour convaincre ses pairs de la légitimité de son propos, il ne cesse de convoquer les grands noms de la sociologie (par exemple Durkheim) pour montrer qu’ils préparaient le terrain à la nouvelle approche scientifique qu’il propose. Après avoir justifié sa démarche, Bernard Lahire entre dans le vif du sujet et indique les principales contraintes biologiques (notamment la fameuse « altricialité secondaire ») d’où ont émergé les lois ou lignes de force constitutives de toutes les sociétés humaines. Je renvoie ici au condensé qu’en proposent les lecteurs avisés qui me précèdent. Tout cela est riche et stimulant, en particulier dans tous les passages où sont mentionnées les dernières connaissances que nous apportent l’éthologie et la génétique. Pour autant, il n’est pas fait obligation au lecteur de prendre pour vérité intangible ce qui constitue la thèse principale défendue par Bernard Lahire. En particularité il semble que, peut-être toujours dans le désir de faire adhérer à son entreprise ses collègues universitaires, il montre une défiance excessive à l’égard de la psychologie évolutionnaire et des sciences cognitives. Ou plutôt, il ne cherche pas à les accorder avec ses lois sociologiques : il manque là une idée de synthèse que personnellement je regrette. Il y a notamment le fait de vouloir à tout prix rattacher les rapports de domination existant dans toutes les sociétés à la situation de dépendance où se trouve nécessairement tout enfant humain vis à vis de ses parents pendant une période de plus en plus longue. Il est clair que dans de nombreuses sociétés, et tout particulièrement dans les sociétés occidentales modernes, les enfants certes n’ont pas l’entière maîtrise de leur vie : mais pour autant, ils « dominent » leurs parents de mille et une façons autant qu’ils seraient eux-mêmes « dominés ». Pour résoudre le grand mystère de la « servitude volontaire » tel que l’a énoncé La Boétie dans son célèbre essai au 17ème siècle, à savoir cette acceptation de la hiérarchie dont tous les humains font preuve, cette passion qu’ils ont à reconnaître des chefs et à se soumettre à eux, (ou à devenir chefs eux-mêmes bien sûr), il n’est pas sûr que tout soit complètement élucidé par l’altricialité secondaire caractéristique de notre espèce. Mais le seul fait d’ouvrir cette piste a de quoi stimuler bien des réflexions. Beaucoup pensent sans doute que toutes ces approches scientifiques qui replacent l’espèce humaine dans le courant inexorable de l’évolution, sont démoralisantes, arides, limitées, et qu’elles ne sauraient concurrencer les constructions audacieuses et exaltantes de la philosophie, même s’il est vrai que celle-ci « n’a aucun accès méthodologiquement réglé au réel », comme le dit justement Bernard Lahire. Eh bien justement, ce que montre un livre comme celui-ci, c’est que rien n’est plus exaltant et prometteur qu’un accès au réel, seule possibilité d’échapper autant que faire se peut à un sort trop rude.
Goudal
• Il y a 1 an
Bernard Lahire est un vieux dinausore rescapé du désert aride de la sociologie et des sciences dites humaines. Il a écrit une somme incommensurable, à rebours des idées préconçues des sociologues enfermant leurs études sur les variations culturelles des sociétés humaines. Il prend le contrepied de la profession en choisissant d’étudier les invariants des humains en intégrant les caractéres biologiques, anthropologiques, ethnologiques. Son but : établir les lois générales régissant les comportements humains, rien que ça ! Et il y parvient ! Il en sort une étude qui fera date dans l’histoire même s’il sera peu lu vu son épaisseur. Il sera commenté, synthétisé et augmenter. Il révolutionne déjà nos connaissances en effectuant la synthèse de tout un tas de sciences qui s’ignorent superbement. A l’heure de la spécialisation à tout crin, il donne une vision totalisante et ordonnée du monde vivant Il est étonnant que cette avancée scientifique intervienne aujourd’hui dans les sciences humaines alors que les sciences « dures » restent coincées depuis plus d’un siècle entre théorie des quantas et relativité générale. Toutes les sciences sont enfermées dans un académisme et une spécialisation à outrance qui aveuglent plutôt que de nous ouvrir au monde. Merci Bernard Lahire pour ce pas de côté.
jmmelko
• Il y a 1 an
J’avoue que, en tant que scientifique de formation, j’étais convaincu d’avance par ce livre. En effet, l’auteur ne propose pas moins que de refonder toute la sociologie sur une base plus scientifique et moins littéraire, en empruntant à d’autres disciplines : biologie, zoologie, éthologie, anthropologie, primatologie, et même la chimie et la physique. Malgré cela, l’auteur reste profondément amoureux de sa discipline, et, s’il critique bon nombre de sociologues (parfois en les nommant, parfois non), il en loue beaucoup d’autres, et il n’hésite pas à reprocher parfois aux scientifiques auxquels il emprunte des idées de ne pas assez… s’inspirer des sociologues ! Le livre est très bien documenté, et très actuel (l’état de l’art est parfaitement dressé). Le livre contient de nombreuses citations, et retrace l’histoire des idées, si bien qu’après l’avoir refermé, vous aurez le bénéfice d’avoir lu plusieurs livres en même temps. Personnellement, il explique pas mal de choses que j’avais déjà remarquées, et en particulier le fait que, malgré toute la diversité culturelle et historique des peuples, il y a un certain nombre de faits qu’on retrouvent presque toujours et qui semblent indépassables (ce qui est parfois assez frustrant quand on est un peu idéaliste). Le plus connu et le plus visible d’entre eux à l’heure actuelle, en 2024, ce sont les rapports de domination, et en particulier de l’homme sur la femme. En lisant ce livre vous comprendrez pourquoi, et aussi pourquoi il y a des exceptions. Les seuls reproches que je pourrais faire au livre sont : * l’absence totale d’illustration (à part une image assez ridicule d’une hélice pour expliquer le concept de ligne de force). A l’époque de Darwin, cela était acceptable (pourtant même Darwin avait dessiné un arbre phylogénétique dans l’Origine des Espèces, ce qui n’est pas rien), mais en 2024 ?! Partant du fait qu’un « dessin vaut mieux qu’un long discours », le livre aurait gagné en clarté en particulier pour tous les lecteurs qui ont une mémoire visuelle. Par exemple un organigramme reliant les « lignes de forces » aux « lois ». De même, il n’y a pas de frise chronologique, pas de liste à puces, et je ne compte que deux tableaux. * la dernière partie, qui est sensée illustrer l’effet des Lois Sociologiques sur les sociétés humaines, ne fait pas assez référence aux lois précédemment énoncées, et pour certains sujets (comme l’altricialité secondaire, ou la domination par l’antériorité) il y a une étude bibliographique assez poussée qui aurait mieux trouvé sa place dans la première partie. Ça donne un curieux sentiment de « digression en arrière ». Un exemple symptomatique : l’origine du mot altricialité, martelé tout au long du livre, n’est expliqué qu’au 3/4 (spoiler : il vient de l’anglais altricial, du latin altrix, la nourrice). Je pense que si le livre avait été écrit en collaboration avec une deuxième personne, cela aurait pu être évité. * Le livre est écrit par une seule personne. Alors certes, il s’agit d’une synthèse, qui gagne donc en homogénéité à émaner d’une seule personne, et de très nombreux auteurs sont cités, donc on peut considérer au contraire que le livre a été écrit « à mille mains ». Mais, alors même que le livre parle du caractère indépassable de la relation de domination (parents-enfants, homme-femme, État-individu), et sachant que l’auteur lui-même s’est illustré dans son parcours contre la domination et les inégalités (en particulier à l’école), on aurait pu espérer un geste allant dans ce sens. Un homme, âgé, un professeur, l’Ecole Normale Supérieure… on est un peu dans le cliché, ou, pour reprendre les mots de l’auteur, en plein dans « l’invariant sociologique » ! Pourquoi ne pas avoir demandé à Laure Flandrin par exemple ? * Enfin, de nombreux exemples sont pris dans les sociétés traditionnelles (sans État, sans richesse), et assez peu dans le monde urbain contemporain. Pourtant, c’est dans celui-ci que 99% de son lectorat vit. Par exemple, à un moment le livre parle de la diminution relative de domination des aînés sur les cadets, à cause du développement technologique rapide qui rend le savoir des aînés caduque. Puis il modère ce propos en rappelant que même les entreprises de jeunes startupeurs ont leur capital possédés par de vieux investisseurs. Et… c’est tout ! Il aurait fallu à minima citer les fonds de pension, puis insister sur la confiscation de la richesse et du patrimoine par les anciens, aggravée par l’allongement de l’espérance de vie, en citant des sociologues ou des économistes modernes (Piketty et exemple, qui est cité ailleurs sur ce sujet, mais très brièvement). On se demande si ce sujet ne mettrait pas l’auteur mal à l’aise ? :- P
Avis des membres
Fiche technique du livre
-
- Genres
- Sciences Humaines & Savoirs , Sciences Humaines & Sociales
-
- EAN
- 9782348077616
-
- Collection ou Série
- SH / Sciences sociales du vivant
-
- Format
- Grand format
-
- Nombre de pages
- 972
-
- Dimensions
- 241 x 172 mm
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers où les mots s'animent et où les histoires prennent vie. Que vous soyez à la recherche d'un roman poignant, d'une intrigue palpitante ou d'un voyage littéraire inoubliable, vous trouverez ici une vaste sélection de livres qui combleront toutes vos envies de lecture.
32,00 € Grand format 972 pages