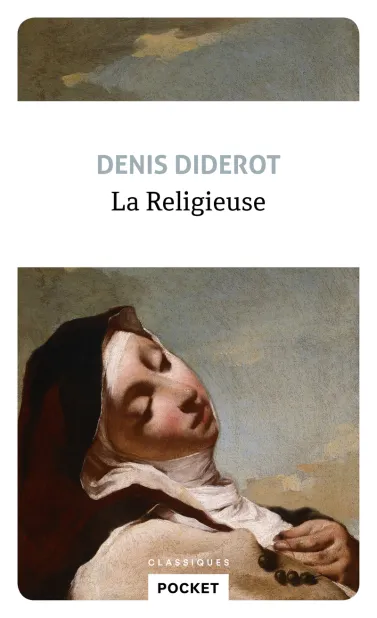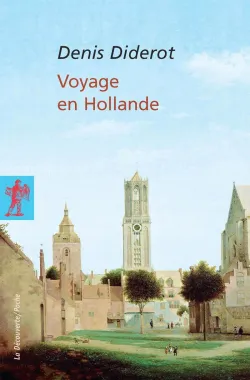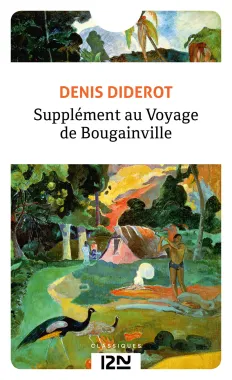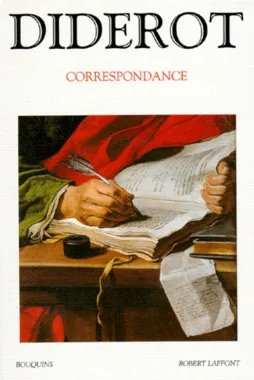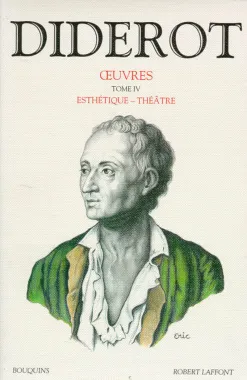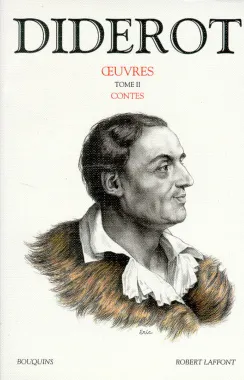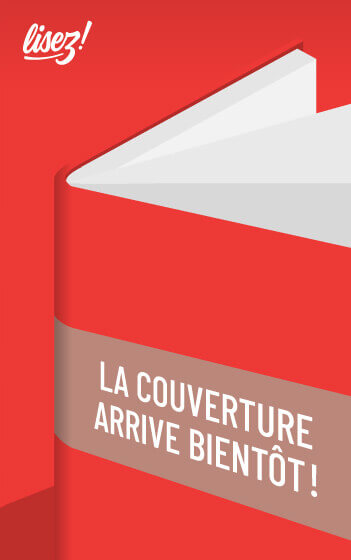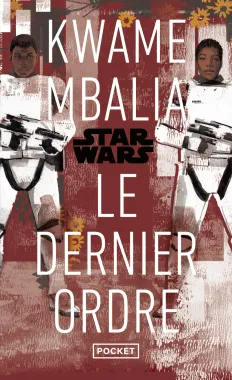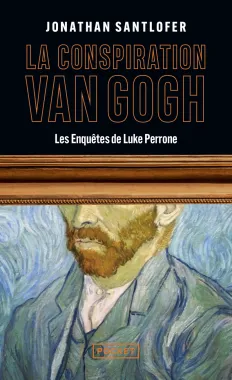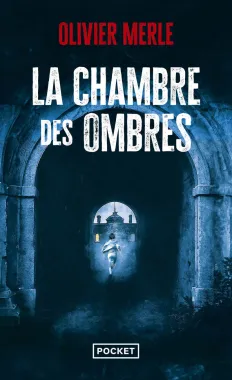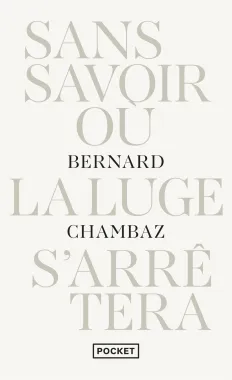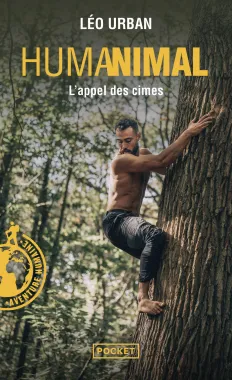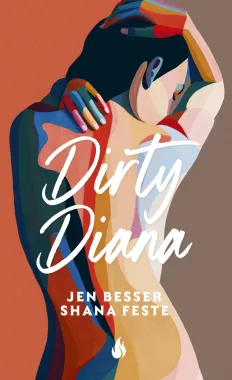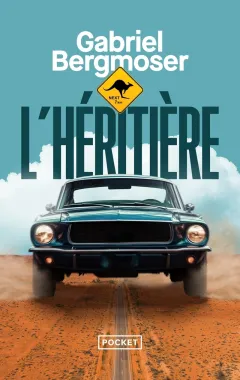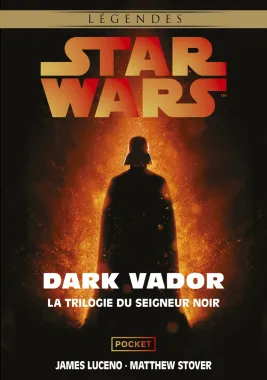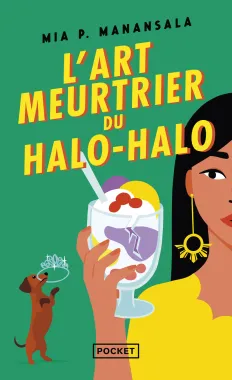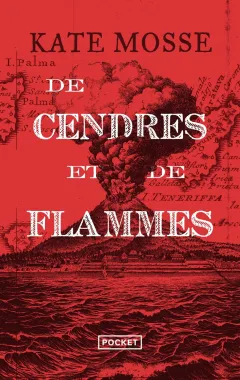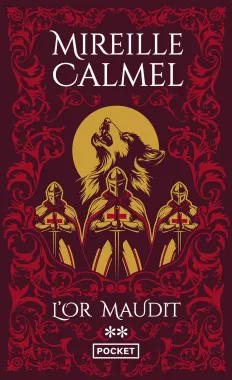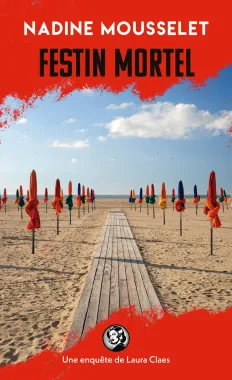La Religieuse : Le livre de Denis Diderot
LES GRANDS TEXTES DU XVIIIe SIÈCLE
Parce qu'elle est une enfant illégitime, Suzanne Simonin est enfermée par ses parents chez les religieuses de Longchamp où on la force à prononcer ses vœux. Pieuse et innocente, elle tombe sous la coupe d'une nonne illuminée déjà perdue de mysticisme, avant de devenir la proie d'une mère supérieure qui va faire de sa réclusion un enfer. Harcelée, martyrisée, elle subit les pires sévices. Femme cloîtrée soumise à toutes les perversions de la vie monastique, Suzanne peut-elle échapper à la folie ?
De ce violent réquisitoire social, Diderot fait un chef-d'œuvre de roman anticlérical, gothique et libertin.
@ Disponible chez 12-21
L'ÉDITEUR NUMÉRIQUE
De (auteur) : Denis Diderot
Expérience de lecture
Avis Babelio
JBLM
• Il y a 1 mois
"La Religieuse" de Denis Diderot est un roman épistolaire publié de manière posthume en 1796, qui raconte l'histoire de Suzanne Simonin, une jeune femme forcée par sa famille à entrer dans un couvent contre sa volonté. Adaptée d'un témoignage authentique, l'oeuvre constitue une critique acerbe de la vie monastique et des abus qui pouvaient y régner à la fin du XVIIIème siècle. le style de Diderot est sans conteste très plaisant à suivre, avec une prose qui se lit avec aisance. Cependant, les intentions de l'auteur sont discutables, car il semble plus intéressé par la dénonciation des excès et des injustices qui régiraient un milieu par nature clos et donc mystérieux que par une véritable réflexion sur le sens de la vocation religieuse. Diderot utilise le récit de Suzanne pour mettre en lumière les travers de ce milieu, mais il le fait de manière parfois excessive, ce qui peut nuire à la crédibilité de son propos. Une fois passées quelques rapides concessions de forme, comme l'exemplarité et la bonté de la toute première supérieure de Suzanne, Diderot dresse un portrait lugubre de la vie consacrée, principalement à des fins idéologiques. Il critique avec justesse le non-respect de la vocation religieuse dans certaines familles, pour lesquelles envoyer l'un de ses enfants dans les ordres pouvait être, à l'époque, une manière d'augmenter les dots ou les héritages des autres enfants de la fratrie. En témoigne le cas de Suzanne, qui est contrainte d'entrer au couvent alors qu'elle n'a aucune inclination pour la vie monastique, et se bat bec et ongles pour la quitter malgré, au demeurant, une grande piété personnelle. Cependant, certaines des critiques de l'auteur semblent exagérées. Par exemple, l'idée selon laquelle les abus bien réels constatés dans quelques communautés (toutes, nous en donne-t-il l'impression) devraient nous pousser à abolir les cloîtres, sous prétexte qu'ils ne proposent pas un mode de vie « naturel », constitue une généralisation hâtive. C'est justement parce que la vie des religieuses est centrée sur Dieu et non pas sur l'humanité que leur existence est singulière, elle est exigeante au sens où elle se détache de la plupart de nos instincts et de nos priorités de simples laïcs. Oui, bien sûr, cette vie n'est pas naturelle : elle est surnaturelle. le jour où elle cessera de l'être, il n'y aura plus aucun mérite à sacrifier pleinement sa vie à l'amour de Dieu. Inutile de dire que de telles idées devaient passer très difficilement, non pas dans le petit milieu philosophique iconoclaste que fréquentait Diderot, tout acquis aux efforts de déchristianisation, mais dans la société en général, où, en ces temps de troubles prérévolutionnaires, le clergé continuait de jouir d'un grand prestige auprès de la population. Remarquons d'ailleurs qu'en écrivain courageux mais pas téméraire, Diderot place habilement ces revendications à peine voilées dans la bouche de ses personnages, histoire de pouvoir arguer que rien ne prouve dans le texte que c'est son opinion à lui. En dépit de ces précautions, le texte ne paraîtra qu'après sa mort, dans un climat anti-chrétien plus favorable à la diabolisation du clergé. Diderot semble vouloir décourager les femmes laïques tentées d'entrer au couvent, en dépeignant la vie religieuse sous les aspects les plus sombres, les plus violents et les plus hypocrites. Il décrit avec une précision morbide les tortures physiques et morales infligées aux religieuses, comme les jeûnes forcés, les flagellations et les humiliations publiques. Ces descriptions, bien que choquantes, peuvent être perçues comme une tentative de sensibiliser le lecteur à des abus qu'il serait de mauvaise foi de nier au sein de communautés extrêmement ciblées, mais elles risquent aussi de donner une image déformée et caricaturale de la règle monastique. L'auteur prend ainsi un malin plaisir à se répandre en détails scabreux, tant du côté de la mortification physique et morale que de l'érotisme. Les scènes de violence et de souffrance sont décrites avec une minutie qui peut sembler gratuite, comme lorsque Suzanne est soumise à des brimades sadiques ou à des punitions corporelles. de même, les sous-entendus érotiques, bien que discrets mais de plus en plus appuyés, sont présents, notamment dans les relations ambiguës entre les religieuses et leur supérieure. Autant les longueurs sur le harcèlement moral et physique du premier couvent peuvent se justifier, elles donnent à ressentir un calvaire qui n'en finit pas, autant les schémas répétitifs et tordus de l'obsession amoureuse de la dernière supérieure de Suzanne relèvent d'un total esprit de provocation. En comparaison avec ces très longs développements, la fin du roman est très expéditive. L'oeuvre finit sans véritable issue, le destin de Suzanne reste suspendu aux décisions de l'interlocuteur auquel elle fait parvenir cette longue lettre. Dès lors, l'histoire en elle-même a moins d'intérêt pour l'auteur que ce qu'elle lui donne l'occasion d'attaquer, elle semble presque anecdotique à côté des épreuves que son héroïne a endurées. Malgré ces lourdes réserves, l'écriture de Diderot reste très élégante, et le roman est plutôt facile et fluide à lire, ce qui en fait une oeuvre accessible et captivante. Aussi, "La Religieuse" me laisse sur un avis plutôt mitigé. Si le style de l'auteur est indéniablement agréable, il me semble plutôt mal intentionné et certaines de ses critiques sont faites à l'emporte-pièce. le roman se lit certes facilement et offre une réflexion intéressante sur les abus et les injustices observées au sein de certaines communautés monastiques de l'époque. Cependant, il est important de ne pas prendre les descriptions de Diderot comme des vérités absolues, mais plutôt comme une critique exacerbée de certains aspects de la société, pas uniquement religieuse, d'ailleurs, de son époque. Je recommande donc cette oeuvre aux lecteurs qui ne partent pas avec un a priori négatif sur la vie religieuse ou sur le catholicisme, mais qui sont prêts à réfléchir de façon dépassionnée sur les thèmes complexes abordés par Diderot.
Mhfasquel
• Il y a 2 mois
La Religieuse de Diderot faisait partie des ouvrages que je souhaitais lire depuis des années. Et je ne l’ai pas regretté ! Diderot prête sa plume à Suzanne Simonin, jeune fille sacrifiée sur l’autel des convenances familiales et des hypocrisies sociales. Forcée à prononcer des vœux qu’elle n’a pas choisis, Suzanne devient, au fil des pages, l’incarnation d’un enfermement à la fois physique, moral et spirituel. Diderot, en philosophe du siècle des Lumières, dissèque avec minutie les jeux de pouvoir, les abus d’autorité et les violences ordinaires dissimulées sous le voile de la piété. Ce qui m’a le plus frappée, c'est cette voix féminine qui s'élève, fragile et tenace, dans un monde d’hommes et de dogmes. Suzanne reste fidèle à elle-même malgré l'enfermement et l’humiliation. Son récit, sous forme de lettres adressées à un mystérieux bienfaiteur, possède la force des confessions sincères. La Religieuse est bien sûr un pamphlet anticlérical, mais il a également une portée universelle : celle de tous les enfermements, de toutes les oppressions silencieuses et de cet irrépressible besoin de liberté. On pourrait également voir en Suzanne Simonin une réincarnation moderne de Psyché, cette figure mythologique très belle, mais naïve, condamnée à des épreuves imposées par Vénus. Comme Psyché, Suzanne subit l’autorité d’un monde qui lui échappe : celui de la famille, de l’Église et des conventions sociales. Toutes deux cherchent, chacune à sa manière, à préserver son intégrité et à reconquérir une forme de liberté. Si Psyché finit par retrouver Cupidon, Suzanne n’obtient qu’une liberté fragile et précaire, et doit affronter un monde tout aussi hostile que celui du couvent. Ce parallèle rappelle que, de l’Antiquité au siècle des Lumières, les récits de femmes contraintes et résilientes traversent les époques.
Gaia7
• Il y a 4 mois
Roman du XVIIIème siècle, féministe et anticlérical au temps des lumières. C'est l'histoire d'une jeune fille, rejetée par sa famille qui la contraint d'entrer dans les ordres et qui va subir toutes les humiliations possibles lorsqu'elle tentera d'en sortir. C'est bien sûr une critique de l'Eglise, et de tout ce système d'asservissement des âmes qui est déjà très critiquée par ses contemporains, mais pas une critique de la religion. On y parle pas d'athéisme. Suzanne croit bien en Dieu mais ce sont les institutions et leurs dérives que Diderot critique dans ce roman. "Jésus-Christ a-t-il institué des moines et des religieuses ? L'Eglise ne peut-elle absolument s'en passer ? Quel besoin a l'époux de tant de vierges folles ? Et l'espèce humaine de tant de victimes ?" Il y dépeint ce qui pour lui résulte de cet enfermement permanent: la violence, la folie. Dans la première partie, Suzanne va subir une multitude de tortures physiques et psychologiques, à tel point qu'on pourrait se poser la question du réalisme du roman. Pourtant dans la préface de mon édition, ils expliquent que ce point a été longtemps débattu mais qu'il existe effectivement des traces de ces comportements et l'histoire de son héroïne était tout à fait plausible dans certains couvents. Dans la deuxième partie, elle arrive dans un nouvel endroit, où sa nouvelle supérieure va s'éprendre d'elle. Celle-ci va manipuler la jeune et candide Suzanne pour l'amener dans son lit avant de sombrer dans la folie. On entre donc dans le registre des violences sexuelles et les frustrations que peuvent entraîner les vœux de chasteté. C'est également une critique de la société d'un point de vu féministe. Suzanne doit prononcer ses vœux pour absoudre le pêcher de sa mère et garantir la sécurité financière de ses sœurs qui sont passées sous la coupe de leurs maris. En réalité aucune d'elles n'a de libre arbitre dans ses choix de vie.
ZennYX
• Il y a 5 mois
C'est la deuxième oeuvre de Denis Diderot que je lis et je l'ai beaucoup plus apprécié que Jacques le Fataliste, où l'auteur faisait exprès de faire chier son lecteur. Je l'ai lu pour un cours. J'étais investi dans les malheurs de Suzanne, surtout quand j'ai su que ce roman est tiré d'une histoire vraie. Ce texte me conforte dans l'idée que le principe de chasteté est plus handicapant qu'autre chose. Ça provoque trop de frustration, en plus d'être contre-nature. Diderot ose, comme à son habitude, critiquer la religion et même parler de suicide (presque un tabou pour l'époque). En soit, toutes les religions ont des gros défauts parce que les humains sont extrêmement cons et qu'ils ne comprennent pas leur propre Dieu. Diderot remet donc en question certains principes de la religion chrétienne qui seraient discutables, plus que la religion dans son ensemble. Et c'est très bien.
Avis des membres
Fiche technique du livre
-
- Genres
- Classiques et Littérature , Littérature Classique
-
- EAN
- 9782266289924
-
- Collection ou Série
- Littérature - Classiques
-
- Format
- Poche
-
- Nombre de pages
- 288
-
- Dimensions
- 179 x 110 mm
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers où les mots s'animent et où les histoires prennent vie. Que vous soyez à la recherche d'un roman poignant, d'une intrigue palpitante ou d'un voyage littéraire inoubliable, vous trouverez ici une vaste sélection de livres qui combleront toutes vos envies de lecture.
3,90 € Poche 288 pages