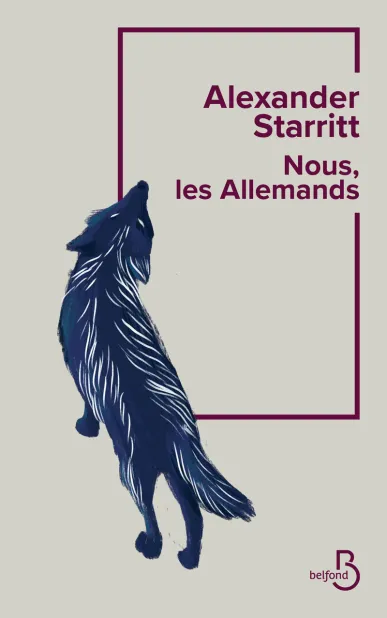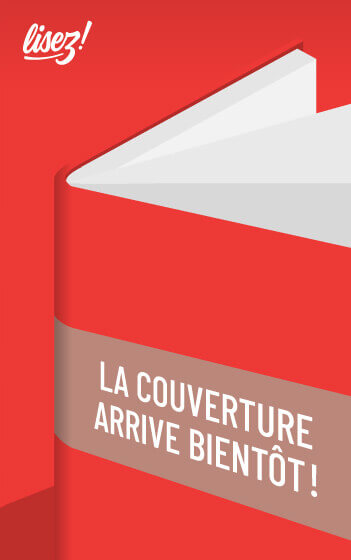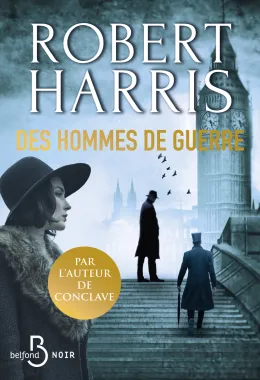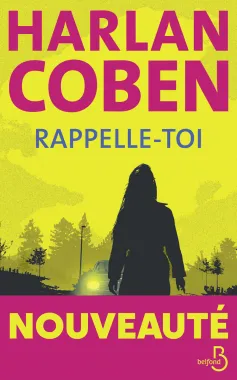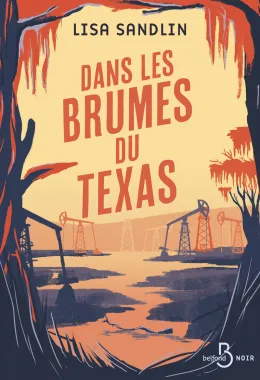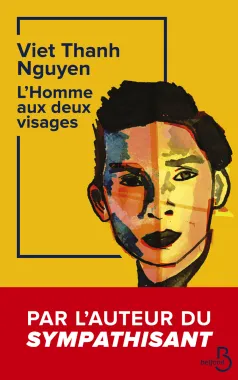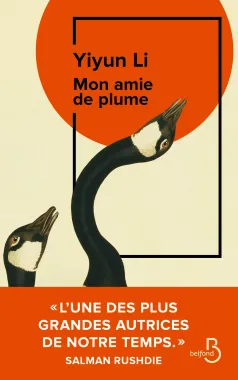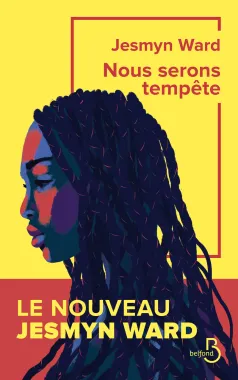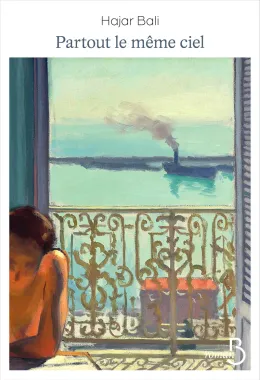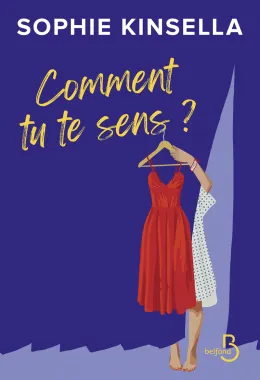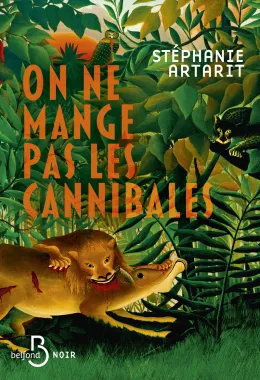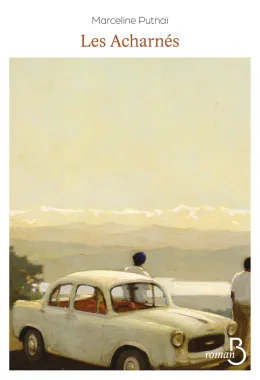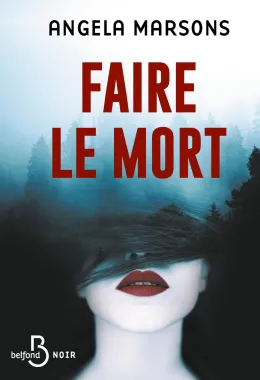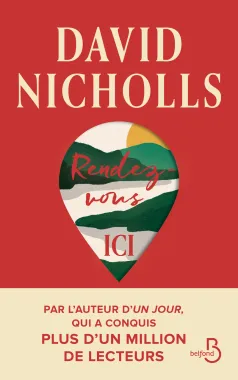Nous les Allemands : Le livre de Alexander Starritt
Je n'ai pas été un nazi. Ce que je veux te raconter ne concerne ni des atrocités, ni un génocide. Je n'ai pas vu les camps de la mort et je ne suis pas qualifié pour en dire un seul mot. J'ai lu le livre de Primo Levi sur ce sujet, comme tout le monde. Sauf qu'en le lisant, nous, les Allemands, nous sommes obligés de penser : Nous avons commis cela.
Longtemps, les questions posées par Callum à son grand-père allemand sur la guerre sont restées sans réponse. Et puis, un jour, Meissner s'est décidé à raconter.
Sa vie de soldat sur le front de l'Est, les débuts triomphants, l'esprit de corps, l'ivresse des batailles, et puis le froid, la faim, la misère. Et surtout l'année 1944 quand lui et ses camarades ont compris que la guerre était perdue ; que tout ce en quoi ils avaient cru, tout ce qui les faisait tenir, l'appartenance à une nation, l'espoir d'une guerre rapide, les rêves de retour, tout était en train de s'écrouler ; que dans la déroute, les hommes ne sont plus des hommes ; que le désespoir vous fait accomplir le pire et que rien, jamais, ne permettra d'expier la faute de tout un peuple.
De (auteur) : Alexander Starritt
Traduit par : Diane Meur
Expérience de lecture
Avis des libraires
Avis Babelio
lillen
• Il y a 7 mois
Dans nous, les Allemands, Alexander Starritt, offre un récit puissant et troublant, qui plonge au cœur des dilemme moraux de la seconde guerre mondiale. À travers la confession d’un soldat allemand à son petit-fils, l’auteur déconstruit, l’image du « bon soldat » et interroge la responsabilité individuelle dans les horreurs collectives. Avec une prose sobre mais incisive, le roman soulève des questions universelles sur la mémoire, la culpabilité et l’héritage. Un livre poignant qui invite à une réflexion nécessaire, bien que parfois pesant par sa densité morale.
JpMaurais
• Il y a 7 mois
Un petit fils s'interroge sur l'expérience vécu par son grand-père, soldat de l'armée allemande sur le front russe pendant la 2è Guerre mondiale. La réponse du grand-père prend la forme d'une lettre dans laquelle il raconte son aventure de l'automne 1944 et dans laquelle il exprime ses sentiments par rapport aux crimes commis. Le récit d'action est excellent et enivrant. Il transpose très bien l'état d'esprit dans lequel pouvaient être les troupes allemandes à l'automne 1944. Nous sentons comme si nous y étions le désespoir, le découragement, la nostalgie et la peur de ces hommes qui savaient que la défaite était inéluctable. Le contexte militaire de l'époque est par ailleurs très bien respecté par l'auteur et ajoute à la crédibilité du récit. En ce qui a trait à l'introspection du personnage principal par rapport aux crimes commis par l'Allemagne et à la culpabilité de celle-ci, je suis resté sur ma faim. En fait, les aveux du personnage principal à l'effet que l'Allemagne a mal agi, a commis des crimes et est coupable de cette guerre ne sont absolument pas supportés par le récit qui tend plutôt indirectement et subtilement à édifier le mérite militaire du peuple allemand, sa fierté, son courage et ses faits d'armes. Bref, il y a à mon sens incongruité sur cet aspect du roman. J'ai malgré tout adoré ma lecture.
Avis des membres
Fiche technique du livre
-
- Genres
- Romans , Roman Étranger
-
- EAN
- 9782714495662
-
- Collection ou Série
- Littérature étrangère
-
- Format
- Grand format
-
- Nombre de pages
- 208
-
- Dimensions
- 226 x 142 mm
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers où les mots s'animent et où les histoires prennent vie. Que vous soyez à la recherche d'un roman poignant, d'une intrigue palpitante ou d'un voyage littéraire inoubliable, vous trouverez ici une vaste sélection de livres qui combleront toutes vos envies de lecture.
20,00 € Grand format 208 pages