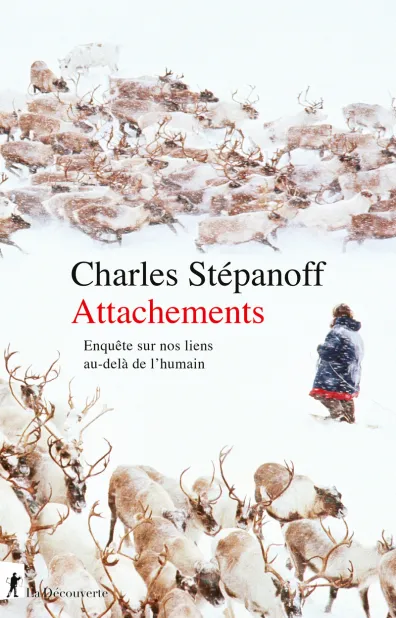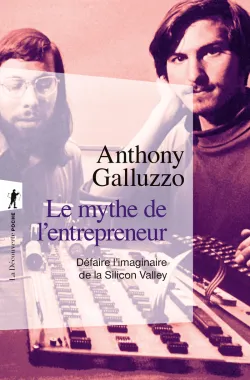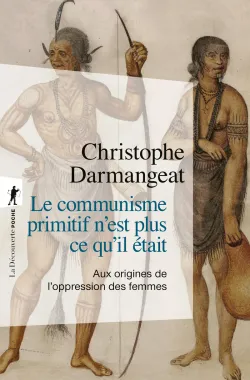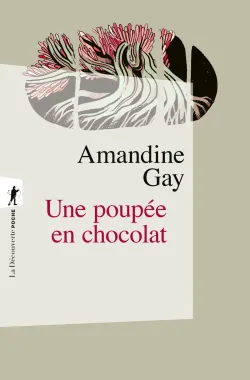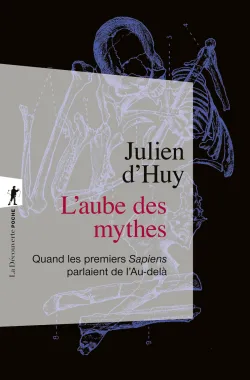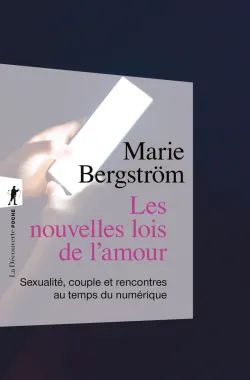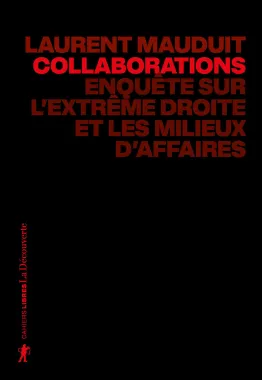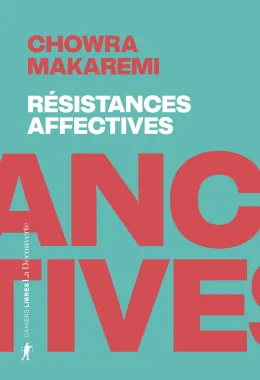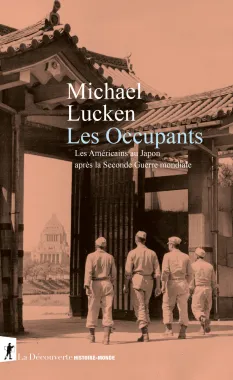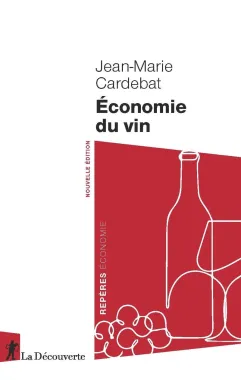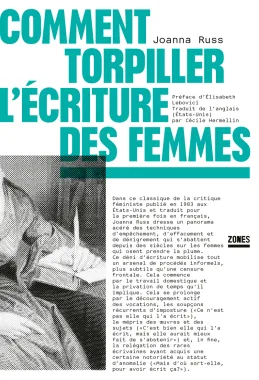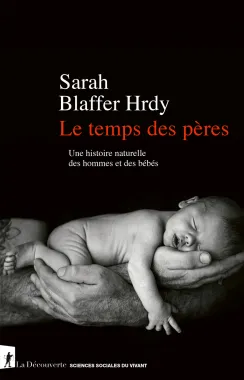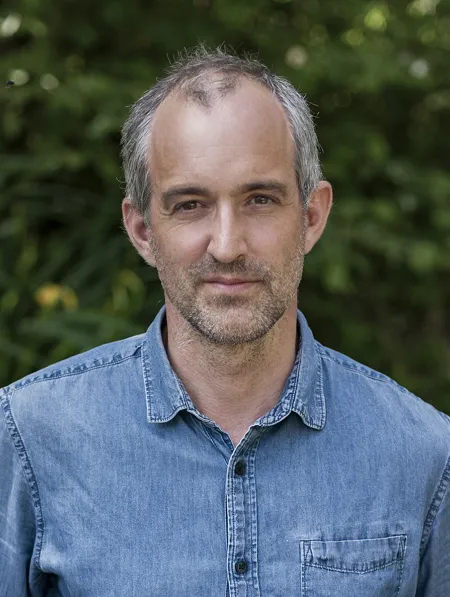Attachements. Enquête sur nos liens au-delà de l'humain : Le livre de Charles Stépanoff
Comment nous relions-nous à notre environnement et comment nous en détachons-nous ? Comment en sommes-nous arrivés à vivre dans des sociétés dont les rapports au milieu vivant se sont appauvris au point de menacer notre monde de devenir inhabitable ?
On a longtemps défini les humains par les liens les unissant les uns aux autres. Or ils se distinguent aussi par les relations singulières qu'ils établissent au-delà d'eux-mêmes, avec les animaux, les plantes, le cosmos. Sur tous les continents, chasseurs-cueilleurs, horticulteurs ou pasteurs nomades interagissent de mille manières avec une multitude d'autres êtres. Partout, les groupes humains s'attachent affectivement à des animaux qu'ils apprivoisent et avec lesquels ils partagent habitat, socialité et émotions. Notre ouverture à l'altérité va même plus loin. Nous établissons des relations fortes avec les esprits des montagnes et des fleuves, avec des dieux ou des ancêtres. Nous sommes étonnamment polyglottes, capables d'échanger avec un oiseau, une étoile, un esprit. Longtemps ignorée, cette disposition apparaît fondamentale dans le rapport singulier que nous avons construit avec notre environnement au fil des millénaires.
En s'appuyant sur l'anthropologie évolutionnaire, l'archéologie, l'histoire, l'ethnographie et ses propres enquêtes de terrain menées en Sibérie et en France, Charles Stépanoff compare différents contextes anciens et actuels, proches et lointains, où les humains s'attachent d'autres espèces. Au fil d'un parcours captivant qui l'amène à repenser intégralement des phénomènes fondamentaux comme le processus de domestication, la genèse des hiérarchies ou la construction des États prémodernes, il explore cette question inédite : comment les attachements au milieu vivant transforment-ils les organisations sociales ?
De (auteur) : Charles Stépanoff
Expérience de lecture
Avis Babelio
4bis
• Il y a 10 mois
Aaahrrr… Bong ! Punaise ! Excusez cette arrivée en fanfare, j’ai buté sur mon chat. Lequel anticipe avec une sagacité inouïe, même lorsque j’envisage de contre carrer mes propres plans et d’aller à revers de là où je pensais initialement me diriger, l’endroit exact où je poserai mon prochain pas afin d’y inscrire sa propre trajectoire, au train d’un sénateur en phase postprandiale, à contre temps de mon rythme propre donc, s’assurant ainsi que je ne l’évite que d’extrême justesse, voire que, propre à rien que je suis, je ne le percute. Délibérément, semble me dire son grincement indigné. (Oui, mon chat roucoule, grince, cause et tance mais ne miaule pas.) Vous me direz, c’aurait pu être pire et j’aurais pu achopper sur un faon, un cochon sauvage, un kangourou ou un ours. C’est très fréquent dans toutes sortes de sociétés humaines. Souvent, les hommes ramènent de la chasse un bébé animal orphelin et les femmes le couvrent de leurs soins. L’une d’entre elles l’allaite, le choie particulièrement au point de le considérer comme son enfant, voire le nourrit tellement qu’il en devient obèse. C’est ce qu’on appelle l’apprivoisement, dérivé de nos facultés extraordinaires à communiquer avec qui n’est pas de la même espèce que nous, à commencer par les bébés. Il ne faut en effet pas avoir beaucoup d’expérience ni grand sens de l’observation pour constater que ces derniers n’ont rien à voir avec nous. Chair de notre chair, peut-être, mais infichus, à trois semaines, de discuter des chances de Jurassic Moire dans la 4e à Vincennes, de nous donner un coup de main pour rentrer le salon de jardin ou étendre les monstrueuses lessives provoquées par leur apparition. Nous regarder d’un air insondable et capter notre attention H24 au point de zombifier tout leur entourage proche, ça, en revanche, c’est bien leur domaine. Tellement que, selon certains récits, ils sont les passeurs d’un monde invisible, la manière qu’ont trouvée de vieilles âmes de revenir sur terre. Bref, des pas comme nous du tout à qui il va falloir prodiguer moult purée de carotte en faisant l’avion, comptines et charabia aux voyelles allongées pour les anthropomorphiser et les faire ressembler à quelque chose (genre, à nous). L’humain est donc capable de s’attacher à autre que lui, à l’apprivoiser suffisamment pour en faire un proche et cette compétence lui viendrait en grande partie de la nécessité où il se trouve de chasser sa nourriture. Pas très robuste, pas très rapide, pas très impressionnant ni naturellement très armé, il lui faut au moins de fabuleuses capacités de projection dans la peau de sa proie pour être capable de la suivre, d’anticiper sa trajectoire et d’imaginer par où elle aurait aimé passer quand on l’a perdue. (Ce qui me fait réaliser que, c’est certain, mon chat se prend pour un humain sur le sentier de la chasse. Mais pour qui me prend-il, moi, alors ? Une croquette géante ? Est-ce que je veux vraiment le savoir ?). Ce sont ces compétences empathiques que l’homme met ensuite au service du soin qu’il prodigue à tout ce qui n’est pas lui : bébés, animaux apprivoisés ou esprits avec qui il communique. Vous me direz que c’est un peu retors tout de même de mettre notre empathie au service d’une traque. Vous pourrez d’ailleurs voir une confirmation à votre indignation en apprenant que, souvent, les mignonnes petites bêtes qui ont été amoureusement nourries et choyées sont ensuite exécutées et servies au cours d’un grand festin. Le Petit Poucet, Hans et Gretel et La Belle au bois dormant n’avaient donc pas menti (ah, la sauce Robert !). Effectivement, c’est un tantinet gênant et c’est justement à partir de cette « incompatibilité affective » qui empêche (normalement) qu’on trucide et dévore aisément qui on a nourri que réside, pour Charles Stépanoff, , l’auteur de ce formidable Attachements, un des fondements de nos organisations humaines. Aux uns le soin, aux autres la chasse. Sans que ce soit irrévocable d’ailleurs, les sociétés en lien avec leur environnement sont souvent très souples et très labiles dans leur fonctionnement. Durant le banquet, on peut aussi exclure le chasseur afin qu’il ne se régale pas de celui qu’il a tué. Ou répartir les morceaux entre les convives en fonction du rôle qu’ils ont joué dans cette aventure, laissant ceux qui sont les moins porteurs de résonnance émotionnelle à ceux qui ont prodigué les soins. Si vous voulez frimer, retenez qu’on appelle cette production de contrastes entre les individus la schimogenèse. Mais ce qui compte vraiment, c’est que l’homme est à la fois un chasseur carnassier et quelqu’un capable de tisser des liens étroits avec les autres vivants, ce que Charles Stépanoff appelle un prédateur empathique. C’est de cette ambivalence constitutive que découle notre rapport au monde. Il se trouve qu’étudier les sociétés humaines depuis cette ambivalence rassemble de manière assez synthétique bien des divergences à travers les millénaires et les continents. Mieux, sont ainsi expliqués des traits évolutifs qui pourraient paraitre autrement bien difficiles à comprendre. Pourtant, me direz-vous, nous avions auparavant un modèle tout à fait robuste et convaincant : depuis le néolithique, l’homme a domestiqué bétail et céréales, devenant ainsi capable de faire des stocks, de les échanger contre d’autres biens désirables mais troquant sa vie nomade pour une sédentarisation le rendant esclave de ses cultures. Le début de la fortune et des emmerdes. Prenant le pas sur la création, l’homme n’a alors eu de cesse d’améliorer les espèces, de rationaliser les espaces afin de les rendre plus productifs. Asséchant les marais, sélectionnant les bêtes les plus robustes, optimisant le cours des fleuves, l’homme n’a pas eu trop de son intelligence pour, siècle après siècle, s’émanciper de son statut initial précaire. Home sweet home, les bestiaux à l’étable, les loups dans les histoires, les bégonias en rang d’oignon et les vaches seront bien gardées. Yuval Noah Harari et son célébrissime Sapiens : une brève histoire de l’Humanité est le dernier vulgarisateur en date à nous relater cette fabuleuse épopée vers l’âge moderne. Eh bien, grande nouvelle, vous pouvez faire des allume feu de ces théories ! Les dernières découvertes archéologiques, les dernières analyses de graines, de squelettes d’animaux, trouvés dans les tombes, les démentent scrupuleusement. Elles ne sont que le décalque d’une vision ethnocentrée du monde, un gigantesque et très récent anachronisme, plaquant sur la préhistoire des conceptions ne datant que du milieu du 18e siècle et des écrits de Buffon notamment, largement déployées par tout le 19e siècle ensuite. Considérer l’homme comme domestiquant une nature hostile, la pacifiant comme un jardin à la française, c’est endosser le vêtement d’un scientifique occidental interprétant la réalité avec un prisme que même Darwin ne défendra pas tel quel. C’est épouser une idéologie permettant la colonisation de nouvelles terres au nom de la diffusion d’un progrès qui n’en est un que pour ses promoteurs puisqu’il les enrichira à mesure qu’il dépouillera ceux dont il viendra happer les ressources, les forces vives, éradiquer les cultures, les représentations et les traditions, couper des peuples entiers de leurs moyens de subsistance, les rendant ainsi dépendant du nouveau pouvoir politique et économique qu’il leur impose. C’est très Napoléon III, quoi. URSS version Lénine aussi pour ce qui concerne les Tozhu qui vivaient en Sibérie un pastoralisme extensif avec de petits troupeaux de rennes et que l’on a obligé à pratiquer une agriculture intensive, pseudo rentable et complètement dépendante des réseaux institutionnels, vétérinaires, économiques du système centralisateur. La démonstration que fait Stépanoff est sans appel et les dégâts sur ces peuples décimés colossaux. Il n’y a eu aucune révolution irrévocable au néolithique, qu’on se le dise. Depuis des millénaires, et encore à ce jour, hors de la sphère d’influence de notre impérialisme occidental, les liens qu’entretiennent les humains leur environnement au sens ontologique du terme, font de ces animaux, végétaux, esprits invisibles des forces propres, possédant une agentivité aussi importante que celle des hommes pour modeler le monde. Aucun surplomb d’emblée mais une collaboration étroite, en évolution permanente, autour de la régénération du monde. Charles Stépanoff n’a pas lu Emilie Hache et sa De la génération, vue la taille de sa bibliographie, je ne vais pas le lui reprocher même si les analyses que développe la chercheuse donneraient beaucoup plus de lest encore à certaines parties, plus diachroniques, de cet essai. Reste que, sans l’avoir lue, il confirme l’hypothèse d’Emilie Hache et donne à ce qui nous parait être une norme universelle, le statut bien plus réel d’une distorsion occultant un rapport aux autres qu’humains fait de multiples liens réciproques tel qu’il est vécu par bien d’autres sociétés. On peut se demander pourquoi, alors que nous sommes si doués pour considérer vivants et esprits avec tant d’empathie, on se retrouve aujourd’hui à quelques milliards d’individus coupés de notre environnement au point de ne nous nourrir que de malbouffe hydrogénée, polysaturée depuis un minuscule T2 où les seules autres espèces vivantes avec nous sont des acariens. A quel moment ça a décroché ? Charles Stépanoff analyse les évolutions en termes d’effet de cliquet, ce moment où un cap est passé, et de boucles de rétroactions qui décrivent cet état où la conséquence d’un fait touche des éléments qui l’avaient déclenché et en majorent l’effet. Avec de tels phénomènes, on voit que des situations peuvent évoluer selon une logique où différents éléments collaborent à un état jusqu’à ce que, pour des raisons dont les conséquences échappent assurément aux acteurs, on atteigne un stade qui ne soit plus à l’équilibre et que l’on bascule alors dans une autre situation. C’est ce qui se passe par exemple lorsque les troupeaux de rennes sont trop gros pour que les hommes puissent avoir une relation interpersonnelle avec chaque animal, lorsque la culture de la patate douce permet d’engraisser assez de porcs pour qu’ils dépassent les besoins locaux et alimentent d’autres usages. Bien sûr, l’anthropologue ne juge pas plus qu’il n’indique quel système serait vertueux. Il retrace les étapes menant à cette évolution. Pour ce qui concerne notre situation actuelle d’hommes modernes déphasés et dépassés entre autres par le changement climatique que nous avons provoqué, l’hypothèse de Stépanoff s’appuie sur ces mêmes chaînes, retrace l’édification des Etats modernes et la manière dont leur organisation mise sur un détachement des denrées et des personnes. Allez le lire, c’est passionnant. Ce livre est un traité d’anthropologie, oui, mais c’est aussi, de par sa dimension diachronique, l’originalité de son point de vue et l’ampleur des champs abordés, un voyage extraordinaire à travers le monde et le temps, une proposition à reconsidérer la définition de l’humain. Non plus comme un être surplombant le reste de la création, ni comme une créature à la bonté angélique seulement contrecarrée par quelque nature première pécheresse mais comme un être paradoxal, carnassier doué d’une capacité d’ancrage et de relation avec les autres lui permettant d’interagir avec son milieu, d’être une partie prenante d’un tout bien supérieur à sa seule existence. A ce compte, l’humain est bien plus collaboratif, créatif et domestiqué que certains grands singes seulement mus par une volonté de satisfaire leurs propres besoins et de dominer les autres. Dominer, vous avez dit dominer ? Mais au fait, que dit Stépanoff de la (funeste) théorie élaborée par Lahire à propos de l’altricialité secondaire et de sa tragique conséquence imposant aux femmes et aux enfants une implacable domination masculine toute société humaine confondue ? Eh bien, il l’envoie balader. Texto. Yeeeppppeee ! Pour lui, l’altricialité secondaire n’impose pas la domination, la preuve en est que les chimpanzés, les bonobos et les gorilles ne connaissent pas cette même altricialité secondaire et ont pourtant des organisations sociales incontestablement despotiques. D’ailleurs, même s’il ne citait pas explicitement Bernard Lahire, il est évident que les recherches de Stépanoff contredisent celle du sociologue tant le mouvement, le changement dans les rôles et postures, la fluidité des échanges avec le monde sont au cœur de ses descriptions, tant il s’éloigne en cela d’un modèle institutionnalisant éternellement la subordination d’un acteur sur les autres. Il s’agit là encore d’un avatar du « grand récit moderne des origines [qui] manifeste une logique mythique et relationnelle propre à l’Occident moderne », mythe moderne au « fondement anthropocentré et viriliste ». Placer « la volonté humaine au cœur des processus vitaux est [une façon de faire] singulière, récente, étrange » et Lahire n’aura pas échappé à ce biais. Je ressors de cette longue et belle lecture absolument enchantée, la tête pleine de vaines pâtures, d’aigles et de chants, confortée dans ma compréhension de la place des êtres et des idées dans l’avènement du monde. Il y a dans la variété des modes de faire décrits une richesse envoutante, dans les paysages, coutumes et visions relatées une poésie en acte qui donnent l’impression que quelque chose est encore possible, que nous avons, au fond de nous, cette capacité à reprendre langue avec ce qui nous entoure, forces invisibles, paysages et autres vivants. A nous accorder à nouveau avec eux.
Michel69004
• Il y a 10 mois
Le TGV s’enfonce dans le brouillard du Morvan puis émerge brièvement dans un paysage prairial où, comme c’est l’usage, paissent quelques vaches voyeuses et nonchalantes. Je pose mon surligneur et accroche mon porte-mine à la couverture du gros livre que je referme. Un Thozhu, chasseur-éleveur de Sibérie du Sud, veille sur un troupeau de rennes en plein mouvement. La couverture d’Attachement s’offre à la vue des autres voyageurs qui sont immobilisé sur leurs écrans. Dommage, cette couverture est très belle : Charles Stépanoff Attachements Enquête sur nos liens au-delà de l’humain Il me reste une centaine de pages. Je finirai tranquille, à la maison. Pas mal de choses à digérer dans ces cinq cents premières pages qui, pourtant, se lisent comme un roman. Ou, en ce qui me concerne, se visionne comme une série. Trois saisons de sept épisodes qui nous transportent aux quatre coins du monde et à toutes les époques. Un série haletante qui bouscule beaucoup d’idées reçues, change radicalement les paradigmes anthropologiques classiques, même les plus récents. Charles Stépanoff ? Qui c’est celui-là ? J’avais lu il y a une petite décennie Le Chamanisme de Sibérie et d’Asie centrale et puis j’ai retrouvé Charles dans plusieurs références chez Philippe Descola et Nastassja Martin. Plus récemment, nous l’avons croisé dans le Lahire (Les structures fondamentales des sociétés humaines). Jeune anthropologue normalien, Stépanoff a fait de longues enquêtes de terrain, en immersion chez plusieurs groupes ethniques de Sibérie et de Mongolie mais aussi en Alaska et en Amazonie. La parution de ce livre est donc un petit évènement ! L’auteur démontre comment notre rapport au vivant influe sur nos modes d’organisations sociales et politiques et se propose de revisiter notre conception de l’écologie politique pour sortir enfin de notre vision occidentalo-centrée. Déconstruire des modèles universels qui seraient les paradigmes récents des sociétés occidentales modernes -les WEIST( Western, educated ,industrialized, rich and democratic)-, c’est forcément s’opposer à Yuval Harari et à Bernard Lahire . Pour dégager d’autres hypothèses que celle du primat de la domination, partout et de tout temps… Ou, pour le dire vite et autrement, il y a eu et il y a toujours des sociétés qui fonctionnent très différemment de ce que nous connaissons, qui fonctionnent plutôt beaucoup mieux car sans hiérarchie constante, sans domination , avec une densification des réseaux socio-écologiques et avec un impact positif sur les écosystèmes. Pour cela, Stépanoff va nous proposer un grand voyage initiatique pour nous faire entrevoir les relations complexes et variées que les hommes entretiennent avec eux-mêmes, avec les animaux, avec les plantes et avec les esprits. On parlera de ces relations en terme "d’attachements". Les attachements entre les humains ont pris le pas sur la relation à notre environnement alors que de nombreuses autres sociétés humaines considèrent comme fondamentaux leurs rapports à la montagne, à la rivière, aux rennes, aux cochons et aux céréales (par exemple). Et c’est le principal problème. Mais Stépanoff est plutôt optimiste, il croit en la résilience du vivant et propose même des alternatives à l’effondrement… Les hommes sont des prédateurs empathiques. Absolument. Ils tuent des animaux (et prélèvent du bois) mais cela impliquent empathie et identification partielle avec des êtres que nous mangeons. Il faut être capable d’empathie pour traiter un animal doté d’intelligence, de désir, de souffrance, d’attachement, pour pouvoir prendre sa vie. J’ai découvert par exemple les festins rituels où l’on ne mange jamais son propre animal mais où on l’offre à un voisin ou à un autre clan. L’évolution nous a transmis ce cuisant paradoxe mais n’a pas donné de solution univoque pour le résoudre. Sauf à developper une véritable intelligence écologique (accumuler des savoirs complexes sur les plantes et les animaux, détecter des subjectivités non humaines, nouer des réseaux denses de liens multi-fibres, développer des règles morales d’interactions avec limitation des prises et procédures de régénération). Saviez-vous que cinq pour cent des humains seulement jouent avec leur bébé, les isole dans une chambre et privilégie la parentalité proximale, tactile et olfactive. La parentalité distale, visuelle et auditive, permet aux enfants, confiés aux groupes, d’avoir plus d’autonomie et de moins subir l’altricialité secondaire. Saviez-vous que la parentalité humaine est une relation inter-espèce ? Qu’on apprivoise des aigles, des cochons, des varans, des anguilles, des sauterelles, des scarabées et même des blattes ? Que des femmes les maternent ? Que des femelles humaines allaitent chiots, dingos, opossums, porcelets, oursons, ratons laveurs, léopard, faon, castors, éléphanteaux etc…? Que ces animaux sont des substituts d’enfants avec lesquels on pratique la polyglossie? Que plus globalement, l’art d’enchanter les bêtes avec un répertoires musicale est connu jusque dans les steppes de Mongolie (calmer un mouton ou bercer un enfant, c’est la même chose!)? Que les chamanes sont indispensables comme intermédiaire avec l’invisible et le monde des esprits ? Que notre société n’est pas le centre de l’univers? Et que le rituel est une tentative de recréer l’authenticité perdue d’une transparence avec le monde ? Charles Stepanoff est aussi un conteur magnifique qui nous emmène avec lui dans les monts Saïan pour évoquer comment les Thozhu ont pu survivre à l’effondrement de l’Union Soviétique et à la perte de quatre-vingt dix pour cent des troupeaux de rennes. Pour cela, ils se sont ensauvagés, créant avec l’animal un véritable "pacte domestique" : l’humain le domestique tout en le gardant sauvage. Il crée des liens coopératifs, affectifs et rituels qui en font des quasi-personnes. Passer quelques dizaine de pages en Sibérie sur ces itinéraires et paysages partagés, a été un éblouissement. Puis l’auteur survole d’autres contrées, d’autres cosmologies, d’autres cultures : compagnonnage et autonomie alternent dans le mode de relation humains-animaux qu’il nomme "coexistence intermittente". Charles consacre de nombreuses pages à déconstruire une certaine histoire de la révolution agricole et de la domestication qu’il juge monolithique et unilinéaire. Il s’oppose radicalement aux thèses de Yuval Harari et tacle dans le même mouvement Bernard Lahire : "Philippe Descola a montré que l’opposition dualiste entre sauvage et domestique est une construction propre à l’occident qui ne se généralise qu’avec la modernité et son ontologie naturaliste séparant nature et culture" Pour illustrer ce que Foucault nommait "biopouvoir", il va présenter longuement les techniques d’inséminations perpétrer à l’École vétérinaire d’Alfort et l’école des bergers de Rambouillet (qui existent toujours).L’électro-éjaculation (Gasp! Quelle horreur!) y était une technique-phare ! Pour Stépanoff, le berceau de la domestication n’est pas le néolithique mais le Jardin d’acclimatation de Napoléon III, lieu de toutes les expériences, y compris des sélections les plus incestueuses (on croise un mouton avec une brebis puis avec sa fille puis sa petite-fille etc.). L’anthropologue milite pour des communautés hybrides : "Il est crucial de libérer le domestique du pesant mariage arrangé qu’on lui a imposé car cette union est scientifiquement stérile" Il déploie alors un vibrant plaidoyer pour l’"écologie paysanne" qui se noue autour d’un "pacte domestique". La dernière partie est sans doute la plus stimulante et mériterait sans doute un livre entier. Mais Charles Stépanoff n’est pas un historien… "Inégalité et rupture écologique" est un essai en soi qui tente de préciser le rôle de l’Etat dans les "attachements au-delà de l’humain", sources de schismogénèse: "Il n’est pas surprenant que les communautés autochtones et paysannes qui tissent des réseaux denses et des identifications paradoxales entre humains et non-humains soient aussi celles qui constituent le masculin et le féminin de l’interdépendance réciproque". Et puis il sera question de chamanisme, d’esclaves et de monnaies, que Stépanoff adosse à la mécanique du pouvoirs et au renforcement des inégalités… Foisonnant d’exemples, le récit de l’émergence des cités nous emmènera depuis Cnossos jusqu’à la chute de Rome, nous perdant parfois en chemin entre les porcs-enfants et les artisans plumassiers. "Devenir moins dépendant de l’économie politique, c’est reprendre en main collectivement un attachement envers le milieu vivant, au lieu d’en déléguer la gestion à l’État. Il s’agit de remplacer des dépendances politiques par des interdépendance communautaires et écologiques" C’est donc tout un programme : "Il existe dans le monde entier des « refuges bio-culturels » où des communautés locales entretiennent jardins vivriers, petits champs, vergers, mares, vignes et bosquets pour leur usage. Leurs pratiques et leurs savoirs locaux façonnent de riches mosaïques écologiques qui sont sources d'autonomie alimentaire pour les populations et d'habitat pour la biodiversité'. Ces refuges sont prêts à irriguer de vastes zones alentour et à féconder les imaginations. À chaque génération, les bébés humains naissent porteurs d'extraordinaires talents pour l'intelligence écologique qui ne demandent qu'à aller à la rencontre du monde et à nouer de nouveaux attachements métaboliques et imaginatifs. L'humain ne cessera pas de sitôt d'être un animal attaché et attachant." La moral de ce livre incroyablement érudit et très référencé est assez logique: Retrouvons les savoirs anciens, allons vers la dé-civilisation et le ré-ensauvagement, allons vers la dé-mondialison pour retrouver des réseaux denses et revivifiés. Il ne s’agit pas de faire la révolution et de tout détruire mais de faire co-exister les modes de vie. Au cas où . Où tout s’effondrait … Et bien sur, ré-inventons l’école. Apprenons à nos enfants le chant des oiseaux, le nom des arbres, l’art de vivre avec les animaux. On le voit "Attachements" est un livre important, une sorte de chainon manquant théorique qui m’a ému et provoqué en moi, malgré de toutes petites restrictions, une véritable épiphanie cognitive.
Avis des membres
Fiche technique du livre
-
- Genres
- Sciences Humaines & Savoirs , Sciences Humaines & Sociales
-
- EAN
- 9782348081149
-
- Collection ou Série
-
- Format
- Livre numérique
-
- DRM
- Filigrame numérique
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers où les mots s'animent et où les histoires prennent vie. Que vous soyez à la recherche d'un roman poignant, d'une intrigue palpitante ou d'un voyage littéraire inoubliable, vous trouverez ici une vaste sélection de livres qui combleront toutes vos envies de lecture.
18,99 € Numérique