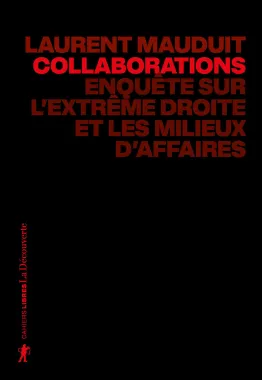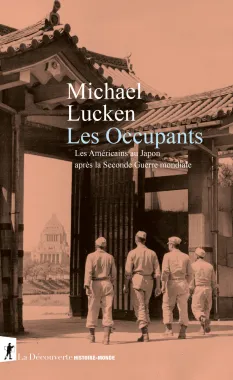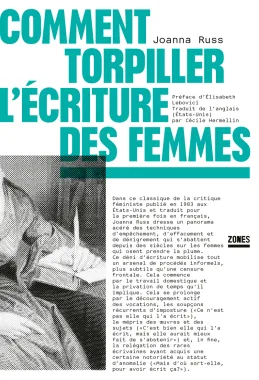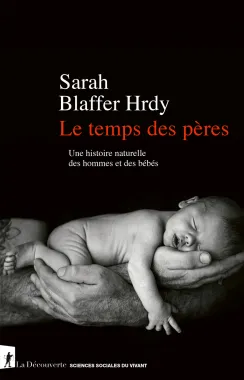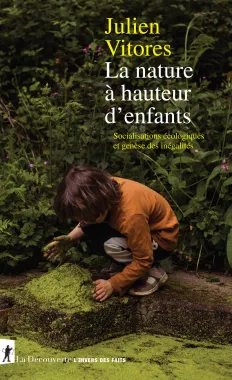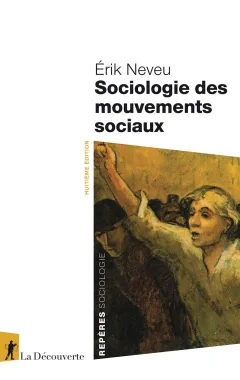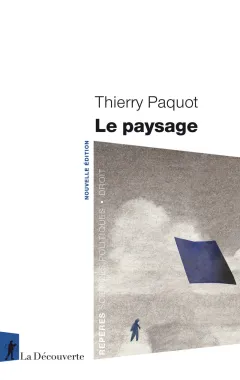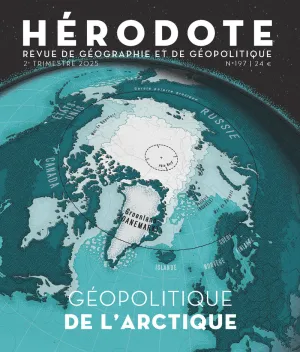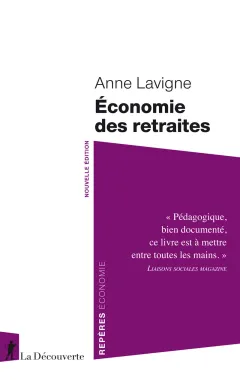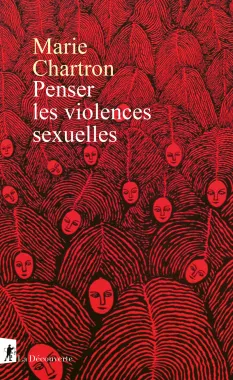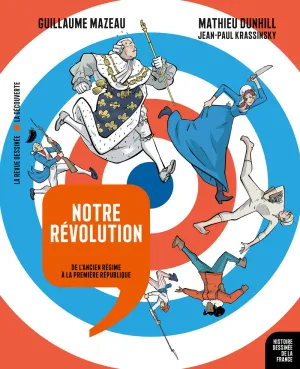La nouvelle Turquie d'Erdogan : Le livre de Ahmet Insel
À la suite du coup d'État avorté de l'été 2016, Recep Tayyip Erdogan a lancé une très vaste opération de purge des différents services de l'État – mais aussi de la société civile. Cette reprise en main est l'aboutissement d'un long processus.
Depuis 2002, la Turquie est dirigée par l'AKP (Parti de la justice et du développement) et par son leader charismatique. Ce pouvoir " musulman-démocrate " a profondément modifié le pays mais le bilan de ce long règne est ambivalent. Les avancées sur le front de la démocratisation ont progressivement laissé place à un autoritarisme rampant et à une politique de réislamisation de la société. Les négociations avec l'Union européenne sont au point mort. Des pas courageux pour la résolution du problème kurde ont été remplacés par une nouvelle offensive répressive, qui s'est étendue à l'ensemble des revendications démocratiques et a révélé le visage autoritaire du pouvoir et sa volonté de mise en place d'un régime présidentiel fort, clairement revendiquée.
Dans cet essai documenté, Ahmet Insel nous éclaire sur les facteurs d'ascension de l'AKP, la stratégie politique et la persistance des succès électoraux d'Erdogan malgré les affaires de corruption, l'installation progressive de l'arbitraire et la lutte avec la communauté Gülen. Il montre ainsi les tourments de la société turque, tiraillée entre les conflits ethniques, religieux et culturels, entre peur de perdre son identité socio-historique et désir d'être dans le monde moderne.
Prix France Turquie 2015
De (auteur) : Ahmet Insel
Expérience de lecture
Avis Babelio
Enroute
• Il y a 1 semaine
Quel dynamisme que la politique en Turquie ! L’impression d’un ouragan permanent. Ce qui manque, sur le dernier siècle, ce n’est ni la liberté d’expression, ni l’activisme, mais, peut-être, le maintien du projet, la consolidation, l’intégration internationale. Il n’est toujours question que d’opposition, même pour la majorité. Quand elle s’installe, elle réduit inexorablement toutes les contestations – les minorités, les règles, les lois, les institutions. Devenue hégémonique, elle n’a plus rien à faire que tenir, maintenir, interdire. Quel peut être l’avenir d’une communauté politique parvenue à la conscience de soi et capable de conférer le pouvoir à qui la sert quand ce pouvoir a si bien intégré les règles de la politique qu’il parvient à s’octroyer sans fin l’adhésion massive de la population ? Ses programmes jonglent avec les valeurs en vogue, sa législation adaptent les règles constitutionnelles… La population accepte tout parce que les partis s’adaptent à tout… Parvenu ensemble au sommet, que reste-t-il à faire ? La Turquie à cette lecture ne manque ni de dynamisme ni de moyens, mais il manque une finalité, une anticipation – une théorie peut-être. On dirait la situation des États européens à la Belle époque : le modèle politique est achevé, la pratique tourne en rond, manque d’idées, ou se résorbe, violente, sur lui-même. C’est comme aux États-Unis : le chef de l’exécutif s’assimile au souverain populaire et, confondus ensemble, ils n’ont plus rien à se dire : ils s’invectivent et insultent le monde. Le plein engagement de la nation répond au plein engagement de la politique. Pour quoi, désormais ? L’internationalisme en Europe a été la solution, la voie d’échappement des engagements internes trop bien installés. L’Union européenne depuis ouvre des perspectives internationales de déploiement des énergies internes. Mais en Turquie ? Autour, il n’y a rien : la Syrie et l’Irak sont disloquées, la Russie est menaçante, Ie Liban est affaibli, Israël fait cavalier seul, l’Égypte aussi. Reste l’Union européenne. C’était la voie d’il y a un quart de siècle. Tout allait très bien les premières années. Et puis plus rien. Découragement, insatisfaction, manque de volonté, d’inspiration, blocages réels du fait des événements qui atermoieraient nécessairement la reprise des réformes ? On peut aussi penser que l’adhésion à l’Union européenne n’était alors – et ne serait toujours – pensée qu’à la manière de cet esprit contestataire et concurrentiel qui traverse la Turquie moderne : chouette, encore un objectif à atteindre, encore un prétexte de mener la lutte ?... Pus que l’adhésion, est-ce que ce n’est pas le maintien des relations internationales et leur renforcement permanent qui serait la finalité de la politique de tout État parvenu à maturité – et maintenant la seule perspective pour la Turquie ? Puissance régionale et mondiale indubitable, qu’a-t-elle d’autre comme avenir que d’œuvrer à propager la stabilité politique autour d’elle – ce qui pourrait renforcer la sienne en interne ? Si elle le fait, on l’accuse d’impérialisme ottoman… misère que la solitude… ****** Le livre est écrit en un sens de cette manière activiste de concevoir le réel et opportuniste de le présenter : les chapitres répondent à des questions un peu arbitraires et reprennent la même histoire en composant différemment le sens – et partiellement. C’est un peu pénible, parce qu’on recommence sans arrêt la même histoire et qu’il faut tourner les pages pour comprendre des consécutions qui n’apparaissent pas. Chaque chapitre est « monolithique », avance comme un succès : un début, un développement, une conclusion, donc un achèvement. On se laisse souvent entraîné par les facilités de voir un maître en politique #119901;#119906;#119894;#119904;#119902;#119906;’il réussit tout, une volonté autoritariste #119901;#119906;#119894;#119904;#119902;#119906;#119890; c’est le résultat que l’on observe. Or, en réalité, il n’en est rien. Un seul exemple : sur le dernier chapitre, sur le personnage, son ascension est présentée comme linéaire. Il faut se souvenir avoir lu qu’il a été emprisonné et interdit de vie politique pour reprendre le texte qui est proposé, ce qui en modifie sensiblement le sens ! Ce qui ressort, ce n’est pas le cynisme d’un sultan réincarné, c’est une résilience, un dynamisme et une souplesse politique incroyable : dommage que parvenue au sommet du pouvoir, elle ne trouve plus à se relayer au-delà… Et l’Union européenne qui refuse de lui souffler des idées… On regrette aussi beaucoup de silence : les réfugiés syriens et les accords sur les migrants avec l’Ue n’ont donc pas eu plus d’importance que cela ? La guerre en Irak non plus ? Le rôle des États-Unis (et de la Russie) est-il si absent – surtout pour un membre de l’OTAN ? Et surtout : qu’est devenu le Diyanet, quelle influence des groupes religieux, de l’Arabie saoudite, de l’Iran ? Étrangement alors qu’il est question d’une islamisation du pays, on dit bien peu de choses sur ces points. Il s’agit plutôt d’une lutte (encore) entre un engagement laïc sans faille d’un côté (bureaucratie) et un engagement illimité à produire du sens depuis la population de l’autre (populisme). Mais on ne le comprend qu’en recomposant soi-même le sens – un peu à la manière dont la politique turque est rapportée avancer sans ligne d’horizon… Le tout manque singulièrement à mon avis de lisibilité (ne serait-ce que la liste des partis à la fin de l’ouvrage : sans dates ; les noms d’Erbakan, Gül, Erdogan ne sont pas cités ; Milli Görüs non plus… un peu léger… Sinon, j’ai cru comprendre cela : ******** La monarchie constitutionnelle est instaurée en 1876. Elle consiste en un gouvernement nommé par un parlement librement élu. Le sultan reste « à la fois calife, commandeur des croyants et chef de l’État ». Le pluralisme politique émerge. Ceux qui accèdent au pouvoir œuvrent par le haut agissent en élite envers une population à éclairer. Par un putsch, en 1913, le parti Union et Progrès, d’inspiration positiviste, nationaliste et centralisatrice accède au pouvoir. Les Jeunes Turcs au début du XXè siècle veulent libéraliser et renforcer l’idée nationale. L’Empire, vaincu en 1918, est démantelé. La monarchie est abolie en 1922 et le sultanat en 1924. Mustafa Kemal, issu des Jeunes Turcs, instaure la République Turque. La foi religieuse est déplacée dans la nation qui se fusionne avec l’État en un corps indivisible. Pratiquement, la nation est déclarée souveraine mais c’est la bureaucratie aux commandes qui la crée. En un sens, l’idée laïque remplace certes le dogme religieux, mais l’intention du sultanat d’homogénéisation sociale se maintiendrait dans la république. Le passage se lirait dans la persistance du mot « millet », « communauté constituée autour d’une autorité religieuse », où la cohésion de l’idée nationale se substitue à celle de la religion. En Turquie, les partis nationalistes et conservateurs signifieront « nation » en disant « millet ». Les principes du parti politique de Kemal, le CHP, sont la laïcité, le républicanisme, le populisme (par le bas), le nationalisme, l’étatisme et le « révolutionnarisme ». L’armée, par le CSN (Conseil de Sécurité National) incarne la « raison d’État ». La religion est administrée par une institution nouvelle, le Diyanet. Le patrimoine religieux est nationalisé, l’éducation est placée sous l’autorité du ministère de l’Éducation nationale, l’alphabet arabe est remplacé par le latin, les confréries sont interdites et leurs écoles fermées. Contre la laïcité bureaucratique, la religion par le bas s’organise. Kemal meurt en 38, son parti « dynastique » lui survit. Être turc signifie toujours adopter l’idéologie majoritaire du CHP. D’où la difficile visibilité des minorités. Le pluralisme politique se développe après la guerre. Deux coups d’État, en 1960 et 1980, dissolvent le gouvernement, mais réorganisent chaque fois des élections. En 1980, le kémalisme devient « atatürkisme » et inspire la constitution de 1982. Depuis les origines, le nationalisme est justifié par la nécessité de présenter une résistance à l’Occident qui s’est partagé les territoires autrefois ottomans. Paradoxalement, la Turquie adhère à toutes les organisations internationales (Conseil de l’Europe, Otan, Ocde, traité d’association à la CEE) et vise autant à rattraper son retard technique qu’à adopter le mode de vie occidental. Il s’agit donc bien de rejoindre l’occident. Insel insiste sur la continuité de l’inspiration autoritariste des gouvernants. Avec le temps, le nationalisme, la bureaucratie et le « laïcisme » du parti majoritaire le rangent à gauche. L’opposition se construit sur le conservatisme, le libéralisme et le religieux (millet). « Conservateur » est une manière constitutionnellement acceptée de dire « religieux » (donc islamiste) et « millet » de dire « nation idéologiquement cohésive ». Un parti « démocrate-musulman » comme il y a en Europe des « démocrates-chrétiens » n’est pas légal. En opposition au laïcisme, une doctrine regroupe les inspirations religieuses : Milli Görüs, la vision nationale. Elle unit des candidats indépendants (islamisme, nationalisme, modernisme) qui forment des partis. Contre l’élite bureaucratique, ils sont souvent les premiers de leurs familles à accéder à un niveau social de type occidental. Milli Görüs est animé par Erbakan, « ancien professeur des universités et homme d’affaires », présenté comme le « chef de l’islam politique en Turquie ». Ses partis, parce que religieux, sont successivement dissous. Il est élu député indépendant de Konya en 69. Il crée en 70 le parti de l’ordre national (MNP), qui entre au parlement – dissous en 71 –, puis le MSP, puis inspire le RP (parti de la prospérité). Erdogan rejoint Milli Görüs dans les années 70’. Né « en 54, dans une famille modeste sans être pauvre », charismatique et dynamique, Erdogan se passionne pour le football, s’intéresse à la politique et fait partie à 15 ans de mouvements islamo-nationalistes, le même que Gül, qui deviendra président de la république, et dont il est lui-même élu président pour Istanbul à 22 ans. Il y fait des études satisfaisantes à l’université publique. Pendant ce temps, il rejoint le mouvement Milli Görüs où il se fait sa place jusqu’à s’opposer publiquement à son fondateur en 78, l’année de son mariage. Le coup d’État de 1980 instaure une nouvelle Constitution qui interdit les partis politiques sauf 3. Erbakan la met en veilleuse et Erdogan se concentre sur ses études. Il est diplômé ingénieur en 81 à 27 ans. Mais inspirés par la révolution en Iran, les conservateurs (donc islamistes) rêvent de s’implanter à l’échelle nationale. De fait, en 83, c’est le conservatisme qui l’emporte (Milli DP). Le pluralisme étant à nouveau autorisé en 87, Erdogan est candidats aux législatives. Avec le RP (prospérité), Erbakan revient aussi, d’abord timidement, aux municipales de 89. Avec ce parti, l’énergique Erdogan, contre l’avis de la direction de son parti, se présente contre le CHP. Il perd, mais de peu, ce qui installe le RP. Il impressionne et se fait connaître. Une erreur le fait élire député pour dix jours en 91. Aux municipales de 94, le RP arrive en tête à l’échelle du pays et prend Ankara et Istanbul – dont le candidat élu à la mairie est… Erdogan. C’est parti. Erbakan devient premier ministre après les législatives de 95. Mais les laïcistes s’insurgent : sa femme porte le foulard ! En 1997, ils le pousse à la démission. De toute façon, en deux ans, il n’avait pas fait grand-chose. Les années 90 sont marquées par l’influence agressive de l’ « État profond », ces réseaux administratifs du CHP qui agissent pour une laïcité stricte, et la guerre contre le PKK, le parti pro-Kurde. Règlement de compte, guérillas, corruption, liquidation de partis politiques, économie stagnante… Une dame, Ciller, devient 1ère 1ère ministre en 1993. A-t-elle croisé Cresson ? Le RP est dissous en 98 pour non-respect des principes constitutionnels de la laïcité. Qu’à cela ne tienne, Erbakan a l’habitude, il crée le Parti de la vertu (FP) ; un peu en perte de vitesse toutefois en 99, l’année du tremblement de terre à Istanbul. C’est aussi l’année où, refusée en 97, la candidature officielle à l’Ue est acceptée. Une coalition est alors au pouvoir (gauche démocrate (DSP), action nationaliste (MHP), droite libérale de la mère patrie (ANAP)). Les dissensions, les réformes pas comprises et les révélations de corruption ruinent leur crédibilité. En plus, en 2001, c’est la crise financière : inflation, hausse du coût de la dette… Un économiste turc de la Banque mondiale (Dervis) rédige le programme économique du pays, et le FMI est appelé à la rescousse. Comme les autres, mais en 2001, le RP est interdit. C’est dommage, les législatives de 2002 approchaient ! Pour un peu, on croirait que c’est fait exprès. Erbakan ne se démonte pas. Il se dépêche, il a une nouvelle idée. Il crée le « parti de la félicité ». Mais maintenant, ça commence à suffire. Les partis d’Erbakan durent moins longtemps que le temps de les dire. Erdogan trouve que ça patine grave. Or il veut de l’efficace. Et c’est pas parce qu’il est interdit de vie politique pour encore deux ans qu’il va se gêner. En 2001, il crée l’AKP, « parti immaculé ». Rien à voir avec Marie. C’est une manière d’insinuer que tous les autres sont obscurantistes – et « mouillés ». La moitié des « fondateurs » sont des anciens des prospères d’Arbakan. Et puisqu’aucun parti de la « vision nationale » n’en veut, l’AKP sera pro-Ue. Voilà, c’est comme ça qu’en politique, un conservateur d’inspiration religieuse (islamique) devient un progressiste fan de la Gayreupa. Les stratégies des bureaucrates sont décidément malchanceuses. Pour empêcher les extrêmes d’arriver au pouvoir, ils avaient institué que seuls entreraient au parlement ceux qui obtiendraient plus de 10% des voix… Pas de chance : non seulement, aucun des trois de la coalition de 99 n’y parvient, mais en plus… le parti d’Erdogan fait 34 % !! L’AKP prend donc 2/3 des sièges au Parlement, et l’autre parti qui dépasse les 10%, le vénérable CHP de Kemal, prend le tiers restant. Comme il ne peut pas devenir premier ministre, faut pas pousser, son ami Gül prend la place – et s’empresse de faire voter une annulation de l’interdiction de vie politique d’Erdogan. Ni une ni deux, c’est réglé comme du papier à musique, Erdogan profite de la vacance d’une fonction à la députation pour se faire élire député – puis Gül démissionne et Erdogan devient premier ministre… Magique… En Turquie la politique se fait en changeant les lois et la constitution. Vous vouliez du libéralisme ?! On ne peut pas faire plus souple. Maintenant, on avance. La décennie 90 était une décennie perdue : avec Erdo, la suivante régule l’inflation, ajoute 40% au PIB, attire les investissements étrangers, étouffe l’extrême pauvreté. On calme le PKK, et pour l’Europe, on fonce. Entre 2002 et 2004, huit ensemble de réformes sont votées. Mais voilà. Chypre fait obstacle. L’Ue en demande la reconnaisse puisqu’il en devient membre. En Turquie, l’opinion exige en contrepartie que soit reconnu le nord de Chypre par la communauté internationale, laquelle s’y refuse depuis l’occupation de 1974. Soit. Six chapitres de l’acquis communautaire sont gelés. Ensuite, deuxième obstacle, c’est la réforme de décentralisation de l’AKP qui est rejetée. C’est que les kémalistes craignent la scission du pays par l’émergence de dissidences locales. Troisième obstacle, l’entrée de la Turquie dans l’Ue devient un sujet politique interne au continent. La gauche et les verts lui tendent la main. Pour aider, le Nobel de littérature est accordé à Pamuk en 2006. On passe des films turcs en Europe. Les étudiants reviennent enchantés de leur Erasmus à Istanbul. Ça suffit pas. Les alliés conservateurs européens (paradoxalement) rejettent le conservateur Erdogan. Partout les conservateurs s’accordent pour dire que conservatisme et religion s’accommodent, mais si c’est chacun la sienne. En 2007, autre échec, l’AKP échoue à faire élire Gül président de la république (faut dire, il faut 4 tours : deux à 2/3 des voix du parlement et 2 à 50% !). Qu’à cela ne tienne, l’AKP a la population pour lui. Erdo « référende ». Désormais le président sera élu au suffrage universel direct. C’est fait, Gül est président. Le volontarisme mène à apaiser les relations avec le PKK. Les mesures qui suivent s’éloignent de l’ouverture démocratique. Bise-carotte à l’extrême droite, le port du voile est réautorisé à l’université. C’est annulé par le Conseil Constitutionnel qui lance en réponse une procédure d’interdiction de l’AKP et de vie politique pour 71 de ses membres ! Le jugement se limite à diminuer les subventions au parti. Était-ce une semonce ? Elle n’a pas été comprise. Vient la crise financière et les scandales d’Energekon. Ce scandale est la révélation d’une corruption au sein des administrations qui commencent un jour par la découverte de 27 grenades. Le livre n’est pas clair sur l’objectivité de l’affaire, mais l’AKP présente une accusation de 2500 pages qui mènent à la neutralisation du « néokémalisme » (armée, médias, fonctionnaires, etc). L’économie en récession se rétablit en 2010. Mais le refus de réguler les marchés publics laisse fermée la porte de l’Ue. En 2010, un « lot important d’amendements » vise à renforcer les libertés fondamentales et… les modes « de nomination des membres du Conseil supérieur des magistrats et des procureurs et ceux de la Cour constitutionnelle ». Elles sont adoptées par référendum à 58%. Les problèmes s’accumulent en 2013. Obama accuse Erdogan de financer les djihadistes en Syrie. L’Égypte rompt les relations parce qu’il soutient aussi le président déchu (tout faux décidément), suivi de l’Ennahda tunisienne. Les manifestations de la place Taksim d’Istanbul sont sévèrement réprimées. Et la fin de la présidence chypriote de l’Ue n’aura pas permis d’avancée sur le dossier. Pour couronner le tout, Erdogan se présente à Bruxelles début 2014 un mois après l’arrestation des trois ministres pour corruption. Une ouverture cependant : après trois mandats, Erdogan ne peut plus occuper la fonction de chef du gouvernement : il se présente à la présidence, qu’il remporte. #119868; #119886;#119898; #119905;#8462;#119890; #119875;#119903;#119890;#119904;#119894;#119889;#119890;#119899;#119905;. Même pas peur, le 15 juillet 2016, il maîtrise un coup d’État préparé mais éventé, ou mal préparé, ou pas bien conçu, ou mal mené, on ne sait pas trop, lui non plus (peut-être). C’est en tous cas le prétexte à accuser encore l’État profond : 3 mois d’état d’urgence, 93 000 fonctionnaires suspendus, 82 000 arrestations et 34 000 emprisonnements, 100 médias interdits. Bon, je me ferais bien construire une mosquée qui domine Istanbul, moi. Mais après ? La suite, sur vos écrans, hier, demain, on n’était pas certain, en 2017, qu’il tiendrait jusqu’en 2023…
Avis des membres
Fiche technique du livre
-
- Genres
- Actualités et Société , Politique
-
- EAN
- 9782707194855
-
- Collection ou Série
- La Découverte Poche / Essais
-
- Format
- Livre numérique
-
- DRM
- Filigrame numérique
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers où les mots s'animent et où les histoires prennent vie. Que vous soyez à la recherche d'un roman poignant, d'une intrigue palpitante ou d'un voyage littéraire inoubliable, vous trouverez ici une vaste sélection de livres qui combleront toutes vos envies de lecture.
11,99 € Numérique 187 pages