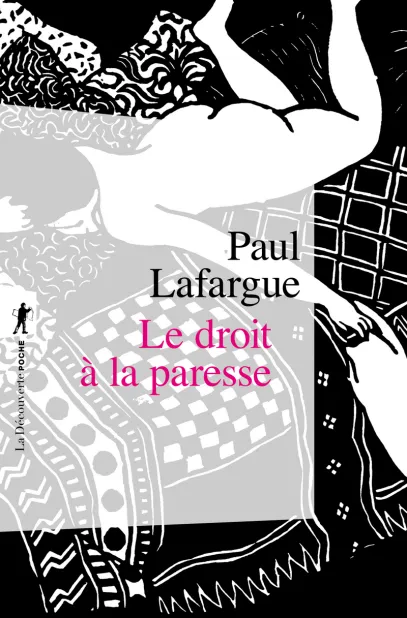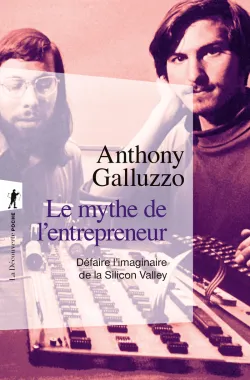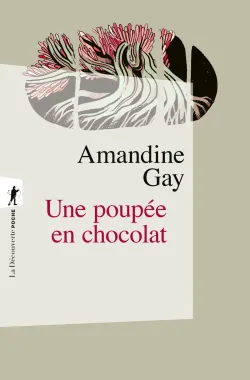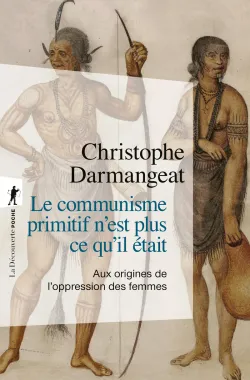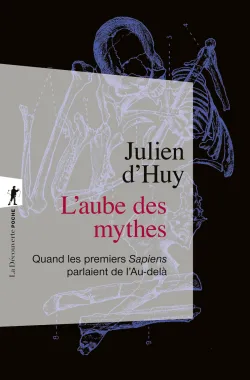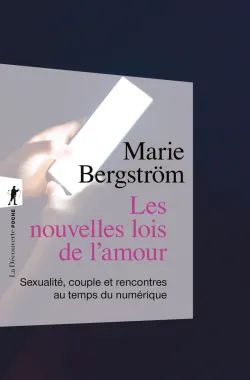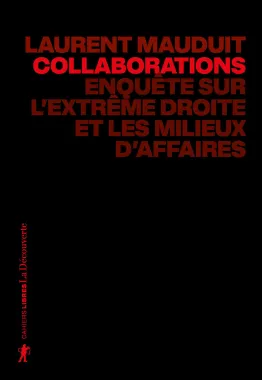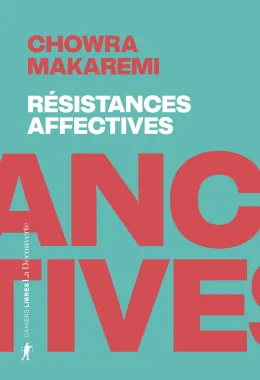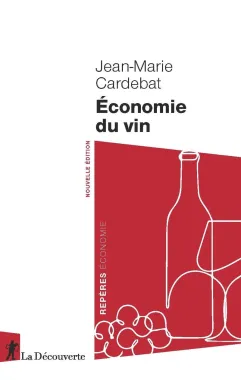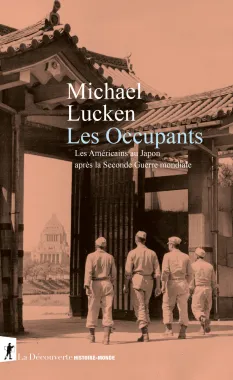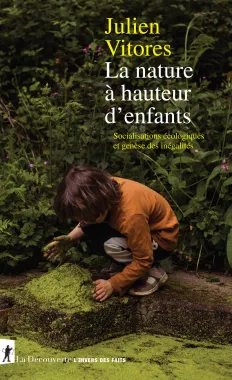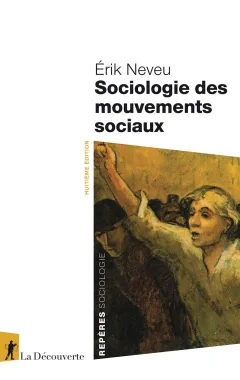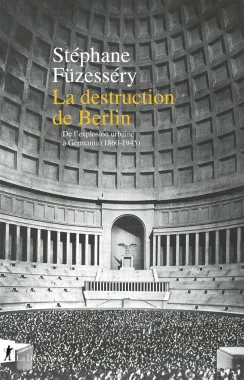Le droit à la paresse : Le livre de Paul Lafargue
" Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis deux siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. "
Ainsi commence le fameux pamphlet de Paul Lafargue (1842-1911), Le Droit à la paresse, initialement publié en 1880. Intellectuel socialiste et militant infatigable de la cause du peuple, il signait là un texte pionnier, premier essai en faveur d'un retournement de civilisation, produit heureux d'une volonté de provocation et d'une intuition géniale, d'un authentique sentiment révolutionnaire et anticipateur.
La présente édition reprend celle publiée en 1969 par François Maspero, avec la longue et belle " présentation " de Maurice Dommanget, toujours pertinente aujourd'hui et qui apporte un éclairage indispensable sur la vie et l'œuvre de Lafargue. Elle est utilement complétée par une préface inédite de l'historien Gilles Candar.
De (auteur) : Paul Lafargue
Préface de : Maurice Dommanget
Expérience de lecture
Avis Babelio
kapacontrol
• Il y a 2 semaines
C’est un petit texte, mais d’une puissance inattendue. Un pamphlet, oui, mais qui résonne encore aujourd’hui avec une clarté presque insolente. Paul Lafargue, gendre de Marx, y prend le contre-pied des dogmes dominants du XIXe siècle et s’attaque, avec une verve pleine d’ironie, au culte du travail. Non pas au travail comme activité, mais à son idolâtrie, à son érection en vertu suprême, quand il devient une forme d’aliénation. J’ai lu ce texte comme une gifle, joyeuse mais grave. Lafargue ose dire ce que peu osaient : que l’ouvrier moderne, abruti de labeur, s’épuise au nom d’une morale bourgeoise qui le prive de sa liberté. Il rappelle que les civilisations anciennes savaient ménager du temps pour le loisir, la fête, l’oisiveté féconde. Le contexte est essentiel : nous sommes en pleine révolution industrielle, les corps sont usés dans les usines, les journées interminables broient des générations entières. Et dans ce fracas, Lafargue brandit le mot « paresse » comme un étendard. Subversif, provocateur, mais aussi fondé, argumenté. Ce texte m’a fait réfléchir au rapport que nous entretenons encore aujourd’hui avec la productivité. À la manière dont l’obsession de l’efficacité continue de grignoter nos vies. Il m’a aussi rappelé que revendiquer le repos, la lenteur, n’est pas une faiblesse, mais un droit. Un droit à être, simplement.
Cricri08
• Il y a 2 mois
Il m’arrive parfois de tomber sur un texte ancien qui résonne étrangement avec nos débats les plus actuels — comme une voix du passé qui viendrait murmurer à l’oreille des épuisés du présent. Le Droit à la paresse de Paul Lafargue est de ceux-là. Publié en 1880, ce petit brûlot socialiste n’a rien perdu de sa force provocatrice. Mieux : il fait presque figure de manifeste pour notre époque de surmenage généralisé. Lafargue, gendre de Karl Marx et médecin de formation, y tourne en dérision le culte moderne du travail. À ses yeux, le salariat industriel n’a rien d’émancipateur : il est au contraire une forme d’esclavage volontaire, déguisée en vertu. Ce que réclame Lafargue, ce n’est pas plus de travail, mais le droit au repos, à la flânerie, à la joie de vivre. Un renversement complet de la logique économique et morale dominante. Et il le fait avec une verve incroyable, mêlant ironie, érudition et une rage de vivre qu’on sent sincère. Je l’ai lu avec un plaisir réel. Il y a quelque chose de libérateur à voir l’idéologie productiviste renvoyée dans les cordes, surtout à une époque où l’on peine à décrocher de nos écrans même en week-end. On se surprend à sourire en lisant ses moqueries de l’ouvrier fier de sa fatigue ou de la bourgeoisie prisonnière de son luxe agité. Mais ce plaisir de lecture a été freiné, chez moi, par un malaise plus discret — un grincement. Car entre deux charges contre le capitalisme, Lafargue glisse quelques remarques bien moins inspirantes. Lorsqu’il parle des « peuples d’usuriers », et notamment des Juifs, on sent poindre quelque chose de moins noble : une reprise, peut-être inconsciente, de vieux clichés qui circulaient déjà à son époque. C’est fugace, presque anecdotique dans le texte — mais impossible à ignorer. Ce type de raccourci, qui mêle critique du capital à une vision caricaturale de « l’argent juif », était malheureusement fréquent dans certains cercles socialistes du XIXe siècle. On pensait alors pouvoir dénoncer l’injustice sociale sans toujours s’apercevoir qu’on alimentait au passage des préjugés séculaires. Aujourd’hui, ces glissements nous apparaissent pour ce qu’ils sont : des failles graves dans un discours qui se voulait libérateur. Alors que faire de Le Droit à la paresse ? Le rejeter entièrement serait absurde. Mais le lire comme un texte sacré serait tout aussi dangereux. Pour moi, c’est un texte à lire en conscience : en saluant sa lucidité sur le travail, en s’inspirant de sa liberté de ton, mais aussi en reconnaissant ses angles morts. C’est un produit de son temps, avec ce que cela implique de génie critique… et de limites embarrassantes. En somme, Le Droit à la paresse reste un texte précieux — non pas parce qu’il serait pur ou parfait, mais parce qu’il nous oblige à penser, à nuancer, à rester vigilants. Comme toute œuvre marquante, il nous bouscule. Et c’est déjà beaucoup.
BVIALLET
• Il y a 4 mois
L'amour du travail n'est-il pas une sorte de folie ? La passion du travail peut-elle être poussée jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de toute sa famille ? Est-il normal de devoir assurer des journées de douze heures de labeur pour des salaires de misère, de faire travailler les femmes en usine et même les enfants dans les mines de charbon pour le plus grand profit d'un patron qui n'a aucun souci du confort de ses ouvriers ? Ne devrait-on pas au contraire imiter les peuples primitifs, non encore touchés par le modernisme, qui ne travaillent que deux ou trois heures par jour et ne s'en portent que mieux ? « Le droit à la paresse » est un court essai (79 pages) très polémique, bien ancré dans son époque, mais également étonnement moderne. Par certains côtés, on dirait presque un texte de baba cool des années 68 ! L'auteur qui fut le gendre de Karl Marx fait ici le procès du capitalisme d'une manière assez originale. Il dénonce la folie de la production à outrance qui entraine quantité de surplus qu'il faut tenter de vendre aux quatre coins du monde alors qu'il faudrait plutôt, selon lui, fabriquer moins et de meilleure qualité. La logique du rendement et celle de la qualité de vie sont donc en totale opposition. Les conditions de travail en usine ramènent l'ouvrier à une sorte d'esclavage qui l'oblige de perdre sa vie en cherchant à la gagner. Ce texte reste fort intéressant surtout du point de vue de l'histoire des idées. Lafargue était un socialiste comme on n'en rencontre plus de nos jours. Il dut s'exiler à plusieurs reprises (Grande-Bretagne, Espagne) et fit même un séjour dans la sinistre prison de Sainte Pélagie, tout comme Gérard de Nerval, pour ses idées révolutionnaires. Le texte est suivi d'un commentaire signé Gigi Bergamin, intitulé « Eloge de la vraie vie » et d'une courte biographie de l'auteur.
Hans8367
• Il y a 6 mois
Une passionnante remise en question de la dichotomie travail/oisiveté en France, qui n'est pas sans rappeler les travaux d'Olivier Babeau aujourd'hui. Paul Lafargue (1842-1911), est un journaliste, économiste et homme politique socialiste français, époux de Laura Marx, fille de Karl. Il développe ici l'idée que le travail en France est un surtravail inutile, les ouvriers pourraient tous se contenter de travailler 3h par jour et profiter de leur temps libre le reste de la journée. On est très loin d'une injonction libertaire à regarder du porno et des anime, Lafargue enjoint l'ouvrier libéré à aller au théâtre, à l'église et avec sa famille à la place (même si Lafargue lui-même est athée, il respecte le caractère "drogué" de la classe ouvrière à "l'opium du peuple" qu'est la religion). A l'heure des bullshit jobs, c'est à relire !
Avis des membres
Fiche technique du livre
-
- Genres
- Classiques et Littérature , Essais
-
- EAN
- 9782707159496
-
- Collection ou Série
- La Découverte Poche / Essais
-
- Format
- Poche
-
- Nombre de pages
- 196
-
- Dimensions
- 191 x 127 mm
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre univers où les mots s'animent et où les histoires prennent vie. Que vous soyez à la recherche d'un roman poignant, d'une intrigue palpitante ou d'un voyage littéraire inoubliable, vous trouverez ici une vaste sélection de livres qui combleront toutes vos envies de lecture.
10,00 € Poche 196 pages