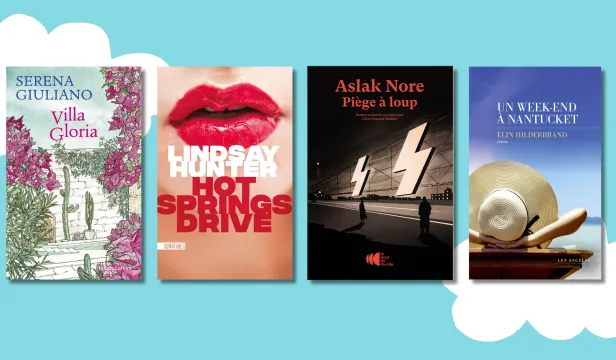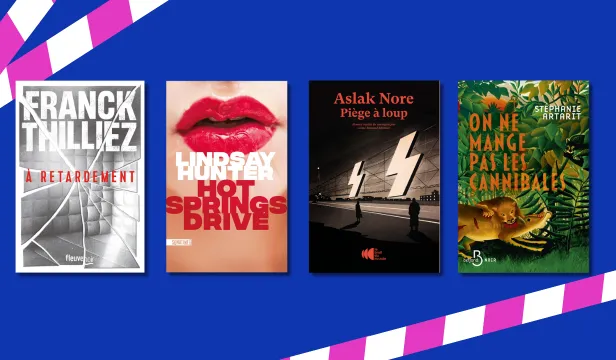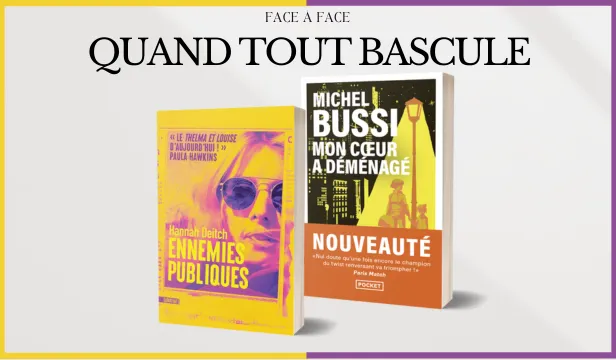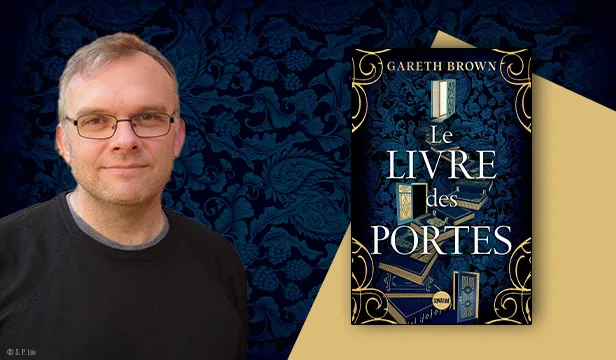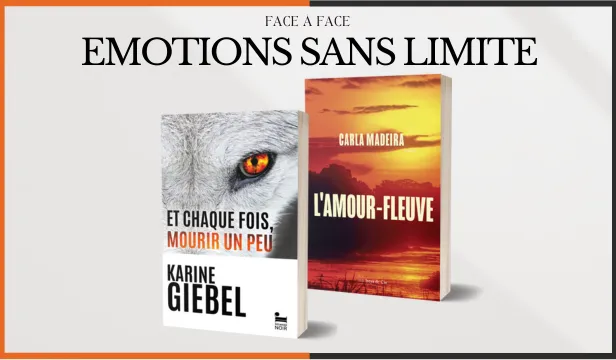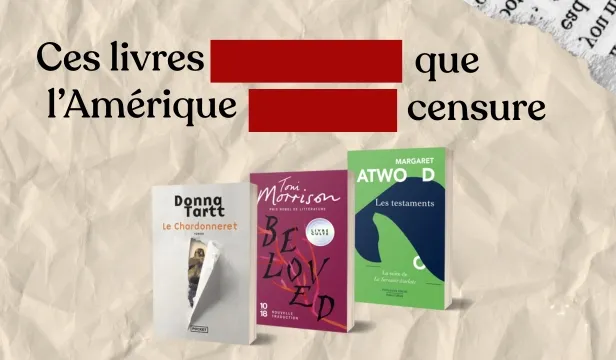Portrait
La nouvelle génération du roman noir américain
Publié le 01/02/2024 , par Sonatine

Chez Sonatine, on pense que David Joy, S. A. Cosby et Gabino Iglesias constituent la crème de la crème du roman noir américain, la dream team de la littérature contemporaine qu’on voudrait mettre entre toutes les mains, le saint patronage dont on n’aurait osé rêver pour 2024. Alors que fait-on quand les planètes s’alignent et que leurs nouveaux romans tombent la même année ? On les réunit et on les laisse parler littérature, pardi !
Pourquoi écrivez-vous des romans noirs ?
David Joy : Au début, ce n’était pas un choix délibéré. C’est juste que je voulais écrire le genre d’histoires que j’aurais aimé lire. L’autre jour, je discutais avec Richard Krawiec et Yan Lespoux et tous deux s’accordaient à dire que le noir est une histoire qui commence mal et ne fait qu’empirer. J’aime bien cette idée. Je préfère les flots agités aux mers calmes. Je ne suis pas à l’aise avec les happy endings. Voilà ce qui me définit en tant qu’auteur.
S. A. Cosby : Je dirais que c’est mon inclination naturelle. Je porte un regard pragmatique, souvent teinté de cynisme, sur le monde, et cela traduit une sensibilité qui correspond au roman noir.
Gabino Iglesias : Le noir est un genre, mais aussi un état d’esprit. Je suis sûr que les auteurs de romances pensent sans cesse à l’amour, et que les auteurs de science-fiction sont toujours branchés sur les autres planètes, les extraterrestres et l’espace. Et puis il y a ceux d’entre nous qui pensent surtout aux gens qui font de mauvaises choses dans un système qui ne fonctionne plus. J’ai toujours adoré le noir et l’horreur, du coup c’était assez naturel d’en écrire moi-même. Vous savez, un peu comme ce gamin fan de foot qui finit par jouer pour le PSG.
Il semble de plus en plus compliqué d’écrire sur l’Amérique contemporaine sans passer par le prisme du noir. Avez-vous l’impression que le réel a rattrapé la fiction ?
S. A. C. : Dennis Lehane a dit que le genre du noir ne racontait pas la trajectoire de celui qui tombe du ciel sur terre, mais plutôt de celui qui tombe du coin de la rue dans un égout. J’ai l’impression que l’Amérique moderne se rapproche de plus en plus de cette définition. Nous sommes arrivés à un croisement, et il va falloir choisir entre le chemin qui nous sortira de cette période sombre et celui qui laissera le champ libre à la noirceur de nos âmes.
G. I. : Selon moi, le roman noir est un miroir qui nous montre le monde tel qu’il est. La pauvreté la colère, le crime, le désespoir, le racisme : ça, ce sont des réalités qui s’invitent dans mes fictions. Dans Le Diable sur mon épaule, j’évoque aussi le système de santé aux États-Unis. Un système immonde, et je connais ce dégoût d’autant plus que je me suis retrouvé sans assurance médicale la moitié du temps où j'ai vécu dans ce pays. Mis à part la non-fiction, le noir est pour moi le genre qui s’approche le plus du réel. Mes écrits ont forcément une dimension politique, tout comme ceux de David et Shawn (S. A. Cosby), et je l’assume entièrement.
D. J. : Je me souviens d’un entretien avec Megan Abbott à Vincennes, en 2016, durant lequel elle a affirmé que le genre du noir pouvait se mettre au service du roman social d’une manière bien plus efficace que les autres genres. Bon, elle l’a dit bien mieux que moi. Quand je pense au roman noir, surtout celui d’auteurs comme Gabino, Shawn et moi, je trouve qu’il est une mise en lumière du bas de la société, et une mise en accusation de son sommet. La tension à l’oeuvre dans la société américaine a deux carburants, le pouvoir et les privilèges, et elle bouillonne entre ceux qui ont tout et ceux qui n’ont rien. Pour moi, le roman noir est donc devenu une esthétique évidente pour parler de la société et la critiquer.
Quand on pense aux États-Unis, on pense forcément au rêve américain et à son négatif, les laissés-pour-compte bien réels du mythe de l’Americana. Avez-vous l’impression d’écrire des fictions sur fond de réalité sociale, ou vos personnages sont-ils les porte-parole d’êtres et de communautés bien réels ?
G. I. : Je suis un homme latino qui vient des Caraïbes et vit au Texas. Je parle anglais, mais avec un accent. J’utilise l’espagnol dans mes romans. J’écris sur des gens comme moi, et les gens comme moi sont marginalisés par ce pays. J’écris sur des personnages LGBTQ+. J’écris sur des gens sans couverture médicale. J’écris sur des gens qui se font virer et n’ont aucune alternative pour survivre. Le seul truc qui n’est pas réaliste dans mes romans, c’est les monstres !
S. A. C. : Dans ma jeunesse, il n’y avait pas vraiment de bouquins, thrillers ou autres, qui reflétaient la réalité de ma vie dans le Sud rural des États-Unis. Quand je me suis mis à écrire, c’était avec la volonté de faire de mon mieux pour représenter les gens avec qui j’ai grandi, pour raconter leurs histoires à la fois sublimes et grotesques. D’une certaine manière, tous mes romans sont une déclaration d’amour au Sud rural de mon enfance.
D. J. : Comme je le disais précédemment, tout récit est sous-tendu par l’idée de conflit, et il n’y a pas de sources de tensions plus fortes aux États-Unis que les questions raciales et sociales, les deux étant bien sûr intrinsèquement liées. Gabino, Shawn et moi avons tous grandi parmi la classe ouvrière, et sommes donc intimement familiers de ces tensions. En fait non, ils les connaissent mieux que moi, puisque je suis blanc, et donc détenteur de privilèges qu’eux n’ont pas eus, peu importe ma condition sociale. Malgré tout, je pense qu’ils seront d’accord pour dire que oui, nos écrits sont les porte-parole de gens réels, et même plus : on écrit parce que ces gens, on en fait partie.
Vos différents romans ont en commun d’être ancrés dans une géographie très atmosphérique, qui est pratiquement un personnage en soi ! Parlez-nous un peu de votre rapport à votre territoire de prédilection.
S. A. C. : Si le fantôme du Sud devait s’incarner dans un lieu, ça serait Charon. C’est un endroit plein de secrets et de zones d’ombre, mais aussi de beauté, d’amour et de lumière – si vous êtes assez courageux pour les chercher.
D. J. : À vrai dire, je ne connais rien d’autre. Je viens de Jackson County, en Caroline du Nord. J’écris sur les terres dont je viens, un lieu qui existe, un endroit qui n’est pas juste un territoire mais une rencontre entre ce territoire et les gens qui l’habitent – deux éléments qui sont tellement liés que l’un n’existe plus sans l’autre. Donc, j’écris de et sur un lieu extrêmement précis et spécifique. Mais j’écris avec l’espoir, mis en mots par James Joyce, que « le particulier contienne l’universel ».
G. I. : Les lieux et la géographie sont primordiaux dans Le Diable sur mon épaule. Le roman trimballe le lecteur d’Austin à San Antonio puis jusqu’au Mexique, avant de revenir à Austin. Le Sud des États-Unis est naturellement noir. On connaît déjà les romans noirs sur Los Angeles et New York. Il est grand temps que d’autres lieux deviennent aussi emblématiques et prennent autant de place, et je crois que c’est ce que David, Shawn et moi essayons de faire.
On n’oserait jamais vous demander si vous êtes de nature plutôt optimiste ou pessimiste, donc essayons autrement : Oppenheimer ou Barbie ?
On n’oserait jamais vous demander si vous êtes de nature plutôt optimiste ou pessimiste,
donc essayons autrement : Oppenheimer ou Barbie ?
S. A. C. : Ha, ha. Je suis un Oppenheimer qui aurait tellement aimé être une Barbie.
D. J. : Je dirais que je suis un pur produit des deux, et cette conclusion me rend très, mais alors très pessimiste.
G. I. : Oppenheimer… Enfin, si Oppenheimer était un fan de Lovecraft, Thomas Ligotti, James Ellroy, Kafka, et qu’il était à fond dans le nihilisme et l’horreur.
Découvrez les titres :
Le Sang des innocents - S.A. Cosby